L’encyclopédie de la parole/Joris Lacoste : Suite n° 1 « ABC ».
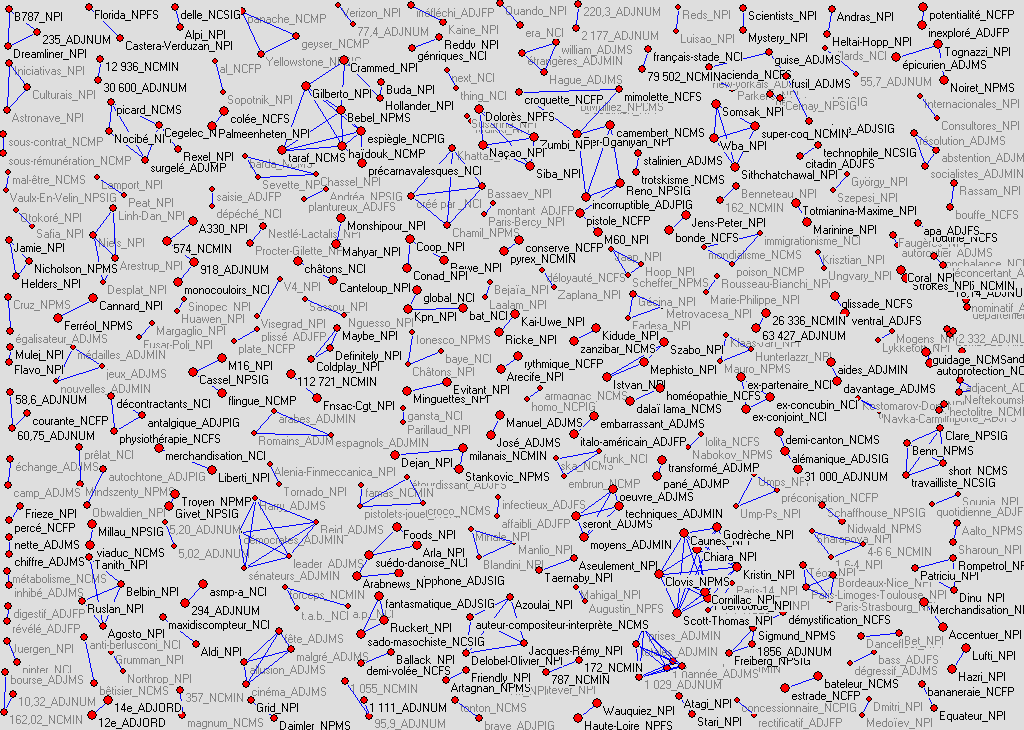 Au début était le mot. Un magma originel, une foison de mots que prononcent vingt-deux personnes debout sur une estrade faisant face à un chef d’orchestre. Ici et là se détache brièvement une parole ou une bribe de phrase pour retomber aussitôt dans la masse.
Au début était le mot. Un magma originel, une foison de mots que prononcent vingt-deux personnes debout sur une estrade faisant face à un chef d’orchestre. Ici et là se détache brièvement une parole ou une bribe de phrase pour retomber aussitôt dans la masse.
Puis ce brouhaha se transforme, se métamorphose, en une série incroyable, sidérante, d’extraits de bandes annonces, de conversations téléphoniques à une voix, de cours de langue anglaise avec un accent russe, d’une répétition d’orchestre ou d’un accouchement sans douleur : les interprètes, seuls ou en groupe – le plus cocasse étant sans doute ce groupe d’hommes et de femmes qui parlent à l’unisson de la voix de la femme qui accouche… – reproduisent le rythme, le phrasé, l’intonation, l’accent, la musique présents dans les matériaux originaux. Ce faisant, ils lui donnent une dimension très particulière : on les entend, on les écoute autrement, comme on écoute les dialogues apparemment banals de La Cantatrice Chauve Ionesco ou la mélodie des phrases – non seulement prononcées mais écrites ! – de The Cave de Steve Reich.
Et si vous ne l’avez encore vu en octobre au Centre Pompidou, courrez voir ce spectacle à Montreuil en novembre.
Trisha Brown: For M.G. – Homemade – Newark
 J’avais découvert Trisha Brown – et la danse postmoderne en général – en voyant, dans les années 1980, le film documentaire Making Dances: Seven Post-Modern Choreographers de Michael Blackwood (j’en avais précédemment parlé plus longuement), mais n’avais pu voir que peu de ses chorégraphies. Fort heureusement, le Festival d’Automne à Paris et le Théâtre de la Ville – qui nous donnent souvent l’occasion d’assister à des merveilles de danse contemporaine (bon, il y a des exceptions, mais elles confirment la règle) – nous proposent deux spectacles de la Trisha Brown Dance Company en guise de rétrospective de six de ses créations entre 1966 et 1994. Il faut dire qu’elle a décidé de mettre fin à sa carrière extraordinaire (plus de 90 œuvres à son actif) pour des raisons de santé et fait ses adieux avec ses deux dernières œuvres (datant de 2011) présentées cette année de New York à Lyon.
J’avais découvert Trisha Brown – et la danse postmoderne en général – en voyant, dans les années 1980, le film documentaire Making Dances: Seven Post-Modern Choreographers de Michael Blackwood (j’en avais précédemment parlé plus longuement), mais n’avais pu voir que peu de ses chorégraphies. Fort heureusement, le Festival d’Automne à Paris et le Théâtre de la Ville – qui nous donnent souvent l’occasion d’assister à des merveilles de danse contemporaine (bon, il y a des exceptions, mais elles confirment la règle) – nous proposent deux spectacles de la Trisha Brown Dance Company en guise de rétrospective de six de ses créations entre 1966 et 1994. Il faut dire qu’elle a décidé de mettre fin à sa carrière extraordinaire (plus de 90 œuvres à son actif) pour des raisons de santé et fait ses adieux avec ses deux dernières œuvres (datant de 2011) présentées cette année de New York à Lyon.
Dans le premier de ces spectacles, For M.G. (1991) et Newark (1987) sont exécutés par sept danseurs, hommes et femmes, habillés en collants qui leur sont comme une deuxième peau. L’abstraction et la fluidité de leurs mouvements sur une scène nue et sous un jeu de lumières discret mais efficace est tout simplement fascinante. Quant à Homemade (1966), comment ne pas penser à Dance (1979) de Lucinda Childs ? Ces deux grandes œuvres combinent danse et film de cette même danse, d’une façon si semblable et si différente ! Ici, c’est un solo de danseuse qui porte sur son dos le projecteur du film : l’image évoluera sur le mur du fond ou vers la salle en fonction de ses propres mouvements, se déformera, disparaîtra pour réapparaître. Amusant, magique, intelligent. Ces chorégraphies d’une modernité intemporelle n’ont pas pris une ride et, on ose l’imaginer, n’en prendront pas de sitôt.
Et si vous n’avez encore vu son œuvre, le second spectacle se donne cette semaine au Théâtre de la Ville.
Francis Poulenc : La Voix humaine.
 On a pu assister au Conservatoire de Paris à la représentation d’un chef-d’œuvre coup-de-poing, La Voix humaine de Francis Poulenc. L’argument : une femme se fait larguer au téléphone. Quoi de plus banal, de nos jours, où le téléphone est l’intermédiaire inévitable dans nos vies, de l’amour à la rupture ? D’abord, la pièce de théâtre de Jean Cocteau que Poulenc a adaptée date de 1930, et si les communications filaires d’alors étaient aléatoires, celles cellulaires d’aujourd’hui le sont souvent aussi dans leur genre. Ensuite, c’est un dialogue dont on n’entend que l’un des correspondants, en l’occurrence la femme, dont la souffrance est loin d’être banale – la souffrance n’est jamais banale pour celui qui souffre – et qui passe par toutes les phases de l’exaltation, de la légèreté et de la tendresse au désespoir le plus profond. Mais tel que le texte est écrit, comment ne pas entendre aussi en creux l’homme, tour à tour doucereux, menteur, manipulateur ?
On a pu assister au Conservatoire de Paris à la représentation d’un chef-d’œuvre coup-de-poing, La Voix humaine de Francis Poulenc. L’argument : une femme se fait larguer au téléphone. Quoi de plus banal, de nos jours, où le téléphone est l’intermédiaire inévitable dans nos vies, de l’amour à la rupture ? D’abord, la pièce de théâtre de Jean Cocteau que Poulenc a adaptée date de 1930, et si les communications filaires d’alors étaient aléatoires, celles cellulaires d’aujourd’hui le sont souvent aussi dans leur genre. Ensuite, c’est un dialogue dont on n’entend que l’un des correspondants, en l’occurrence la femme, dont la souffrance est loin d’être banale – la souffrance n’est jamais banale pour celui qui souffre – et qui passe par toutes les phases de l’exaltation, de la légèreté et de la tendresse au désespoir le plus profond. Mais tel que le texte est écrit, comment ne pas entendre aussi en creux l’homme, tour à tour doucereux, menteur, manipulateur ?
Cette tragédie est en soi un chef d’œuvre, et la partition qu’a écrite Poulenc est remarquable et particulièrement difficile pour la voix musicalement parlant (le français est, en soi, déjà difficile à chanter !) : « Butterfly et Tosca c’est très facile à côté de ça, j’ai chanté les deux », disait Denise Duval, dont on ne peut oublier l’interprétation extraordinaire qu’elle en avait donnée. C’est elle qui a créé l’œuvre en 1959, il en existe un fameux enregistrement (et un film). Et à ce propos, voyez donc ce qu’elle en dit des années plus tard lors d’une master class (elle avait alors 78 ans, remarquable !).
Ici, c’est Raquel Camarinha, élève au Conservatoire, qui en a donné une fort belle interprétation musicale – timbre, phrasé, intonation, agilité et expressivité – sans apparent effort malgré la grande complexité de l’œuvre. Quant à l’élocution et la prononciation, elles étaient quasiment parfaites, à l’exception de quelques voyelles ici et là qui « sonnaient » étranger. Le jeu corporel (visage, mains, corps…), lui, semblait moins convaincant, voire étrangement inexpressif : après tout, c’est encore une très jeune femme, il lui faudra du temps pour se mettre dans la peau d’une femme probablement plus âgée et expérimentée, autant dans l’amour que dans la souffrance… Au piano, Yoan Hereau, qui a su se jouer, lui aussi, des difficultés de la partition (et parfois aussi de la mise en scène, quand la femme l’enlace tandis qu’il continue imperturbablement à jouer…). La mise en scène d’Aleksi Barrière est simple – aucun mobilier (le lit apparaît brièvement dans une vidéo qu’on aime ou non sur le mur du fond de la scène), deux objets : le téléphone, la boîte de cachets, et innove (ou trahit ?) : on peut se demander si c’est réellement un dialogue déchirant ou un monologue délirant… Quoi qu’il en soit, c’est une tragédie.
Et si vous voulez vous changer les idées et remonter le moral, voyez donc Francis Poulenc et Denise Duval (elle n’est pas la seule à chanter !) dans une performance particulièrement cocasse d’un passage des Mamelles de Tirésias… Les féministes apprécieront.





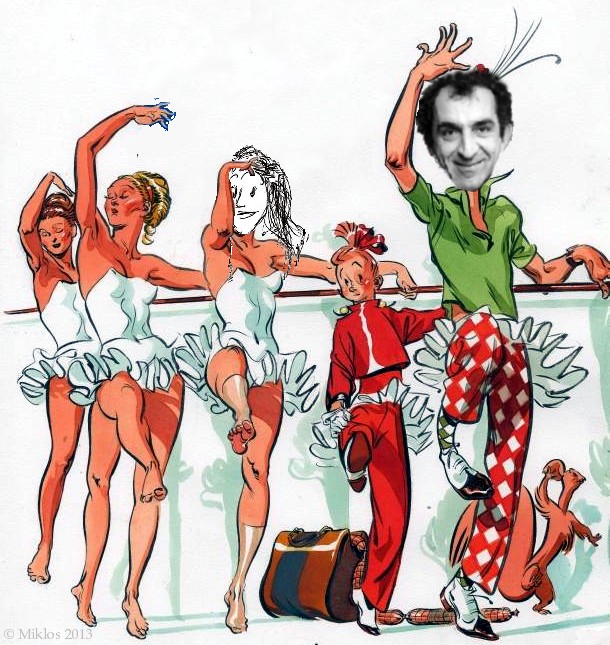
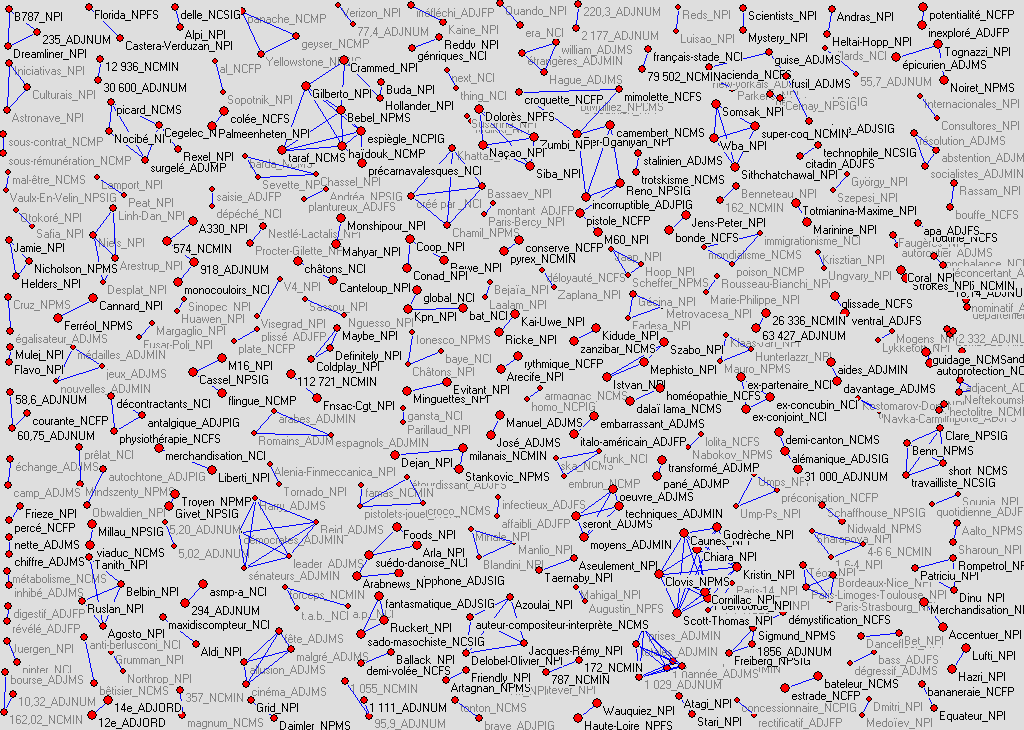
 J’avais découvert Trisha Brown – et la danse postmoderne en général – en voyant, dans les années 1980, le film documentaire
J’avais découvert Trisha Brown – et la danse postmoderne en général – en voyant, dans les années 1980, le film documentaire 
