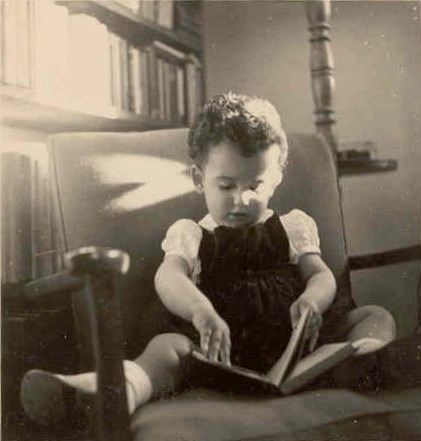École et mairie du Fidelaire.
Cliquer pour agrandir.
L’inscription que l’on voit sur un mur de ce bâtiment est souvent attribuée à tort à Victor Hugo – sans aucune mention de la source, et avec de nombreuses variantes – phénomène que les copier-coller en ligne intempestifs ne font que démultiplier (et ainsi « tromper » les IA, qui se convainquent de la véracité de la citation). Mais, comme on peut le voir ci-dessous, la multiplicité des attributions – Chopinet, Gambetta, Jules Ferry, Jean Macé, Jules Simon, Victor Duruy, Louis Jourdan, Lord Macaulay, Thiers, François Guizot, Condorcet, et même Jean-Jacques Rousseau – précède aussi la naissance de l’Internet, et remonte au XIXe siècle…
L’article – intéressant de par ailleurs – d’Armand Erchadi (2010), démonte ces erreurs tout en analysant la réflexion de Hugo sur « cette question sociale dont la pénalité et l’éducation sont les deux versants ». Quant à la source de la citation, il accepte l’attribution qu’en fait Pierre Larousse : ce serait Louis-Charles Jourdan (sans citer de source primaire). On a effectivement trouvé deux articles de Jourdan, datant de 1863, dans lesquels il exprime cette idée avec deux formulations différentes (celle du 13 octobre plus réaliste que l’autre).
Mais on a aussi trouvé des sources primaires de variantes remontant à 1838 (« Une école de plus, une prison de moins », – formulation la plus concise d’entre toutes celles qu’on a trouvées –, titre d’un mémoire primé de Louis-Clément Houry), voire à 1837 (« Ouvrir des écoles, c’est fermer les prisons »), cette dernière dans un recueil de Pensées et maximes de Félix Bogaerts.
En est-il l’auteur ? Mystère. Une page de Dicocitations affirme qu’« elle serait plutôt [de la plume] de Jules Simon et attestée sous la forme au singulier Ouvrir une école c’est fermer une prison in Pensées et Maximes de Félix Guillaume Marie Bogaerts. » Sauf que Bogaerts ne mentionne nulle part Jules Simon et qu’il (Bogaerts) semble bien être l’auteur de l’ensemble des pensées et maximes de son ouvrage…
Enfin, quant aux autres attributions mentionnées ci-dessus, on n’en a pas encore trouvé les sources premières, notamment celle de Guizot, .
On trouvera ci-dessous quelques-unes de ces attributions au fil des années. Enfin, on trouvera là notre « conversation » avec ChatGPT à ce propos.
On concluera en espérant que, une fois qu’on aura signalé à cette école l’attribution erronée, elle aura à cœur non seulement de la corriger, mais d’enseigner à ses élèves comment citer correctement en cette ère du copier-coller à l’aveuglette.

« Ouvrez une école et vous fermerez une prison ». Victor Hugo proclame ainsi, dans Les Misérables, sa confiance inébranlable dans les vertus de l’éducation au service du progrès.
Thomas Ernoult : « L’école depuis la Révolution : quelques jalons historiques », in Regards croisés sur l’économie, 2012/2 n° 12, pp. 50-53. [Disponible en ligne]
« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons » : qui a fait mentir Victor Hugo ?
Titre d’un article de Natacha Poloni, in Le Figaro, 13 juin 2013. [Disponible en ligne]
« Ouvrir une école aujourd’hui, c’est fermer une prison dans vingt ans ! », disait François Guizot en 1832.
Josette Demory et al. : Les Palmes académiques. Une histoire de l’école publique, 4e de couverture. Altipresse, 2016. [source]
« Ouvrir une école, c’est fermer une prison », cette formule devenue slogan a suscité tout au long du XXe siècle l’interrogation des hugoliens, et pour cause, car elle ne se trouve nulle part dans l’œuvre de Victor Hugo. […] En réalité, la solution de ce problème se trouve sans doute dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, qui, aux tomes VII (article « Ecole », 1870) et XIII (article « prison », 1875), donne cette citation de Louis Jourdan : « Ouvrir une école aujourd’hui, c’est fermer une prison dans vingt ans. » Larousse n’étant guère avare en citations hugoliennes, il semble bien que Louis-Charles Jourdan (1810-1881), rédacteur au Siècle, soit l’auteur véritable de la formule.
Armand Erchadi, « Retour sur la pensée éducative de Hugo: le pédagogue déguenillé et les enfants d’éléphant », communication au Groupe Hugo du 18 décembre 2010. [Disponible en ligne]
“Open a school and close a prison,” Horace Mann was fond of saying.
Samuel J. Braun & Esther P. Edwards: History and Theory of Early Childhood Education, p. 88. 1972. [Disponible en ligne]
Parents have, perhaps unconsciously, fallen prey to the fallacy propounded by those intelligentsia who, to cover up their own reactionary theories, call themselves “progressives.” This group has led parents to believe that evil, sin and crime are due to ignorance, and that if we educate by imparting knowledge we will abolish crime. Typical of this was Guizot, who when non-religious education began said: “He who opens a school, closes a prison.”
Fulton J. Sheen: Seven Pillars of Peace, p. 80. 1944. [Disponible en ligne]
Un grand orateur a dit, il y a un mois passé, que « chaque fois qu’une école est créée, cela est une prison fermée »
« Encore une prison fermée à Porto-Novo », in Le Phare du Dahomey, 13 mai 1937, p. 1. [Disponible en ligne]
Education is a subject upon which everybody has had—and has—views from the days of John Bright’s famous “Open a school and close a prison”; but the author’s lucid account of the complicated machinery of Local Administration and the thousand and one other problems with which a Permanent Secretary is confronted may make critics of this particular Department at any rate feel that reforms are sometimes easier to advocate than effect.
The Publishers’ Circular and Booksellers’ Record, vol. 126, p. 599. 1927. [Disponible en ligne]
People liked repeating with Jean Macé, the founder of “La Ligue de l’enseignement,” that to open a school was to close a prison.
Paul Bureau: Towards moral bankrupcy, p. 455. London, 1925. [Disponible en ligne]
« Ouvrir une école, c’est fermer une prison », disait et répétait Thiers. On en est revenu, et quelques-uns disent : « Fermer un couvent, c’est ouvrir une prison », en songeant à Clairvaux, à la Santé, à Cherche-Midi, à Saint-Lazare et à la plupart des colonies pénitentiaires.
« En quête d’une conscience », in La Croix, 22 août 1925, p. 5. [Disponible en ligne]
We should like to subscribe to the famous saying of the French stateman, Leon Michel Gambetta: “Every time we open a school we close a prison.”
P. Corbinian: The Laurentianum: Its Origin and Work, 1864-1924, p. 54. 1924. [Disponible en ligne]
 Avez-vous vu le dessin qu’un grand artiste comme Forain a publié dans le Figaro du 21 décembre [1923] pendant le procès Germaine Breton ? [...] D’abord, en haut, à gauche, en manchette, une pensée célèbre dont on connaît surtout la magnifique paraphrase que Victor Hugo en a donnée : « Ouvrir une école, c’est fermer une prison. » (Louis Jourdan)
Avez-vous vu le dessin qu’un grand artiste comme Forain a publié dans le Figaro du 21 décembre [1923] pendant le procès Germaine Breton ? [...] D’abord, en haut, à gauche, en manchette, une pensée célèbre dont on connaît surtout la magnifique paraphrase que Victor Hugo en a donnée : « Ouvrir une école, c’est fermer une prison. » (Louis Jourdan)
Paul Crouzet : « L’Art, diffamateur de l’Ecole », in L’École et la vie, 12 janvier 1924, p. 5. [Disponible en ligne]
Pendant la première période, Victor Hugo avait dit : « Ouvrir une école, c’est fermer une prison ! »
Victor Brudenne : « Un péril pour la race française, un remède pour le conjurer », La Revue, vol. 113, p. 191. 1er – 15 octobre 1915. [Disponible en ligne]
Victor Hugo écrivait : « Toute école qui s’ouvre ferme une prison. »
J. R. : « Sanctions terrestres », in Le Mémorial des Pyrénées. Organe de défense sociale et religieuse, n° 89, 30/3/1914.
Or donc, ces jours derniers, le député Chopinet assistait, à Saintines, à l’inauguration d’une mairie et d’une école et, subitement, il parla. Il se laissa aller, naturellement, à exalter ses sentiments d’anticléricalisme. « Construire une école, dit-il, c’est le meilleur moyen de faire de la bonne défense laïque ! Ouvrir une école, c’est fermer une prison ! Pourquoi donc, les prisons regorgent-elles de jeunes gens ? Dans chaque commune, il y a une lumière : l’instituteur ! et un éteignoir : c’est le curé !
« Un muet qui parle. C’est M. Chopinet, député de l’Oise », in L’Éclair, 20/10/1913, p. 3. [Disponible en ligne]
Jules Ferry disait : « Ouvrir une école c’est fermer une prison. »
« Chronique locale », in Journal du Cher, 24/5/1912, p 2. [Disponible en ligne]
Criminality is not a natural result of illiteracy, since it does not follow that because a person knows how to read and write he is less apt to commit a crime. Such is the opinion of Signor Calojanni, a Sicilian investigator, who has sought to confute the axiom of the jurist Filangieri, that when a school is opened a prison is closed.
The Medical Times, v. 39, October 1911, p. 314. [Disponible en ligne]
It is cheaper to secure public order, respect for property and morality through the school than through the police court. Every time we open a school we close a prison cell. [...] – Mr. J. H. Yoxall, M.P.
J. M. Knight: “IV.–The Right Hon. John Burns, M.P., L.C.C.”, in The Milligate Monthly. A Popular Magazine Devoted to Association, Education, Literature, & General Advancement, vol. 1, no. 4, p. 199. January 1906. [Disponible en ligne]
Lorsque les législateurs, il y a vingt ans, proclamèrent l’instruction publique et obligatoire, ils étaient persuadés avec Condorcet, qu’« une instruction universelle est le seul remède aux maux des hommes », et qu’« ouvrir une école, c’est fermer une prison ».
Une Passante : « L’École où l’on s’amuse », in La Fronde, 3 octobre 1899, p. 1. [Disponible en ligne]
On nous avait dit, il y a vingt ans : Ouvrir une école, c’est fermer une prison.
G. L. : « Pour les écoles libres de Paris », in Le Moniteur universel – Gazette Nationale fondée en 1789, 3 mai 1899, [p. 2].
Mais il fallait aller plus loin. Me Cortichiatto nous demandait de faire de la prison une école. Nous avons réalisé son désir. Je n’irai pas jusqu’à dire avec lui qu’ouvrir une école c’est fermer une prison, car si cet aphorisme était vrai, tous les coupables devraient être illettrés.
Discours de M. Conte, in Discours prononcés à la séance de rentrée tenue en la grand’chambre du conseil du tribunal le 21 janvier 1895, p. 22. [Disponible en ligne]
Ces faits peuvent se multiplier pour confirmer les paroles de Victor Hugo : « Quiconque ouvre une école, ferme une prison. »
Sir John Lubbock : « Discours d’ouverture », in Annales de l’Institut international de sociologie I. Travaux du premier congrès, Paris, 1895.
Rien de plus illusoire que l’adage « Ouvrez une école, vous fermerez une prison ». Peut-être même est-ce le contraire qui serait le plus vrai.
Jules Rochard (dir.) : Encyclopédie d’hygiène et de médecine publique. Tome premier, livre I, p. 297. Paris, 1890.
Sous le gouvernement de Juillet, on fit un pas en avant. Guizot s’était, un jour, écrié à la tribune : « Ouvrir une école aujourd’hui, c’est fermer une prison dans vingt ans. »
Edmond Neukomm : Mœurs et coutumes du bon vieux temps (temps présent, temps passé), p. 34. Paris, 1887.
J.-J. Rousseau écrivait : « Ouvrir des écoles, c’est fermer les prisons, c’est aussi fermer les hospices. » On a modifié cela. Chaque fois que l’on créera une école, il faudra, paraît-il, créer à côté un hospice pour y traiter les jeunes victimes du surménage intellectuel.
L’Abeille des Vosges, p. 2, 14 août 1887. [Disponible en ligne]
C’est encore à un lord, – lord Macaulay, si je ne me trompe, –qu’appartient la paternité de cette autre formule : « Ouvrir une école, c’est fermer une prison. »
Franck d’Avert : « L’École et la nation. Notes sur l’histoire nationale et pédagogique de la Suisse », in Revue internationale de l’enseignement, v. 12, p. 22. 1886. [Disponible en ligne]
Il est à présumer qu’en multipliant les écoles, on arrivera à diminuer le nombre des condamnations judiciaires : ouvrir des écoles, c’est fermer les prisons.
Eugénie Guinault, lauréat de la Société nationale d’Ecouragement [sic] au Bien : « L’influence des établissements philanthropiques sur la moralité du peuple », in Le Phare : autrefois la Prime : revue bi-mensuelle de la littérature, de l’industrie et des beaux-arts, p. 83, 1er janvier 1878.
Samedi, le citoyen Frébault, député de la Seine, a fait, au cercle du quinzième arrondissement, une conférence sur l’instruction publique aux États-Unis. […] Au point de vue moral, ouvrir des écoles, c’est fermer des prisons.
La Lanterne, journal politique quotidien, p. 4, 15 mai 1877.
Ouvrir une école aujourd’hui, c’est fermer une prison dans vingt ans. (L. Jourdan.)
Pierre Larousse : Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, t. 13, p. 169. Paris, 1875. [Disponible en ligne]
M. Louis Blanc vient de publier une remarquable lettre où il proteste contre la prétention étrange de mettre les républicains en dehors des gens de bien. [...] Et s’adressant à M. de Broglie : « Si M. le duc veut dire que nous croyons à la perfectibilité des sociétés comme à celle des individus ; que la société actuelle ne nous paraît pas fermée au progrès ; que nous y voudrions plus d’écoles afin d’y avoir moins de prisons [...]
Pierre Véron : « Bulletin politique », in Le Charivari, 25 juillet 1873, p. 1. [Disponible en ligne]
Un philanthrope anglais a dit ce mot célèbre : « Ouvrez une école, vous fermez une prison. »
Gaston Lavalley : « Une Poignée de vérités »Mémoires de l’Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de Caen, p. 218. 1871. [Disponible en ligne]
Déja, M. Duruy avait posé en fait, qu’ouvrir une école, c’est fermer une prison.
« Chronique économique », in Journal des économistes, t. 45, 1/1/1865, p. 489. [Disponible en ligne]
Ouvrir cent écoles aujourd’hui, c’est fermer dix prisons dans vingt ans.
Louis Jourdan : Le Siècle, 13 octobre 1863, p.1. [Disponible en ligne]
Nous l’avons dit bien des fois : ouvrir une école aujourd’hui, c’est fermer une prison dans vingt ans.
Louis Jourdan : Le Siècle, 8 août 1863, p. 2. [Disponible en ligne]
Jean-Jacques Rousseau disait : « Ouvrir des écoles, c’est fermer des prisons. » M. Jules Lecomte dit que c’est aussi fermer des hospices…
Pierre de l’Estoile : « L’Histoire en pantoufles », in La Presse, 17 mars 1861, p. 2. [Disponible en ligne]
[…] ouvrez des écoles afin de pouvoir diminuer le nombre des prisons […]
Émile Marco de Saint-Hilaire : Histoire des conspirations et des exécutions politiques, t. 4, pp. 128-129. Paris, 1849. [Disponible en ligne]
Je ne dirai pas avec Rousseau : « Souviens-toi, souviens-toi sans cesse que l’ignorance n’a jamais fait de mal, que l’erreur seule est funeste….. » Il suffit de répondre que le nombre des crimes croît en raison de l’ignorance. Mais il est vrai que certains crimes, et les plus dangereux, se multiplient aussi en raison de l’instruction. Je sais le mal de l’ignorance, mais je connais aussi la plaie du faux savoir et du demi-savoir. Oh ! que ce problème est difficile : ouvrir une bonne école, c’est fermer la porte d’une prison et d’un hôpital ; ouvrir une mauvaise école, c’est préparer le vice et l’émeute !
Augustin Cochin : Essai sur la vie, les méthodes d’instruction et d’éducation et les établissements d’Henry Pestallozi, p. 96, 1848. [Disponible en ligne]
Une école de plus, une prison de moins, par M. Houry.
M. Allard : « Livres pour tous les établissements d’instruction primaire », in Recueil méthodique des lois, ordonnances, règlements, arrêtés et instructions, relatifs à l’enseignement, à l’administration et à la comptabilité des écoles normales primaires, p. 270. Paris, 1843. [Disponible en ligne]
 Une école de plus, une prison de moins, ou des Avantages de l’instruction primaire et de la fréquentation des écoles pendant toute l’année
Une école de plus, une prison de moins, ou des Avantages de l’instruction primaire et de la fréquentation des écoles pendant toute l’année
Titre du livre de Louis-Clément Houry, Lons-le-Saunier, 1838. Mémoire primé par la Société d’émulation du Jura. [Disponible à la BnF] [À propos de l’auteur]
Ouvrir des écoles c’est fermer les prisons.
Félix Bogaerts, Pensées et maximes, p. 125. Bruxelles, 1837. [Disponible en ligne]
Grande nouvelle ! éclatante nouvelle ! incroyable nouvelle ! Si elle se confirme, ce sera, dans toute la Belgique, une fête nationale : le canon tonnera de ville en ville, et le carillon volera de clocher en clocher jusque sur les tours de la cathédrale de Bruxelles. Léopold sortira processionnellement de son palais, et marchera de sa personne jusqu’aux portes de sa capitale, suivi d’un brillant cortège. Il y aura, le soir, illumination générale et spectacle gratis. On ouvrira les prisons et on fermera les écoles. Bref, ce sera, dans tous les Pays-Bas, une jubilation universelle et à cette occasion, tous les cœurs seront pleins et tous les pots de bière seront vides.
« Le neuf août a compté la dot de Léopold ? », in Le Charivari, 20 juin 1835, p. 2. [Disponible en ligne]
Quand le plus grand nombre de vos administrés aura reçu l’instruction primaire, il vous sera plus aisé de les gouverner, car alors ils comprendront mieux leurs devoirs aussi bien que leurs droits. Il vous faudra moins de gendarmes, moins de prisons, moins de dépôts de mendicité, car plus l’instruction se répand dans les classes inférieures, plus on voit diminuer la mendicité, les délits et les crimes
Le Patriote, 22 octobre 1831, p. 1. [Disponible en ligne]
Des écoles sont ouvertes pour l’enfant, pour l’adolescent et même pour l’adulte, encore plongé dans l’ignorance ; on attaque le vice sur toutes ses formes, on soulage la misère partout où elle se rencontre ; on sait tirer des châtimens mêmes un moyen de réforme morale, et la prison est transformée en école [...]
« Introduction », in Journal des missions évangéliques, 1 janvier 1826, p 9. [Disponible en ligne]

À ce stade, on concluera que Félix Bogaerts est, à ce jour, le premier auteur documenté (en 1837) de cette formulation concise d’un concept apparemment apparu (au moins) une dizaine d’années plus tôt (1826), selon lequel l’instruction réduirait la criminalité. Aucune preuve ne montre que Guizot l’ait ainsi exprimée en 1832, ni Hugo (avant ou après).
 Cliquer pour agrandir. Sources : Whisk (image), ChatGPT (texte ci-dessous).
Cliquer pour agrandir. Sources : Whisk (image), ChatGPT (texte ci-dessous).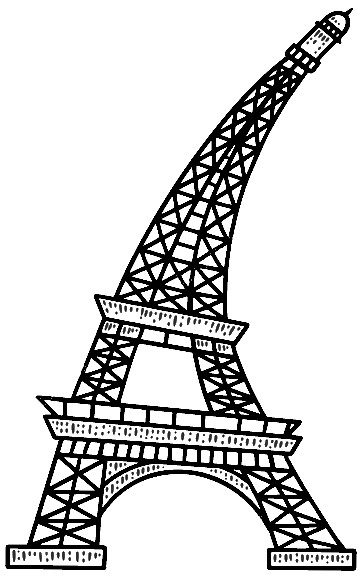 VILLE DE Ԁ∀RIS
VILLE DE Ԁ∀RIS