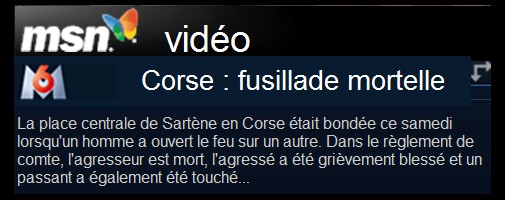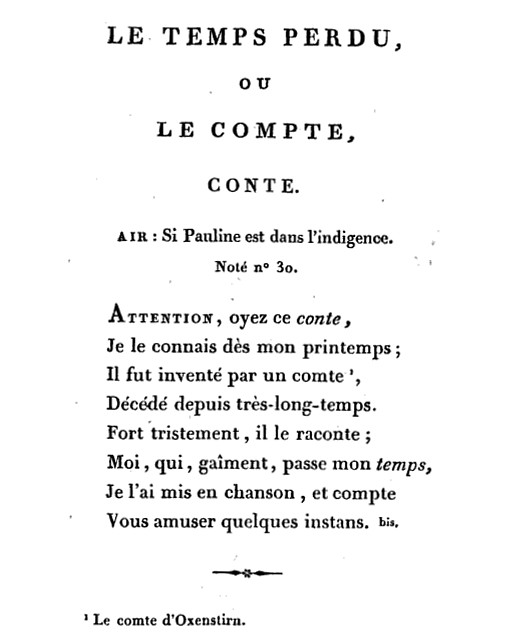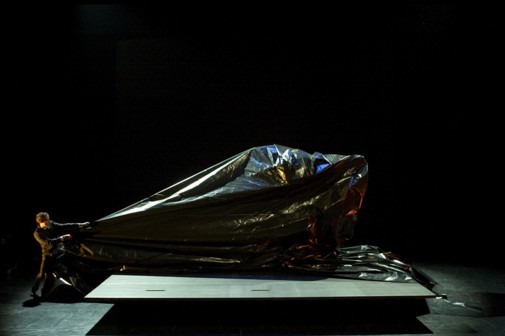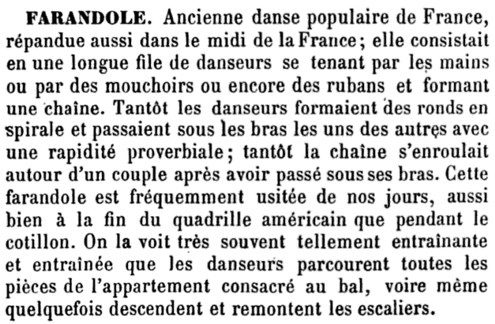Life in Hell: à se tirer une balle dans la tête

Jeff et Akbar arrivent 3/4h en avance (pour Jeff, c’est une performance en soi) pour faire la queue dans le hall du Théâtre de la Ville, au pied des escaliers : les places ne sont pas numérotées.
Quelques minutes plus tard, l’accès est accordé jusqu’aux portes de la salle situées au premier étage, c’est la ruée. Akbar arrive premier devant la porte de droite, la queue se reforme derrière lui (pas dans le même ordre, ce sont les champions de course à pied dans les escaliers qui sont en tête).
Encore quelques minutes plus tard, on les informe que l’entrée, pour ce spectacle, n’aura en fait pas lieu par ces portes-ci mais par celles qui se trouvent quatre étages plus haut, au sommet de l’édifice : c’est le choix du metteur en scène. Le long serpent humain se reconfigure rapidement au pied de la cage d’escalier qui mène au poulailler (même s’il n’y en a plus vraiment). La foule, résignée, amusée, râleuse, française, passe le temps à imaginer ce qui va suivre. Le personnel leur dit seulement que c’est différent. Vraiment différent (entre nous, ils ne savaient pas combien ce serait différent, même s’ils avaient déjà vu ce spectacle la veille).
Enfin, le chemin est libre. Jeff et Akbar, prudents, laissent trois ou quatre personnes les précéder, on ne sait jamais. Arrivés dans la salle, ils sont stupéfaits : il n’y a rien de spécial, à part quelques bouquets d’arbres ici et là, dans les rangées, bien au milieu. Pour la première fois, ils décident donc de ne pas s’asseoir au centre, ces arbres cachant la forêt la scène. Qui, elle, est nue, tapissée de blanc, une haute échelle appuyée contre la paroi de gauche avec, à son sommet, un clavier de synthétiseur, et à droite une enceinte d’une taille qui laisse présager des décibels à outrance. Des projecteurs au ras de la paroi de gauche projettent une lumière qui y dessine des ifs se balançant légèrement au vent. Jeff distingue une odeur d’encens qui remplit graduellement l’espace, Akbar non.
Puis l’attente recommence.
Dix minutes après l’heure annoncée pour le début du spectacle, une voix annonce en français et en anglais qu’il faut évacuer la salle suite à un problème technique, puis une sonnerie stridente, la sirène d’alerte de la salle, se met à retentir. Jeff et Akbar (ainsi que le reste du public) se demandent si cela fait partie du spectacle. Quelques personnes se lèvent et commencent à sortir, puis on les voit revenir, elles sont refoulées par le personnel. Akbar demande à Jeff comment ils feront pour savoir si une alerte est vraie ou non, maintenant. Jeff répond que si la salle brûle, c’est qu’il faut partir. Sinon, ça doit être du spectacle contemporain.
La sirène continue à retentir pendant de longues minutes. Puis s’arrête. Une personne est évacuée suite à un malaise cardiaque, semble-t-il. Ou c’est du spectacle ?
Plus tard, une dame monte sur scène pour dire qu’il s’agit vraiment d’un problème technique (est-ce vraiment vrai ? se demande Akbar italiquement) : pas de contrôle des lumières, pas de son… Ils vont essayer d’y remédier. Elle revient de temps à autre : pas sûr du tout que ça sera réparé, le spectacle ne pourra avoir lieu comme prévu, le chorégraphe discute avec les danseurs pour voir s’ils peuvent improviser quelque chose, merci pour votre patience (laquelle, de patience, hein ? grommelle Akbar).
Le spectacle commence finalement 3/4h après l’heure prévue (et donc, calcule rapidement Jeff, 1h30 après leur arrivée ; comme il n’est censé ne durer qu’une heure, ce n’est pas une utilisation très efficace du temps), mais avec sons et lumières. Les techniciens ont surmonté le défi que la technique leur a lancé, constate Akbar.
Trois hommes en costume noir entrent sur scène un revolver à la main, on dirait des clones de James Bond. Ils se placent devant la grosse enceinte qui diffuse une musique élisabéthaine chantée par un contre-ténor. L’un des hommes fait semblant de la chanter, un autre tient son revolver sur la tempe du premier. Plus tard, d’autres personnes armées entrent sur scène, marchent, s’arrêtent, se couchent, allument des lance-flammes (l’un sert à une femme pour brûler son microphone, heureusement que l’alarme ne se redéclanche pas, murmure Jeff, soulagé, à l’oreille d’Akbar), visent ici et là, actionnent la gâchette à répétition (pas de bol : pas de balles). Un autre homme, un revolver à la main, répète ce qui semble être l’une des deux thèses de ce spectacle, art is business mais business is art. Quelques moments assez esthétiquement beaux, là où un ou plusieurs de ces hommes se figent de profil, un genou à terre,  le bras tendu, le revolver toujours à la main, silhouettes noires sur le fond blanc de la scène, évoquant la célèbre posture favorite de Sean Connery. Mais cela commence à faire procédé.
le bras tendu, le revolver toujours à la main, silhouettes noires sur le fond blanc de la scène, évoquant la célèbre posture favorite de Sean Connery. Mais cela commence à faire procédé.
Ce n’est qu’une demi-heure de non-danse interminable plus tard (donc deux heures après leur arrivée) que les hommes et les femmes qui se jointes à eux commencent à danser. Un homme grimpera à l’échelle pour jouer (fort bien) du synthé. Les pas de deux, de trois ou même de neuf, ne manquent pas d’harmonie, voire de beauté et parfois d’humour, qui l’eut cru ; les revolvers passent parfois de main à main, un avion militaire vole à reculons sur le mur du fond (c’est là sans doute la seconde thèse du spectacle, l’antimilitarisme), les groupes se forment et se déforment, mais c’est trop peu, trop tard. Jeff et Akbar n’attendent que la fin.
Elle arrive : tous les danseurs ont disparu, la musique s’est tue. Le public commence à partir, mais deux danseurs reviennent équipés chacun d’un tréteau sur lequel est posée une machine qui débite un fil de cuivre qui s’entasse au sol. Les deux hommes sortent, Jeff et Akbar aussi. C’était Et je vis l’agneau sur la montagne de Sion du plasticien VA Wölf et de la compagnie Neuer Tanz. Une apocalypse indeed.
Jeff et Akbar sont les personnages d’une série de bandes dessinées de Matt Groening, qui est aussi le père de la fameuse – et infâme – famille Simpson.