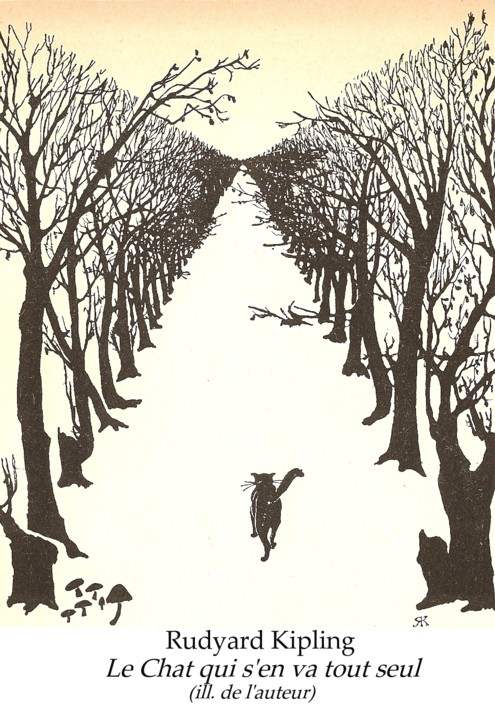A et E étaient un couple parfait. Aux yeux de leurs amis, leur complémentarité était exemplaire. Dix ans après le coup de foudre mutuel qui les avaient frappés au premier moment de leur rencontre fortuite sur le stand de fruits et légumes d’un marché de quartier, leur amour s’était développé sans commune mesure. La passion qui les portait l’un vers l’autre s’était décuplée elle aussi, contrairement à l’idée reçue qui veut qu’elle s’apaise avec les ans.
Ce soir-là, leurs tendres ébats amoureux atteignirent des sommets inouïs, à tel point que leurs corps fusionnèrent. La surprise fut totale : au premier instant, chacun eut l’impression que l’autre s’était instantanément volatilisé. Au moment où E, terrorisé par cette disparition au point le plus exaltant, appela A, il entendit A s’exclamer « mais qu’est-ce qu’il lui arrive ? » et fut saisi de constater que cela venait de sa propre bouche. La confusion était totale. A et E se mirent à s’interpeller, mais leur organe vocal ne faisant plus qu’un avec celui de l’autre, le son qui en sortait ne faisait pas sens.
Il leur fallut plusieurs heures pour se rendre compte qu’il leur suffisait de penser à une phrase pour que l’autre l’entende. Le constat les calma quelque peu, puis les amusa un temps. Ils jouèrent à qui prendrait le contrôle d’un membre ou de l’autre, et firent même un bras de fer avec un seul bras : l’un tentait de le redresser, l’autre de le coucher (ce fut A qui gagna). E avoua à A avoir souvent fantasmé qu’ils ne feraient qu’un. A, plus pragmatique, répondit qu’ils étaient probablement encore loin d’avoir saisi les implications de cet événement. Ils passèrent encore un moment à babiller, tentant d’organiser leur communication silencieuse afin d’éviter de penser en même temps, ce qui avait pour effet de brouiller leurs esprits.
Ils étaient épuisés et allaient finalement s’endormir, ce qu’ils faisaient auparavant presque simultanément. Sauf que dorénavant, E ne pourrait plus se pelotonner dans les bras d’A, et A ne pourrait plus l’encercler dans ses bras protecteurs : ce fut leur premier grand désarroi : en se rapprochant, ils s’étaient aussi perdus. Leurs sommeils furent agités. Les cauchemars habituels d’E envahissaient les rêves plutôt littéraires et calmes d’A, leur corps se tournait d’un côté puis de l’autre comme pour se débarrasser des images contradictoires qui l’envahissaient, mais en vain.
Lorsque le réveil sonna, leur corps commun – appelons-le Æ – se réveilla. Le premier geste qu’il fit – celui que faisaient l’un et l’autre au matin – ce fut de tâter, les yeux fermés, le lit pour trouver l’autre, mais il n’y avait personne à côté, et ce n’était pas parce qu’un besoin urgent l’aurait appelé au petit coin. A et E se souvinrent de ce qui était arrivé la veille. Leur premier désir fut de se contempler : ils tentèrent de se précipiter vers la salle de bain, mais n’avaient encore aucune expérience pour contrôler en commun leurs membres. Ils y arrivèrent tant bien que mal après s’être ramassés plusieurs fois en route (ce qu’A trouva cocasse et E frustrant).
Le miroir leur renvoya l’image d’un inconnu qui avait pourtant quelques traits vaguement familiers. À y bien regarder, c’était un morphing plutôt réussi : des cheveux mordorés légèrement bouclés encadraient un visage sérieux à la peau d’un ton de pêche, illuminé par deux yeux gris pers aux longs cils soyeux, l’un légèrement plus grand que l’autre, ce qui rajoutait une touche de fantaisie à l’ensemble. La bouche fine et sensuelle révélait une belle dentition qui n’avait pourtant pas la perfection irréelle d’une publicité pour dentifrice ; d’ailleurs, il y manquait une des molaires, celle qu’E s’était fait arracher quelques années auparavant. Nous passerons sur d’autres détails trop personnels et plutôt difficiles à décrire, vu la complexité de la situation. Ce séjour dans la salle de bain leur permit aussi de se rendre compte qu’ils n’avaient plus d’espace d’intimité corporelle, ce qui était quelque peu gênant, mais ils durent s’y faire.
Après s’être contemplés et tâtés sous toutes leurs nouvelles coutures, ils gagnèrent la cuisine : Æ criait famine, mais nouveau problème : A prenait en général un café corsé avec une belle omelette aux lardons et quelques pommes de terre sautées, E du thé Earl Grey avec des biscottes au beurre allégé ou parfois un yaourt au lait de brebis. Ils constatèrent qu’ils avaient chacun gardé leur sens personnel du goût et ne savaient comment s’accorder, d’autant plus que si A aurait pu aussi adopter le régime d’E quoiqu’il le trouvât fade, l’idée même d’ingurgiter les plats graisseux dont raffolait A révulsait E. Après un tête-à-tête qui fut bref par nécessité, ils s’accordèrent pour prendre du pain grillé avec du beurre breton demi-sel qu’ils trempèrent dans une tasse de Ricorée, ce qui ne satisfit ni l’un ni l’autre mais rassasia Æ.
L’habillage fut une nouvelle épreuve : comment concilier deux garde-robes si différentes, autant par la style des vêtements que par la différence des carrures et des formes ? Ils optèrent pour du flottant, ce qui laissait une certaine marge et pouvait préserver l’ambiguïté des identités. Il n’était pas question de se rendre au travail : auquel des deux se seraient-ils rendus ? Au cabinet du grand patron de l’industrie qui s’était attaché les services d’E, ou au lycée de zone défavorisée dans lequel A enseignait le français à des élèves qui n’en laissaient pas passer une ? De toute façon, on n’aurait pas laissé entrer Æ, inconnu des deux organismes. Et pour s’y rendre, il aurait fallu affronter le regard inquisiteur de leur concierge, qui n’aurait pas manqué d’interpeller un étranger sortant de l’immeuble qu’elle gardait avec une férocité quasi militaire contre les invasions du monde extérieur.
Ils se sentaient perdus. Avant, quand une situation inédite se présentait à eux, cela se passait ainsi : d’abord, ils se taisaient, A l’ignorant, E somatisant. Puis A, sensible au malaise d’E, prenait la parole, essayait de démonter et de désarmer le sentiment de menace de l’inconnu qui avait saisi E. Ils s’étaient accommodés de ce fonctionnement qui correspondait à leurs natures. Mais ce n’était plus possible : la pensée la plus fugace ou la plus violente de l’un se présentait telle qu’elle, immédiatement, à l’autre. Et quant à leurs subconscients, ils devaient aussi communiquer maintenant mais d’une façon qui n’était évidemment pas perceptible à l’un ou à l’autre. On ne sait trop comment ils arrivèrent à la conclusion que la seule possibilité était de faire appel à leur amie la plus proche, W.
La conversation, qui dura plusieurs heures – W était de celles qui donnent la priorité à l’essentiel : l’amitié, et qui savent reconnaître l’urgence, la vraie – débuta comme on pouvait s’y attendre : avec l’incrédulité totale de leur interlocutrice, qui était habituée aux tours enfantins qu’il arrivait à A de jouer. Mais le désarroi total de la voix et la confirmation de certains détails qu’A ou E étaient seuls à connaître de la vie de W la menèrent progressivement au constat qu’il devait y avoir un élément de vérité dans ce qu’« on » lui racontait – elle n’arrivait pas encore à attacher une identité à la chose qui se trouvait au bout du fil. Elle écouta attentivement, s’évertua à leur faire entendre (ce dont elle n’était pas forcément convaincue pour elle-même) qu’il fallait surtout qu’ils se calment et qu’ils attendent sa venue. Toutes affaires cessantes, elle confia ses quatre chats à une voisine amicale, prit sa cage à serin avec elle et se rendit chez Æ.
Quelques semaines plus tard, Æ s’était constitué, avec l’aide efficace de W, un réseau social restreint mais efficace, composé de certains de leurs « anciennes » connaissances triées sur le volet pour leur délicatesse et de quelques amis d’amis. Il avait encore du mal à décider de ses sorties et de ses voyages : A aimait la musique baroque, la montagne et la course à pied, E les films d’épouvante, la mer et les matches de rugby ; auparavant, s’ils se faisaient des concessions mutuelles, ils pouvaient aussi sortir séparément, mais ce n’était plus le cas. La présence vigilante et discrète de W et des personnes qu’elle avait réunies permettait de mitiger ces différences avant qu’elles ne deviennent des différends qui auraient pu tourner au tragique : souvent, l’activité commune était proposée par l’un d’eux, ce qui permettait à Æ d’accepter sans être vexé.
Au fil du temps, la nouvelle se répandit dans la ville, de cercle en cercle, et finit par atteindre les oreilles grandes ouvertes de certains médias, dont les paparazzi les plus excités se mirent à la recherche d’Æ. Il ne leur fallu pas longtemps pour le trouver, les langues – bonnes comme mauvaises – sont rapides à se délier. Un jour qu’il sortait pour faire ses courses, il se trouva sous les éclairs des flashes d’une multitude d’individus massés devant la porte cochère (la concierge leur en ayant vertement interdit l’entrée), le visage enfoui dans des bouquets de microphones des stations régionales, nationales et mêmes internationales. Avec le recul du temps, cette période fut relativement courte : Æ avait l’air d’un monsieur-tout-le-monde, il n’avait qu’une tête et deux yeux, et après tout, comment accorder du crédit à cette histoire tirée par les cheveux ? Il n’en existait nulle preuve physique, à l’exception du curieux résultat de l’examen de son ADN (nous ne reviendront pas sur les détails de cette histoire dont les journaux avaient tous parlé en son temps). Il retomba bien vite dans un oubli salutaire. Cet épisode lui permit toutefois de se constituer une nouvelle identité et de retrouver un quelconque travail.
Mais c’est sur un aspect bien plus intime que le problème se révéla dans toute son ampleur : ils n’étaient plus capables d’exprimer physiquement l’immense tendresse qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre et l’amour fusionnel qui scellait leur vie, du fait justement de leur fusion. Après bien des hésitations, ils décidèrent finalement d’explorer certains cercles très privés dont ils avaient entendu parler dans les livres de Catherine Millet qu’affectionnait E. Le mélange avec des corps inconnus, pour autant qu’il aurait pu remplir une fonction cliniquement qualifiée d’hygiénique, fut loin de les satisfaire affectivement : la connaissance intime qu’ils avaient eu l’un du corps et de l’âme de l’autre n’avait pas de substitut. Ils en ressortirent dégoûtés. A se souvint alors en frémissant de la tragique fin des Sabines dans la nouvelle éponyme de Marcel Aymé et convainquit E de renoncer à ces pratiques.
Ce fut de nouveau grâce à W que la situation se dénoua, au figuré comme au réel. Adepte de médecines douces et de la nouvelle psychologie, elle fréquentait une échoppe d’un herboriste oriental qui avait toute sa confiance. Celui-ci lui prépara un savant mélange – dont reptiles et insectes étaient exclus pour satisfaire aux exigences d’A – qu’il recommanda de faire infuser et de boire chaque soir avant le sommeil. Le résultat ne tarda pas : un mois plus tard, Æ se réveilla à deux dans le lit. Comme A et E avaient commencé à perdre espoir, il leur fallut un certain temps pour s’habituer à la nouvelle situation et à se refaire une vie, mais ils y arrivèrent. Depuis, ils prennent quelques précautions supplémentaires lors de leurs ébats.