Brève histoire d’un carrefour

Beaubourg (rue) ; elle commence rue Simon-Lefranc, et finit rues Michel-le-Comte et Grenier-Saint-Lazare (…). Cette rue fut ouverte au milieu d’un bourg nommé le Beau-Bourg, renfermé dans Paris par l’enceinte de Philippe-Auguste. Dans l’origine, cette muraille la coupait en deux parties qui communiquaient de l’une à l’autre par une poterne ou porte. La partie renfermée dans la ville s’appelait rue de la Poterne ; celle qui était en dehors portait le nom de rue Outre-la-Poterne-Nicolas-Hydron.
Transnonnain (rue) ; elle commence rues Grenier-Saint-Lazare et Michel-le- Comte, et finit rue au Maire. (…) C’est une des premières rues que l’on ouvrit hors de l’enceinte de Philippe-Auguste. On la nomma d’abord rue de Châlons. Les évêques de cette ville y avaient leur hôtel. Le grand nombre de filles publiques qui habitaient cette rue lui fit donner, par tradition populaire, les noms de Trousse-Nonnains, Trace-put[ain], Tasse-Nonnain, et enfin, Transnonnain. On y remarquait jadis le couvent des Carmélites. Au coin de cette rue et de celle de Montmorency est le théâtre Doyen, le spectacle bourgeois le plus ancien de Paris.
Antony Béraud et P. Dufey, Dictionnaire historique de Paris. À Paris, chez les marchands de nouveautés. 1832.
Nonne, Nonnette, Nonnain. Noms donnés autrefois aux Religieuses, & employés encore dans le style badin.
M. l’Abbé Roubaud, Nouveaux synonymes françois. À Liège. 1786.
Doyen (Théâtre), spectacle de société qui portait le nom de son fondateur. Doyen était un menuisier, qui peu d’années avant la révolution de 1789 fit construire, dans la rue Notre-Dame-de-Nazareth, un petit théâtre, qu’il louait à des amateurs pour des représentations dramatiques. En 1791 il céda sa salle à une entreprise qui voulait en faire un spectacle élémentaire et moral. La troupe était composée de jeunes gens, et l’orchestre formé d’artistes distingués. L’entrepreneur était un ancien officier de cavalerie ; mais la mauvaise gestion de ses deux associés et la pauvreté de son répertoire, dont une mauvaise pièce, intitulée La Boutique du Perruquier, était le chef-d’œuvre, le forcèrent de fermer boutique au bout de deux mois. Doyen reprit sa salle, qu’il agrandit et embellit pour les sociétés particulières. Il procurait des acteurs aux troupes d’amateurs qui n’étaient pas complètes, et au besoin il se chargeait d’un rôle, qu’il jouait toujours très-convenablement. Joignant l’exemple au précepte, il dirigeait les décorations, le jeu scénique, et son expérience était aussi utile que ses talents aux comédiens bourgeois qui venaient s’amuser et s’essayer sur son théâtre. Doyen était justement considéré pour son désintéressement et sa probité. Le prix du loyer de sa salle, y compris l’éclairage et le chauffage, était modique, et supporté par les amateurs, en proportion de l’importance des rôles dont chacun d’eux était chargé. De cette école sont sortis plusieurs bons acteurs et chanteurs pour la tragédie, la comédie et l’opéra. Il suffit de citer Picard, Arnal, etc.
La construction de la synagogue israélite, rue de Nazareth, obligea, vers 1815, Doyen à transporter sa salle rue Transnonain. Il continuait de la louer deux ou trois fois la semaine à des sociétés particulières, lorsqu’un arrêté du ministre Corbière prohiba, en avril 1824, tous les théâtres bourgeois où l’on vendait des billets au profit des amateurs qui y jouaient. Malgré de nombreuses réclamations, l’excellence bretonne ne voulut, dans son entêtement, faire aucune exception en faveur de Doyen. Celui-ci trouva plus d’indulgence en 1828 de la part du cabinet Martignac ; mais l’année suivante, sous le ministre La Bourdonnais, il fut assigné en police correctionnelle comme entrepreneur d’un théâtre sans autorisation. Doyen intéressa ses juges et son auditoire par la franchise de ses réponses et par ses cheveux blancs. Il fut acquitté, et la cour royale confirma ce jugement le 22 octobre suivant. Deux ans après environ, il mourait, plus qu’octogénaire, n’ayant pas eu la douleur de voir sa maison envahie et une partie de sa famille massacrée par suite des événements d’avril 1834. — H. Audiffret.
M. W. Duckett (ed.), Dictionnaire de la conversation et de la lecture, inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous. Paris, 1854.










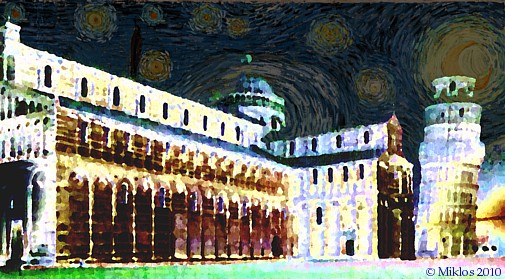
 Câline
Câline
