
Street art.
Cliquer pour agrandir.
«Ce n’est ni à l’élégance ni au confortable qu’est dû l’éclairage des villes, mais au besoin de sécurité et à la nécessité de la police. Le manque de sécurité se fait surtout sentir dans les grandes villes avec leurs faubourgs populeux, et un remède devenait indispensable. Le plus simple que l’on trouva fut de forcer les habitants à placer à certaines heures devant leurs fenêtres des lanternes, c’est-à dire des bougies dans une boîte munie de carreaux en corne transparente. Telle est l’origine de l’éclairage des rues ; elle n’est pas très ancienne, du moins en Europe, »(car on la constate déjà au ve siècle dans les villes Syriennes d’Edesse et d’Antioche) et prit naissance à Paris.
N. H. Schilling, Traité d’éclairage par le gaz. Traduit de l’allemand par Ed. Servier. Paris, 1868.

«La lanterne fut imaginée vers les premiers temps du Moyen âge. C’était une enveloppe de métal, pourvue d’une lame transparente de corne et renfermant une chandelle ou une petite lampe. Les lanternes se fabriquaient chez les peigniers-tabletiers, qui avaient le privilège de travailler la corne.
Les lanternes se portaient à la main. Quelques-unes étaient placées, pendant la nuit, sous une statuette de la Vierge, à la porte de certains couvents. On ne pouvait songer à les placer aux coins des rues, pour dissiper les ténèbres de la nuit, car les voleurs et larrons n’auraient pas tardé à faire disparaître ces indiscrets témoins et dénonciateurs de leurs crimes et méfaits.
 Sous Louis XI, le prévôt avait fait commandement aux Parisiens, par ordre du roi, « d’avoir armures dans leurs maisons, de faire le guet dessus les murailles, de mettre flambeaux ardents et lanternes aux carrefours des rues et aux fenêtres des maisons1. » Mais cette ordonnance était restée sans effet. Quelques promenades du guet, plutôt disposé à demander grâce aux voleurs qu’à les poursuivre, voilà tout ce qu’on faisait, au xviie siècle, pour la sécurité des rues de la capitale pendant la nuit. Quand le couvre-feu était sonné, les détrousseurs étaient les maîtres de la grande ville, les rues devenaient un coupe-gorge, et le guet, se promenant de loin en loin, avec un grand attirail de flambeaux et de hallebardes, n’était bon qu’à avertir les voleurs d’avoir à disparaître pour un moment.
Sous Louis XI, le prévôt avait fait commandement aux Parisiens, par ordre du roi, « d’avoir armures dans leurs maisons, de faire le guet dessus les murailles, de mettre flambeaux ardents et lanternes aux carrefours des rues et aux fenêtres des maisons1. » Mais cette ordonnance était restée sans effet. Quelques promenades du guet, plutôt disposé à demander grâce aux voleurs qu’à les poursuivre, voilà tout ce qu’on faisait, au xviie siècle, pour la sécurité des rues de la capitale pendant la nuit. Quand le couvre-feu était sonné, les détrousseurs étaient les maîtres de la grande ville, les rues devenaient un coupe-gorge, et le guet, se promenant de loin en loin, avec un grand attirail de flambeaux et de hallebardes, n’était bon qu’à avertir les voleurs d’avoir à disparaître pour un moment.
Les récits du temps ont suffisamment fait connaître les dangers que présentaient encore au xviie siècle, dès les premières heures de la soirée, les rues de la capitale, désertes, obscures et infestées de voleurs. Ce n’est pas par une amplification poétique que Boileau a dit, dans sa sixième satire :
Le bois le plus funeste et le moins fréquenté
Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté.
Malheur donc à celui qu’une affaire imprévue
Engage un peu trop tard au détour d’une rue !
Bientôt quatre bandits, lui serrant les cotés :
« La bourse ! il faut se rendre ! »
L’ordre donné, à cette époque, aux directeurs de spectacles publics, d’avoir terminé à quatre heures de l’après-midi leurs représentations, de crainte que les bourgeois ne fussent dévalisés à leur sortie ; — le mot de La Fontaine aux voleurs qui le débarrassaient de son manteau : « Messieurs, vous ouvrez de bonne heure ; » — l’idée plaisante de l’abbé Terrasson, qui datait la décadence des lettres de l’établissement des lanternes, attendu, disait-il, qu’avant cette époque, chacun rentrait de bonne heure, de peur d’être assassiné, ce qui tournait au profit de l’étude : — tout cela prouve bien que les efforts tentés jusqu’au xviie siècle, pour veiller à la sécurité de Paris, étaient demeurés inutiles.
Nous allons donner un précis rapide de l’histoire de l’établissement et des perfectionnements de l’éclairage public à Paris, car c’est la capitale de la France qui donna le signal dus améliorations sous ce rapport, et son exemple fut bientôt suivi dans les autres pays de l’Europe.
Les premiers essais de l’éclairage public commencèrent à Paris en 1524. A cette époque, des bandes incendiaires jetaient le désordre et l’effroi dans plusieurs villes du royaume. Le 24 mai 1524, le tiers de la ville de Meaux avait été détruit par un incendie allumé par des malfaiteurs. C’est pour prévenir ces malheurs qu’un arrêt du parlement de Paris, du 7 juin 1524, ordonna aux bourgeois de cette dernière ville de mettre des lanternes à leur fenêtre, et de tenir chaque soir, près de leur porte, un seau rempli d’eau, afin d’être prêts à toute menace d’incendie.
« Pour éviter, est-il dit dans cet acte, aux périls et inconvénients du feu qui pourraient advenir en celte ville de Paris, et résister aux entreprises et conspirations d’aucuns boutefeux étant ce présents en ce royaume, qui ont conspiré mettre le feu es bonnes villes de cedit royaume, comme ja ils ont fait en aucunes d’icelles villes ; la Cour a ordonné et enjoint derechef à tous les manans et habitans de cette ville, privilégiés et non privilégiés, que par chacun jour ils ayent à faire le guet de nuit… Et outre, icelle Cour enjoint et commande à tous lesdits habitans et chacun d’eulx, qu’ils ayent à mettre à neuf heures du soir à leurs fenestres respondanles sur la rue une lanterne garnie d’une chandelle allumée en la manière accoutumée, et que ung chacun se fournisse d’eaue en sa maison afin de rémédier promptement audit inconvénient, se aucun en survient. »
En 1525, une bande de voleurs appelés mauvais garçons exerçait à Paris des pillages, que l’autorité demeurait impuissante à réprimer. Elle détroussait les passants, battait le guet, volait les bateaux sur la rivière, et, à la faveur de la nuit, se retirait hors de la ville, avec son butin. A ces brigands se joignaient des aventuriers français, des bandes italiennes et corses, troupes mal payées, qui ne vivaient que de vol, et désolaient Paris et ses environs, sans que l’on pût mettre un terme à leurs ravages. Le 24 octobre 1525, le parlement fit publier de nouveau l’ordonnance des lanternes et du guet, « pour les adventuriers, gens vagabonds et sans aveu qui se viennent jeter en cette ville. » Par une nouvelle ordonnance du 16 novembre 1526, il fut enjoint « que, en chacune maison, y eust lanternes et chandelles ardentes comme il fut fait l’an passé, pour éviter aux dangers des mauvais garçons qui courent la nuit par cette ville. » Un lieutenant criminel de robe courte fut institué en même temps, pour juger les coupables pris en flagrant délit.
Malgré l’ordonnance des lanternes, en dépit du lieutenant criminel et de sa robe courte, les mauvais garçons continuèrent à désoler la ville, et l’on dut prendre de nouvelles mesures pour essayer de réprimer ces désordres. Par un arrêt rendu le 29 octobre 1558, la chambre du conseil donna au guet de Paris une organisation nouvelle. On ordonna que dans toutes les rues où le guet était établi, un homme veillerait avec du feu et de la lumière, pour voir et escouter de fois à autre. Il fut en même temps prescrit, qu’au lieu des lanternes que chaque habitant était tenu, avant cette époque, de placer à sa fenêtre, il y aurait au coin de chaque rue, un falot allumé depuis dix heures du soir jusqu’à quatre heures du matin.
Voici le texte de cette nouvelle ordonnance, en date du 29 octobre 1558.
Guet extraordinaire établi par provision et règlement contre les vols de nuit.
« Du samedi 29 octobre. La Chambre ordonnée pour obvier aux larcins, pilleries et voleries nocturnes qui se commettent en celte ville et faux bourgs, a ordonné et ordonne par provision, et jusqu’à ce qu’autrement y soit pourvu que, outre le guet ordinaire, qui a coutume être fait de nuit, en cette dicte ville, se sera encore faict, tant en icelle ville que faux bourgs, autre guet en la forme et manière qui ensuit.
Premièrement, que en chacune rue se fera ledict guet en deux maisons, l’une du côté dextre et l’autre du côté senestre, l’un desdits guets commençant à l’un des bouts de ladite rue et l’autre à l’autre bout d’icelle rue, changera ledict guet chacune nuit selon l’ordre et la situation desdictes maisons et continuera selon le même ordre ; et après que chacun habitant de la maison, tant du côté dextre que du coté senestre, aura fait ou fait faire le guet à son tour, recommencera l’ordre dudict guet, où il aura premièrement commencé.
Ordonne ladite Chambre qu’à la maison où se devra faire le guet, y aura un homme veillant sur la rue, ayant feu et lumière par devers lui, pourvoir et escouter de fois à autre s’il appercevra ou orra aucuns larrons ou volleurs, effracteurs de portes et huis, et à cette fin aura une clochette que l’on puisse voir par toute la rue, et pour d’icelle sonner et éveiller les voisins quand il appercevra ou orra aucuns larrons et volleurs, effracteurs de portes et huis. Et sera tenu, celui qui fera le guet à la maison de l’autre côté de la rue, lui répondre de sa clochette, et ainsi les uns aux autres de rue en rue et de quartier en quartier, affin s’il est possible de surprendre lesdits larrons et volleurs et les mener en justice. A cette fin permet à chacun habitant, à faute, de sergent, les mener en prison ou autres lieux, pour les représenter à justice le lendemain.
Plus ordonne ladicte Chambre que au lieu des lanternes que l’on a ordonné auxdicts habitants mettre aux fenêtres, tant en cette dicte ville que faux bourgs s’y aura au coing de chacune rue ou autre lieu pour commode, un falot ardent depuis les dix heures du soir jusques à quatre heures du matin, et où lesdictes rues seront si longues que ledict fallot ne puisse éclairer d’un bout à l’autre en sera mis un au milieu desdictes rues, et plus souvent la grandeur d’icelles, le tout à telle distance qu’il sera requis et par l’avis des commissaires quarteniers (chefs d’un quartier), dizainiers (chefs de dix maisons) de chacun quartier, appelés avec eux deux bourgeois notables de chacune rue pour adviser aux frais desdicts falots. »
Par un nouvel arrêt du parlement de Paris, rendu quinze jours après, ce règlement fut modifié, et l’on enjoignit de substituer des lanternes aux falots suspendus au coin des rues.
Quatre ans après, sur la réclamation des bourgeois de Paris, la durée de l’éclairage des rues au moyen des lanternes, fut prolongée. Voici le texte de l’arrêt du parlement de Paris qui décide que le temps de l’éclairage des rues sera prolongé, et que les lanternes seront allumées pendant cinq mois et dix jours de l’année, au lieu de quatre mois seulement :
« Du 23 mai 1562. Ce jour, les gens du Roy, M. Hierosme Bignon, advocat dudit seigneur Roy, portant la parole ; ont dit que le lieutenant de police et substitut du procureur général du Roy estoient au parquet des huissiers ; et ayant été faits entrer, et s’estant mis en leurs places ordinaires au premier bureau, debout et couverts, le lieutenant de police a représenté que, depuis quatre années, les rues de cette ville de Paris, ayant été éclairées la nuit pendant quatre mois des hyvers passés, les habitants y avoient trouvé une telle commodité que, toutes les fois qu’elle a cessé, ils n’avoient pu s’empêcher de luy en porter leurs plaintes, et quelques personnes mal intentionnées ayant celte année dans les premières nuits du mois de mars entrepris de troubler la tranquillité publique, ce désordre avoit excité de nouvelles plaintes, et obligé plusieurs bourgeois de demander avec beaucoup d’instance que les rues fussent éclairées plus longtemps, avec offre de fournir à la dépense qui seroit nécessaire Comme ces instances étoient faites au nom des habitans, il avoit cru important de savoir, avant d’en informer la Cour, si ce qui étoit demandé en leur nom étoit également désiré de tous ; et par cet effet, les bourgeois des seize quartiers de Paris, ayant été assemblés chacun dans le leur chez les directeurs et en la présence des commissaires en la manière ordinaire ; après avoir examiné la proposition de continuer d’éclairer plus longtemps les rues de Paris pour la commodité et la sûreté publiques et d’augmenter pour cela les taxes ; ils avoient été d’avis, en dix quartiers, suivant les procès-verbaux, de commencer à l’avenir depuis le 1er octobre jusqu’au 1er avril, et qu’il fust ajouté aux taxes ce qu’il seroit nécessaire pour la dépense des deux mois d’augmentation ; que aux autres six quartiers, cinq d’entre eux avoient estimé que ce seroit assez d’ajouter un mois seulement, et de commencer à mettre les lanternes la nuit dans les rues dès le 15 octobre, au lieu qu’on n’a accoutumé de les mettre que le 1er novembre, et de les continuer jusqu’au 15 mars, au lieu du dernier febvrier. Il auroit été proposé, dans un seul quartier, de ménager quelque chose pendant les clairs de lune des mois de novembre, décembre, janvier, février. Mais comme cet avis étoit unique, et ne sembloit pas assez digne, il n’y avoit plus apparence de s’y arrêter.
La Cour ordonne qu’à l’avenir on commencera d’éclairer les rues dès le 20 octobre, et que l’on continuera jusques aux derniers jours de mars, et que la dépense sera ajoutée aux rôles des taxes qui se levoient auparavant au sel la livre à proportion de ce que chacun en payoit ou devoit pour les quatre mois. »
Mais ces règlements paraissent avoir rencontré des difficultés, qui rendirent leur application impossible. Aussi, pendant le siècle suivant, les Parisiens accueillirent-ils comme une innovation des plus heureuses, la création d’un service public composé d’un certain nombre d’individus, que l’on nommait porte-flambeaux, ou porte-lanternes, et qui se chargeaient, moyennant rétribution, de conduire et d’éclairer par la ville, les personnes obligées de parcourir les rues pendant la nuit.
C’est un certain abbé Laudati, de la noble maison italienne de Caraffa, qui créa cette entreprise, après avoir obtenu du jeune roi Louis XIV, au mois de mars 1662, des lettres patentes qui lui en accordaient le privilège. Le 26 août 1665, le parlement enregistra ces lettres, en réduisant à vingt ans le privilège qui était perpétuel, « aux charges et conditions que tous les flambeaux dont se serviraient les commis seraient de bonne cire jaune, achetés chez les épiciers de la ville, ou par eux fabriqués et marqués des armes de la ville. »
Ces cierges étaient divisés en dix portions, et l’on payait cinq sous chaque portion, pour se faire escorter dans les rues. Les porte-lanternes étaient distribués par stations, éloignées chacune de cent toises ; on payait un sou pour la distance d’un poste à l’autre. Pour se faire éclairer en carrosse, on payait aux porte-lanternes cinq sous par quart d’heure. A pied, on payait seulement trois sous pour se faire escorter le même espace de temps.
A une époque où l’éclairage public était si imparfait encore, l’entreprise de l’abbé Laudati de Caraffa rendit d’incontestables services, en assurant au passant attardé quelque sécurité dans sa marche nocturne. On ne peut, d’ailleurs, tenir le fait en doute, d’après le témoignage d’une personne digne d’être écoutée en pareille matière, le sieur DesternodClaude d’Esternod (ca. 1590 – ca. 1640)., poète gentilhomme, qui avoue avec franchise qu’il avait le projet de voler les passants. « J’aurais, nous dit-il, exécuté ce projet,
« Si l’on ne m’eût cogneu au brillant des lanternes. »
C’est le succès de l’entreprise de Laudati de Caraffa qui amena l’établissement de l’éclairage public de la capitale. Louis XIV, après avoir arrêté l’organisation de la police de Paris, avait créé une charge de lieutenant de police, et appelé La Reynie à ce poste. L’organisation générale de l’éclairage fut un des premiers actes de ce lieutenant de police. Le 2 septembre 1667, date importante à enregistrer, puisqu’il s’agit d’une institution fondamentale dans l’histoire de Paris, on vit paraître l’ordonnance qui prescrivait d’établir des lanternes dans toutes les rues, places et carrefours de la ville. En même temps qu’il inventait l’espionnage, La Reynie instituait l’illumination publique : l’œuvre de civilisation et de progrès peut faire pardonner l’œuvre de délation et de ténèbres.
L’établissement général de l’éclairage fut accueilli, à Paris, comme un bienfait public. La reconnaissance des citoyens fut telle, que l’on fit frapper une médaille pour la consacrer. Cette médaille porte pour légende : Urbis securitas et nitor.
Les poètes ne manquèrent pas de célébrer cette institution nouvelle. Dans ses Rimes redoublées, le sieur d’Assoucy vante les résultats de la mesure établie par le lieutenant de police. Le poète La Monnaie, mort en 1728, a célébré l’établissement des lanternes, par le sonnet suivant, qui ne vaut pas un long poème, mais qui, étant en bouts rimés, a le droit de ne pas être sans défauts :
Des rives de Garonne aux rives du Lignon,
France, par ordre exprès que l’édit articule,
Tu construis des falots d’un ouvrage mignon
Où l’avide fermier peut bien ferrer la mule.
Partout dans les cités, j’en excepte Avignon,
Où ne domine point la royale ferule,
Des verres lumineux, perchés en rang d’oignon,
Te remplacent le jour quand la clarté recule.
Tout s’est exécuté sans bruit, sans lanturlu :
O le charmant spectacle ! En a-t-on jamais lu
Un plus beau dans Cyrus, Pharamond ou Cassandre ?
On dirait que, rangés en tilleuls, en cyprès,
Les astres ont chez toi, France, voulu descendre,
Pour venir contempler tes beautés de plus près.
On plaçait les lanternes aux extrémités et au milieu de chaque rue ; dans les rues d’une certaine longueur, le nombre de ces luminaires était augmenté. On les garnissait de chandelles de suif de quatre à la livre, poids de marc.
Le service et l’entretien de l’éclairage public furent confiés aux bourgeois de chaque quartier, qui étaient tenus d’allumer eux-mêmes les chandelles, aux époques et aux heures fixées par les règlements. On nommait ceux qui étaient chargés de ce soin commis allumeurs ; ils étaient élus chaque année dans une réunion des bourgeois du quartier.
Ces fonctions de commis allumeurs, disons-le en passant, déplaisaient aux bourgeois, dont elles dérangeaient les habitudes ; aussi chacun cherchait-il à se soustraire à cette corvée. Les élections de ces préposés volontaires devenaient, dans beaucoup de quartiers, une occasion de désordres. Les bourgeois anciennement établis se liguaient entre eux, pour faire élire les bourgeois nouveaux venus, et la malheureuse victime de leurs cabales était encore de leur part l’objet d’insultes et de marques de dérision.
Une sentence de police, du 3 septembre 1734, rendue contre quelques bourgeois récalcitrants, fait connaître les abus auxquels donnaient lieu ces élections :
« Plusieurs bourgeois, est-il dit dans cet arrêt, font travestir leurs compagnons et ouvriers en bourgeois, pour augmenter le nombre de voix en faveur de leur parti, et nommer les personnes .nouvellement établies, s’exemptant annuellement, par cette surprise, de faire ce service public. Non contents d’échapper ainsi frauduleusement à ce devoir si essentiel, ils insultent témérairement à ceux qu’ils ont nommés, soit par des chansons injurieuses, soit par un cliquetis de poêles et de chaudrons, soit enfin en leur envoyant par dérision des tambours et des trompettes. »
C’est pour obvier à ces abus que la sentence précédente ordonna qu’à l’avenir, les électeurs désigneraient pour remplir les fonctions d’allumeur public, un des six plus anciens bourgeois demeurant dans chaque circonscription, et qui n’aurait pas encore exercé ; que si lesdits bourgeois ne nommaient pas quelqu’un qui se trouvât dans les conditions prescrites, on y pourvoirait d’office. On choisit, en outre, quelques habitants notables, qui, sous le titre de directeurs, s’assemblaient, avec un commissaire, pour surveiller tout ce qui concernait l’éclairage et le nettoiement des rues. Ces assemblées portaient le nom de directions des quartiers.
L’importance de cette partie de l’administration publique fut promptement comprise : aussi vit-on les principaux magistrats, le chancelier d’Aligre, dans la rue Saint-Victor ; le premier président de Bellièvre, dans le quartier de la Cité ; Nicolaï, premier président en la chambre des comptes, dans le quartier Saint-Antoine, ainsi que les présidents, maîtres des requêtes, conseillers ou avocats généraux du Parlement, de la Chambre des comptes et de la Cour des aides, accepter le titre de chef de ces directions.
Cependant ces sortes d’inspecteurs privés n’exerçaient pas leur surveillance avec une telle rigueur, qu’ils réussissent toujours à empêcher les fraudes de s’introduire dans ce service public. Les bourgeois préposés à l’entretien des lanternes des rues et carrefours, avaient recours à toutes sortes de subterfuges pour s’approprier une partie des chandelles destinées à l’éclairage. De nombreuses sentences de police ont été rendues à ce propos. Desessarts cite, entre autres pièces du même genre, un arrêt porté contre Laurent Feimingre, marchand de vins, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, bourgeois préposé pour allumer toute l’année les quatre lanternes qui étaient placées sous les deux premiers guichets du Louvre. Ce commis allumeur, peu scrupuleux, plaçait dans ses lanternes des chandelles coupées par la moitié, pour s’en approprier le reste :
« De quoi le sieur Pasquier, inspecteur de police, et le sieur Laurent, sergent du guet, faisant ronde avec son escouade audit quartier, s’étant aperçus, ils auraient informé sur-le-champ maître Daminois, commissaire au Châtelet, préposé pour la police du quartier du Palais-Royal, et fait comparoître devant lui la femme dudit sieur Feimingre. »
Et sur l’aveu de la dame du délit dont son époux s’était rendu coupable, ledit époux est condamné à 40 livres d’amende.
Cette économie de bouts de chandelle s’opérait quelquefois par un moyen assez curieux, qui avait quelque chose de scientifique et qui mérite d’être signalée à ce titre. Quand les bourgeois allumeurs, préférant leur profit particulier à l’utilité publique, voulaient faire provision de bouts de chandelle, tout en s’évitant la peine de se lever la nuit, pour aller souffler les lanternes, voici le moyen dont ils faisaient usage. Avec un poinçon chaud, ils perçaient de part en part la chandelle, à l’endroit où ils voulaient la faire éteindre ; ils bouchaient un côté du trou avec du suif, introduisaient quelques gouttes d’eau dans la cavité, qu’ils fermaient ensuite pareillement ; de telle sorte que la goutte d’eau se trouvait, sans qu’il y parût, contenue dans la chandelle. Lorsque la lumière était parvenue au point où la goutte d’eau se trouvait placée, elle ne manquait pas de s’éteindre. Le lendemain, à son lever, le bourgeois faisait sa récolte de bouts de chandelle.
Nous devons la révélation de cette fraude ingénieuse à la sagacité du sieur Moitrel d’Élément, qui nous la dénonce dans sa brochure publiée en 1725, sous ce titre : Nouvelle manière d’éteindre les incendies, avec plusieurs autres inventions utiles à la ville de Paris. Poussant plus loin encore les services qu’il veut rendre à l’édilité parisienne, Moitrel d’Élément, dans son chapitre intitulé : Moyen pour que les chandelles des lanternes restent toujours allumées malgré la pluie, la neige et les grands vents, nous apprend qu’il a découvert le moyen de prévenir ces fraudes coupables ; mais, réflexion faite, il préfère en réserver le secret, de peur que le public n’en abuse.
C’était d’ailleurs un homme fertile en expédients utiles que ce Moitrel d’Élément, et son imagination n’était jamais à bout quand il s’agissait de rendre service à la ville de Paris, dont il avait « l’honneur d’être natif. » Voici la liste abrégée de ses inventions, rapportées à la fin de sa brochure :
1° Nouvelle construction de bornes qui ne rompront point les essieux de carrosses, ni ne pourront les accrocher ;
2° La manière de faire parler les cloches, c’est-à-dire qu’au lieu de les user à incommoder le public, on ne les sonneroit que très-peu, ce qui suffirait pour faire entendre tout ce qu’on voudrait, même le nom de la fête, la qualité de la personne morte, et tous autres sujets pour lesquels on sonne ordinairement ;
3° Moyen sûr pour qu’il n’y ait point de pauvres mendiants dans le royaume, principalement à Paris, et avoir une parfaite connaissance des mauvais pauvres et libertins qui viennent s’y réfugier pour s’abandonner à plusieurs mauvaises choses ;
4° Cadran d’horloge, fort commode et très curieux, pour connaître les heures d’une lieue de loin aux grosses horloges des églises ; d’un bout à l’autre d’une longue galerie aux pendules ordinaires ; et d’un côté à l’autre d’une grande chambre aux montres de poche ; c’est-à-dire qu’on connaîtroît les heures de quatre fois plus loin qu’à l’ordinaire ;
5° Moyen facile et extraordinaire pour raser la montagne qui borne la vue des Tuileries2. »
Jusqu’à la fin du xviie siècle, Paris fut la seule ville de France où il existât un éclairage public ; il fut établi après cette époque, dans les autres villes du royaume. Au mois de juin 1697, un édit royal, « considérant que de tous les embellissements de Paris il n’y en avait aucun dont l’utilité fût plus sensible et mieux reconnue que l’éclairage des rues, ordonne que, dans les principales villes du royaume, pays, terres et seigneuries, dont le choix serait fait par le roi, il serait procédé à l’établissement des lanternes conformément à Paris. » Ces lanternes, comme celles dont la forme venait d’être adoptée à Paris, avaient vingt pouces de haut sur douze de large. Elles renfermaient une chandelle de suif, et étaient posées au milieu des rues, sur un poteau, à une distance de cinq à six toises l’une de l’autre.
L’éclairage public de la capitale demeura à peu près tel que l’avait institué La Reynie, jusqu’à l’année 1758, époque à laquelle le roi ordonna qu’il fût posé des lanternes dans toutes les rues de la ville et faubourgs de Paris où l’on n’en avait pas encore établi. L’arrêt du 9 juillet 1758, qui prescrivit cette mesure, délivra en même temps les bourgeois de l’obligation à laquelle ils étaient assujettis pour l’entretien de l’éclairage : les dépenses de ce service furent portées à la charge de l’État.
 Les réverbères à chandelle que La Reynie avait fait établir dans presque toutes les rues de la capitale, firent fortune. Les bons bourgeois s’amusaient beaucoup à les voir, dès que la sonnette du veilleur en avait donné le signal, s’élever, éclairés d’une grosse chandelle, faisant briller sur leurs parois l’image d’un coq, symbole de la vigilance.
Les réverbères à chandelle que La Reynie avait fait établir dans presque toutes les rues de la capitale, firent fortune. Les bons bourgeois s’amusaient beaucoup à les voir, dès que la sonnette du veilleur en avait donné le signal, s’élever, éclairés d’une grosse chandelle, faisant briller sur leurs parois l’image d’un coq, symbole de la vigilance.
Pourtant l’éclairage des rues n’était pas jugé suffisant par tout le monde, car les éclaireurs publics établis par Laudati de Caraffa fonctionnaient toujours. On trouvait le soir, dans les principales rues, des hommes munis de falots, numérotés comme nos fiacres, et que l’on prenait à l’heure ou à la course, quand on avait à sortir.
L’éclairage de Paris faisait l’admiration des étrangers. Voici ce qu’en disait, en 1700, l’auteur de la Lettre italienne sur Paris, insérée dans le Saint-Evremoniana :
« L’invention d’éclairer Paris, pendant la nuit, par une infinité de lumières, mérite que les peuples les plus éloignés viennent voir ce que les Grecs et les Romains n’ont jamais pensé pour la police de leurs républiques. Les lumières enfermées dans des fanaux de verre suspendus en l’air et à une égale distance sont dans un ordre admirable, et éclairent toute la nuit. Ce spectacle est si beau et si bien entendu qu’Archimède même, s’il vivait encore, ne pourrait rien ajouter de plus agréable et de plus utile. »
Lister, dans la relation de son voyage en France, écrite en 1698, ne le cède pas pour l’admiration à l’enthousiaste Italien ; seulement il la raisonne mieux ; il la justifie par des détails très-précis et très-curieux sur les lanternes :
« Les rues, dit Lister, sont éclairées tout l’hiver et même en pleine lune ; tandis qu’à Londres on a la stupide habitude de supprimer l’éclairage quinze jours par mois, comme si la lune était condamnée à éclairer notre capitale à travers les nuages qui la voilent.
Les lanternes sont suspendues au milieu de la rue à une hauteur de vingt pieds et à vingt pas de distance l’une de l’autre. Le luminaire est enfermé dans une cage de verre de deux pieds de haut, couverte d’une plaque de fer ; et la corde qui les soutient, attachée à une barre de fer, glisse dans sa poulie, comme dans une coulisse scellée dans le mur. Ces lanternes ont des chandelles de quatre à la livre qui durent encore après minuit. Ce mode d’éclairage coûte, dit-on, pour six mois seulement, 50,000 livres sterling (1,500,000 francs). Le bris des lanternes publiques entraîne la peine des galères. J’ai su que trois jeunes gentilshommes, appartenant à de grandes familles, avaient été arrêtés pour ce délit et n’avaient pu être relâchés qu’après une détention de plusieurs mois, grâce aux protecteurs qu’ils avaient à la cour. »
C’étaient donc des chandelles qui garnissaient les quatre splendides fanaux que le duc de La Feuillade avait fait placer autour de la statue de Louis XIV, sur la place des Victoires, et qui lui valurent cette plaisanterie gasconne :
La Feuillade, sandis ! jé crois qué tu mé bernes
D’éclairer le soleil avec quatré lanternes !
Louis XIV, on le sait, avait pris le soleil pour emblème.
Il y avait néanmoins une catégorie d’individus qui ne trouvaient pas leur compte à cette innovation : c’étaient les filous, voleurs et tireurs de laine.
Une pièce de vers, qui courut tout Paris, avait pour titre : Plaintes des filous et écumeurs de bourse à nosseigneurs les réverbères. On nous permettra de citer les premiers vers de ce poème burlesque :
A vos genoux, puissant Mercure,
Tombent vos clients les filous.
Vous, leur patron, souffrirez-vous
Qu’à leur trafic on fasse injure ;
Qu’on éclaire leur moindre allure ;
Enfin qu’un mécanicien,
Au détriment de notre bien,
Ait fait hisser ces réverbères,
Qui n’illuminent que trop bien
L’étranger et le citoyen ;
De la police les cerbères,
Qui ne nous permettent plus rien ?
Grâce à ces limpides lumières,
Qui rendent les âmes si fières,
D’écumer il n’est plus moyen,
Ni la bourse du mauvais riche
A pied qui revient de souper
Où de bons mots il fut plus chiche
Que de manger bien et lamper ;
Ni les poches d’une marchande
Allant le soir, à petit bruit,
Trouver dans un simple réduit
Son grand cousin qui la demande ;
Le gousset garni d’un plaideur,
Descendu nuitamment du coche,
Courant porter au procureur
Ce qu’un écumeur lui décoche ;
La valise d’un bon fermier,
Non celui qui dans un jour gagne
Dix mille écus sur son palier
Et qu’un grand cortège accompagne
(Ne serait-il que financier),
Mais un fermier, loyal rentier,
D’un bon seigneur qui l’indemnise,
S’il a souffert du vent de bise,
A son maître qu’il vient payer
De sa ferme quelque quartier
Qu’un de tes sujets dévalise.
Seigneur Mercure, le métier
Se faisait si bien sans lanternes
Pour notre profit toujours ternes !
D’entre nous, le moindre écolier
Presto savoit s’approprier
Bourse, montre, autres balivernes,
Du cou détacher le collier
Plus… Ah ! maudit réverbérier !
Aujourd’hui c’est toi qui nous bernes.
Il faut que tu sois grand sorcier
Marchand qui perdra ne rira ;
Et qui plus qu’un filou perdra
Dans cet océan de lumière ?
Qui jouera de la gibecière ?
Autant vaudrait à l’Opéra,
Quand du jour le père suprême
Et de Phaéthon le papa,
Son fou de fils émancipa
Sous son lumineux diadème,
Aller sur le théâtre même,
Tout rayonnant de sa splendeur
Filouter Phœbus sur son trône….
Et détacher en écumeur.
Les diamants de sa couronne.
— Mes enfants, quel affreux malheur !
— Mon général, qu’allons-nous faire,
Dit le capitaine Écureuil,
Les réverbères sont l’écueil
De toute affaire solitaire.
Les lanternes pourvues d’une chandelle, qui constituaient l’éclairage des rues, avaient pourtant de graves inconvénients. Le principal était la nécessité de couper, d’heure en heure, la mèche charbonnée et fumeuse, qui ne tardait pas à leur ôter toute clarté.
Les inconvénients attachés à l’usage des chandelles des rues, étaient si nombreux, que l’on ne tarda pas à sentir la nécessité de trouver un autre système. M. de Sartine, lieutenant de police, proposa donc une récompense à celui qui trouverait un moyen nouveau pour éclairer Paris, en réunissant les trois conditions de la facilité dans le service, de l’intensité et de la durée de la lumière. On confia à l’Académie des sciences l’examen des appareils proposés.
Le problème fut résolu par l’invention des réverbères, ou lanternes à huile munies d’un réflecteur métallique. C’est à Bourgeois de Châteaublanc que cette découverte est due. Il la présenta, en 1765, au jugement de l’Académie des sciences, dont elle réunit les suffrages.
 Le célèbre et infortuné chimiste Lavoisier avait pris part à ce concours. Il avait adressé à l’Académie des sciences un mémoire très-remarquable, dans lequel étaient discutées, surtout au point de vue de la physique et de la géométrie, les meilleures dispositions à donner aux réverbères publics, pour produire un éclairage efficace. Le mémoire de Lavoisier Sur les différents moyens qu’on peut employer pour éclairer une grande ville, fut présenté à l’Académie des sciences en 1765, concurremment avec beaucoup d’autres. Les commissaires de l’Académie des sciences, chargés de décerner le prix, jugèrent que la question avait été traitée dans le mémoire de Lavoisier, à un point de vue trop scientifique, trop éloigné des données de la pratique.
Le célèbre et infortuné chimiste Lavoisier avait pris part à ce concours. Il avait adressé à l’Académie des sciences un mémoire très-remarquable, dans lequel étaient discutées, surtout au point de vue de la physique et de la géométrie, les meilleures dispositions à donner aux réverbères publics, pour produire un éclairage efficace. Le mémoire de Lavoisier Sur les différents moyens qu’on peut employer pour éclairer une grande ville, fut présenté à l’Académie des sciences en 1765, concurremment avec beaucoup d’autres. Les commissaires de l’Académie des sciences, chargés de décerner le prix, jugèrent que la question avait été traitée dans le mémoire de Lavoisier, à un point de vue trop scientifique, trop éloigné des données de la pratique.
En conséquence, la récompense proposée fut partagée entre trois concurrents, Bourgeois de Châteaublanc, Bailly et Leroy, qui obtinrent chacun une gratification de 2,000 livres.
Le mémoire de Lavoisier a été imprimé dans le tome III du recueil des Œuvres de Lavoisier, publié en 1855, par le ministère de l’instruction publique, c’est-à-dire aux frais de l’État, sous la direction de M. Dumas. Ce mémoire est accompagné de beaucoup de planches gravées représentant les dispositions que Lavoisier propose de donner aux réverbères. On admire, en parcourant ce travail, le soin avec lequel ce sujet avait été traité par le célèbre chimiste.
Un extrait des registres de l’Académie des sciences, qui fait suite à ce mémoire, dans le recueil des Œuvres de Lavoisier, publié par l’État, nous explique l’origine et le but de ce travail. Voici cet extrait :
« L’Académie avait proposé, en 1764, un prix extraordinaire, dont le sujet était : Le meilleur moyen d’éclairer pendant la nuit les rues d’une grande ville, en combinant ensemble la clarté, la facilité du service et l’économie.
Elle annonça, l’année dernière, que ce prix, proposé par M. de Sartine, conseiller d’État et lieutenant général de police, serait remis à cette année avec un prix double, c’est-à-dire de 2,000 francs.
Aucune des pièces qui avaient été envoyées pour concourir a ce prix n’ayant offert des moyens généralement applicables et qui ne fussent sujets à quelques inconvénients, l’Académie a cru devoir les distinguer en deux classes : les unes remplies de discussions physiques et mathématiques, qui conduisent à différents moyens utiles, dont elles exposent les avantages et les inconvénients ; les autres contenant des tentatives variées et des épreuves assez longtemps continuées pour mettre le public en état de comparer les différents moyens d’éclairer Paris dont on pourra faire usage.
Dans ces circonstances, et de concert avec M. le lieutenant général de police, l’Académie a cru devoir convertir, en faveur de cette dernière classe, le prix de 2,000 francs en trois gratifications, qui ont été accordées aux sieurs Bailly, Bourgeois et Leroy, et distinguer, dans les mémoires de la première classe, la pièce n° 36, qui a pour devise : Signabitque viam flammis dont l’auteur est M. Lavoisier. L’Académie a résolu de publier cette pièce, et M. de Sartine a engagé le roi à gratifier M. Lavoisier d’une médaille d’or, qui lui a été remise par M. le président dans l’assemblée publique du 9 avril de cette année 17663. »
Cependant le lieutenant de police se prononça en faveur du système de Bourgeois de Châteaublanc, et le modèle de réverbère qu’il avait proposé fut adopté pour l’éclairage de la capitale.
Un simple ouvrier vitrier, nommé Goujon, reçut du lieutenant de police 200 livres de récompense. Bourgeois de Châteaublanc, qui avait, comme nous l’avons dit, reçu par décision de l’Académie des sciences, la somme de 2,000 livres, la partagea avec l’abbé Matherot de Preigney, qui l’avait aidé de ses conseils.
Là se bornèrent, d’ailleurs, les récompenses accordées à l’homme utile, à qui la capitale a dû d’être éclairée depuis l’année 1769 jusqu’à l’adoption du gaz. L’entreprise de l’éclairage de Paris fut accordée, en 1769, non à l’inventeur du réverbère, mais à un financier, nommé Tourtille-Segrain. Quant à Bourgeois de Châteaublanc, bien que son nom figure sur le privilège accordé à Tourtille-Segrain, il n’eut aucune part dans les bénéfices. On eut beaucoup de peine à lui faire accorder une modique rente par les entrepreneurs, qui lui contestaient sa découverte. Sa pension ne fut même pas servie avec exactitude, car il avait eu le tort de vivre longtemps.
Le 1er août 1769, Tourtille-Segrain commença l’exploitation de l’éclairage de Paris, qui lui fut concédé par M. de Sartine pour un espace de vingt ans. Les clauses suivantes de la convention proposée par Tourtille-Segrain, et acceptée par le lieutenant de police, font connaître les dispositions des réverbères qui ont été si longtemps en usage pour l’éclairage de Paris et de toutes les autres villes de France :
« La forme des lanternes sera hexagone, la cage sera en fer brasé sans soudures, et montée à vis et écrous.
Celles destinées pour cinq becs de lumière auront deux pieds trois pouces de hauteur, y compris leur chapiteau ; vingt pouces de diamètre par le haut, et dix pouces par le bas.
Celles pour trois et quatre becs de lumière auront deux pieds de hauteur, y compris le chapiteau, dix-huit pouces de diamètre par le haut, et neuf pouces par le bas.
Celles pour deux becs de lumière auront vingt-deux pouces de hauteur, toujours compris le chapiteau, seize pouces de diamètre par le haut et huit pouces par le bas.
Toutes ces lanternes auront chacune trois lampes de différentes grandeurs, à proportion du temps qu’elles devront éclairer.
Chaque bec de lampe aura un réverbère de cuivre argenté mat, de six feuilles d’argent, et chaque lanterne avec un grand réverbère placé horizontalement au-dessus des lumières, lequel entreprendra toute la grandeur de la lanterne, pour dissiper les ombres ; ce réverbère sera également de cuivre argenté mat, de six feuilles d’argent ; tous les réverbères auront un tiers de ligne d’épaisseur. »
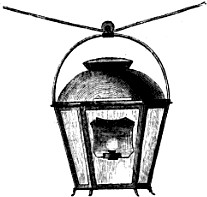 La figure ci-contre représente la lanterne, munie de sa lampe et de son réflecteur, qui fut adoptée à la fin du siècle dernier, pour l’éclairage des rues en France, et qui a été conservée sans aucune modification jusqu’à nos jours.
La figure ci-contre représente la lanterne, munie de sa lampe et de son réflecteur, qui fut adoptée à la fin du siècle dernier, pour l’éclairage des rues en France, et qui a été conservée sans aucune modification jusqu’à nos jours.
L’entreprise de l’illumination de Paris n’était pas la seule dont fût chargé Tourtille-Segrain. Il fournissait à l’éclairage de plusieurs villes du royaume, et ses marchés lui procuraient des bénéfices assez considérables. Le bail de vingt ans, qui lui avait été concédé à Paris par M. de Sartine, fut, quelques années après, prolongé du double.
Après l’innovation provoquée par M. de Sartine, c’est-à-dire les réverbères, ou lampes munies de réflecteurs métalliques, les successeurs de ce lieutenant de police ne parurent rien trouver à y ajouter. On ne peut citer, en effet, comme extension de l’éclairage public à cette époque, que la futilité administrative consistant à placer une lanterne à la fenêtre des commissaires de police de chaque quartier. C’est ce qui amena cette épigramme :
Le commissaire Baliverne,
Aux dépens de qui chacun rit,
N’a de brillant que sa lanterne,
Et de terne que son esprit.
____________________
1. Gilles Corrozet, Antiquités de Paris, p. 224.
2. C’est le même physicien que M. Hœfer, dans son Histoire de la chimie (tome II, page 340), cite comme ayant le premier trouvé le moyen et enseigné la manière de manier les gaz. La petite brochure, aujourd’hui très-rare, dans laquelle Moitrel d’Élément décrit les expériences à faire sur les gaz, ou plutôt sur l’air, a pour titre : La manière de rendre l’air visible et assez sensible pour le mesurer par pintes, ou par telle autre mesure que l’on voudra ; pour faire des jets d’air qui sont aussi visibles que des jets d’eau. »Cette brochure fut réimprimée en 1777, dans la seconde édition, publiée par Gobet dans les Anciens Minéralogistes, de l’ouvrage de Jean Rey sur la pesanteur de l’air.
3. Histoire de l’Académie royale des sciences, 1766, page 165.
Louis Figuier, Les merveilles de la science, ou, Description populaire des inventions humaines. Extrait du premier chapitre. Paris, 1870.

«Le 29 mars 1667, Louis XIV nomma le premier Lieutenant général de police en la ville de Paris, Messire Gabriel-Nicolas, seigneur de La Reynie, Maistre des Requestes. Dès son entrée en fonctions, de La Reynie, d’accord avec Colbert, pensa d’appliquer la seconde partie des projets et travaux exécutés par le Conseil de Police, c’est-à-dire un système d’éclairage vaste et magnifique. Mais il ne put donner une entière exécution à son plan, en raison de la résistance que lui opposèrent les membres du Parlement. Néanmoins, cinq mois environ après sa nomination, le 2 septembre 1667, de La Reynie publiait l’ordonnance qui devait lui attirer l’estime de tout le peuple parisien :
Sur qui a esté remonstré par le Procureur du Roy, que le grand nombre de va- gabonds et voleurs de nuit qui se sont trouvez dans Paris et la quantité de vols et meurtres qui s’y sont faits le soir et la nuit pendant les hyvers des années précédentes, ayant fait rechercher avec soin les moyens de prévenir de tels désordres et ce qui pourrait à l’advenir contribuer à la seureté publique. Il aurait esté remarqué que la plupart desdits vols estoient faits à la faveur de l’obscurité et des ténèbres dans quelques quartiers et rues où il n’y a aucunes lanternes establies, d’autant qu’il importe de remédier à un si grand mal et qu’il est d’une extrême conséquence d’establir dans tous les quartiers et dans toutes les rues de Paris des lanternes pour les éclairer et ce faisant qu’il fut ordonné que dans toutes les rues, places et aultres endroits de la Ville où il n’y a eut jusques à présent de lanternes pendant l’hyver, il en sera mis es endroits les plus commodes et les Propriétaires des maisons tenus chacun de contribuer à la dépense à cet effet nécessaire suivant les roolles qui en seront faits ainsi qu’il se pratique dans les aultres quartiers de la Ville, où il y a des lanternes establies. Et que ceux qui seront tenus d’y mettre des chandelles de « quatre à la livre », de la qualité et aux heures requises par les ordonnances, « mesme pendant le clair de lune », et d’entretenir lesdites lanternes en telle sorte que les chandelles ne soient point éteintes, ains entièrement consumées dans icelles. Le tout à peine d’amende, nous faisant droit sur la remontrance et réquisition du Procureur du Roy. Ordonnons qu’il sera mis à l’advenir des lanternes pendant l’hyver à commencer du dernier jour d’octobre prochain, dans toutes les rues, places et endroits de la Ville et Fauxbourgs où il n’y en a point eu jusques à présent, pour y mettre des chandelles allumées chaque soir, ainsi qu’il est accoutumé dans les aultres quartiers ou il y a des lanternes establies. Qu’à cet effet à la diligence des anciens Commissaires des quartiers tant pour adviser à l’augmentation des lanternes dans les lieux « où il n’y en a pas suffisamment », que pour en mettre dans ceux où il n’y en a point eu jusques à présent d’establies. Comme aussi pour désigner les endroits les plus commodes pour les poser et pour faire les roolles de la cotisation de chacun des contribuables à l’entretenement desdites lanternes. Et en conséquence, ordonnons qu’il sera incessamment procédé en la manière accoustumée à la nomination et élection des personnes capables de prendre le soin de mettre lesdites lanternes et chandelles ; auxquelles enjoignons et à tous autres qui seront ci-après élus pour telle fonction, d’y faire leur devoir et fournir des chandelles de quatre à la livre de la qualité et aux heures portées par les Ordonnances même pendant le clair de Lune, à peine de quarante huit livres parisis d’amende pour la première fois. Et faute par les propriétaires habitans desdits quartiers et rues d’avoir fait les diligences nécessaires pour parvenir dans ledit jour dernier d’Octobre prochain à l’establissement desdites lanternes, seront tenus et contraints jusqu’à ce qu’ils ayent satisfait, de mettre une Lanterne chacun sur sa fenêtre, avec une chandelle allumée pendant le temps que les lanternes seront aussi allumées dans les aultres quartiers de la Ville. Ordonnons aux Commissaires du Chastelet de tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance qui sera lue et publiée et affichée partout ou besoin sera afin que nul n’en ignore. Ce fut fait et ordonné par Messire Gabriel Nicolas de la Reynie, Conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et Privé, Maistre des Requêtes ordinaires de son Hostel et Lieutenant de la Police en la Ville, Prévosté et Vicomté de Paris le 2 Septembre 1667.
Signé : De la Reynie, de Riantz et Coudray, Greffier.
Publié à son de trompe et cri public et affiché par tous les carrefours de cette Ville et fauxbourgs de Paris, par moy Charles Canto, Juré Crieur du Roy en la dite Ville, Prévosté et Vicomté de Paris, accompagné de Hiérosme Tronsson, Juréz Trompettes du Roy, de Pierre du Bos, »Commis de Jean du Bos et de Jean Beauvais, Commis d’Estienne Chappé aussi Juréz Trompettes, le Mercredy 7 Septembre 1667.
Signé : Canto.
Cité par Eugène Defrance, in Histoire de l’éclairage des rues de Paris, Paris, 1904.








 Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. Il a été aplani, rogné, diminué par tous ses abords. Chaque jour, des maisons montent à l’escalade et l’envahissent. Puis, il a perdu une de ses principales curiosités : les carrières, qui ont été comblées. — Elles ouvraient encore, il y a une quinzaine d’années, leurs perspectives mystérieuses ; la plupart offraient des constructions régulières ; les voûtes étaient soutenues par des piliers. On les traversait en tous sens.
Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. Il a été aplani, rogné, diminué par tous ses abords. Chaque jour, des maisons montent à l’escalade et l’envahissent. Puis, il a perdu une de ses principales curiosités : les carrières, qui ont été comblées. — Elles ouvraient encore, il y a une quinzaine d’années, leurs perspectives mystérieuses ; la plupart offraient des constructions régulières ; les voûtes étaient soutenues par des piliers. On les traversait en tous sens. Et c’étaient chaque soir, pendant deux ou trois semaines, sur cette place relativement étroite, un bacchanal, une foule, une démence, des cirques en toile, des dioramas dans des berlines, des tableaux de toute dimension représentant des géantes, des physiciens, le tremblement de terre de la Guadeloupe, le mont Blanc, des oiseaux savants, des albinos, un serpent faisant six fois le tour du corps d’un voyageur, des estrades garnies d’athlètes en brodequins fourrés et de danseuses de corde en jupons à paillettes, des parades à coups de pied, de grosses têtes en carton s’agitant sur des tréteaux, un ouragan de pistons et de clarinettes, des hurlements dans des porte-voix, des réveils de ménagerie et des illuminations soudaines !
Et c’étaient chaque soir, pendant deux ou trois semaines, sur cette place relativement étroite, un bacchanal, une foule, une démence, des cirques en toile, des dioramas dans des berlines, des tableaux de toute dimension représentant des géantes, des physiciens, le tremblement de terre de la Guadeloupe, le mont Blanc, des oiseaux savants, des albinos, un serpent faisant six fois le tour du corps d’un voyageur, des estrades garnies d’athlètes en brodequins fourrés et de danseuses de corde en jupons à paillettes, des parades à coups de pied, de grosses têtes en carton s’agitant sur des tréteaux, un ouragan de pistons et de clarinettes, des hurlements dans des porte-voix, des réveils de ménagerie et des illuminations soudaines ! Le côté vilain de Montmartre, le côté pelé, déchiré, tourmenté, est celui qui commence au Moulin de la Galette, un des derniers moulins dont la hauteur était jadis couronnée. Deux autres ne sont plus que des squelettes de bois pourri. C’est la région des guinguettes, des bals, le dimanche, dans les arrière-boutiques de marchands de vins. La semaine, on n’y rencontre que des terrassiers, occupés auprès des charrettes remplies de gravois. Ces hangars noirs sont des fabriques de bougies, m’a-t-on assuré. J’ai découvert, près de là, un café orné de cette enseigne passablement ambitieuse : Café des Connaisseurs.
Le côté vilain de Montmartre, le côté pelé, déchiré, tourmenté, est celui qui commence au Moulin de la Galette, un des derniers moulins dont la hauteur était jadis couronnée. Deux autres ne sont plus que des squelettes de bois pourri. C’est la région des guinguettes, des bals, le dimanche, dans les arrière-boutiques de marchands de vins. La semaine, on n’y rencontre que des terrassiers, occupés auprès des charrettes remplies de gravois. Ces hangars noirs sont des fabriques de bougies, m’a-t-on assuré. J’ai découvert, près de là, un café orné de cette enseigne passablement ambitieuse : Café des Connaisseurs. 

 Sous Louis XI, le prévôt avait fait commandement aux Parisiens, par ordre du roi, « d’avoir armures dans leurs maisons, de faire le guet dessus les murailles, de mettre flambeaux ardents et lanternes aux carrefours des rues et aux fenêtres des maisons1. » Mais cette ordonnance était restée sans effet. Quelques promenades du guet, plutôt disposé à demander grâce aux voleurs qu’à les poursuivre, voilà tout ce qu’on faisait, au
Sous Louis XI, le prévôt avait fait commandement aux Parisiens, par ordre du roi, « d’avoir armures dans leurs maisons, de faire le guet dessus les murailles, de mettre flambeaux ardents et lanternes aux carrefours des rues et aux fenêtres des maisons1. » Mais cette ordonnance était restée sans effet. Quelques promenades du guet, plutôt disposé à demander grâce aux voleurs qu’à les poursuivre, voilà tout ce qu’on faisait, au  Les réverbères à chandelle que La Reynie avait fait établir dans presque toutes les rues de la capitale, firent fortune. Les bons bourgeois s’amusaient beaucoup à les voir, dès que la sonnette du veilleur en avait donné le signal, s’élever, éclairés d’une grosse chandelle, faisant briller sur leurs parois l’image d’un coq, symbole de la vigilance.
Les réverbères à chandelle que La Reynie avait fait établir dans presque toutes les rues de la capitale, firent fortune. Les bons bourgeois s’amusaient beaucoup à les voir, dès que la sonnette du veilleur en avait donné le signal, s’élever, éclairés d’une grosse chandelle, faisant briller sur leurs parois l’image d’un coq, symbole de la vigilance. Le célèbre et infortuné chimiste Lavoisier avait pris part à ce concours. Il avait adressé à l’Académie des sciences un mémoire très-remarquable, dans lequel étaient discutées, surtout au point de vue de la physique et de la géométrie, les meilleures dispositions à donner aux réverbères publics, pour produire un éclairage efficace. Le mémoire de Lavoisier
Le célèbre et infortuné chimiste Lavoisier avait pris part à ce concours. Il avait adressé à l’Académie des sciences un mémoire très-remarquable, dans lequel étaient discutées, surtout au point de vue de la physique et de la géométrie, les meilleures dispositions à donner aux réverbères publics, pour produire un éclairage efficace. Le mémoire de Lavoisier 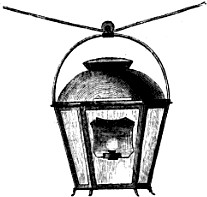 La figure ci-contre représente la lanterne, munie de sa lampe et de son réflecteur, qui fut adoptée à la fin du siècle dernier, pour l’éclairage des rues en France, et qui a été conservée sans aucune modification jusqu’à nos jours.
La figure ci-contre représente la lanterne, munie de sa lampe et de son réflecteur, qui fut adoptée à la fin du siècle dernier, pour l’éclairage des rues en France, et qui a été conservée sans aucune modification jusqu’à nos jours.
