 C’est dans le Livre des Psaumes (139:16) que l’on trouve le premier usages du mot Golem, dans le sens d’embryon, d’ébauche, de masse encore brute mais potentiellement capable de prendre forme et de s’animer. Le Talmud (traité Sanhérin 38b) appliquera ce qualificatif à Adam pendant les douze premières heures de sa vie, lorsqu’il était encore un corps sans âme, et c’est dans le Sefer Yetsirah (Livre de la Création, traité mystique juif datant du iie ou iiie s.) qu’apparaît cette quête de la transmutation de la matière inerte en vivante par l’homme, qui ne cessera plus d’irriguer l’histoire de la pensée philosophique et symbolique, puis de la littérature et des autres arts, et enfin des sciences et des techniques, jusqu’à nos jours : c’est d’abord une interrogation sur le mystère de sa propre création qui se transforme graduellement en une aspiration à étendre son emprise sur le monde par des artifices vivants, des alter ego tout à la fois puissants et obéissants1. Cette instrumentalisation de la curiosité et de la recherche de la connaissance ne rappelle-t-elle pas celle de la génération des hommes de la Tour de Babel qui, voulant voir toujours plus loin en montant plus haut, aspiraient ainsi à égaler le Créateur, voire à le supplanter ?
C’est dans le Livre des Psaumes (139:16) que l’on trouve le premier usages du mot Golem, dans le sens d’embryon, d’ébauche, de masse encore brute mais potentiellement capable de prendre forme et de s’animer. Le Talmud (traité Sanhérin 38b) appliquera ce qualificatif à Adam pendant les douze premières heures de sa vie, lorsqu’il était encore un corps sans âme, et c’est dans le Sefer Yetsirah (Livre de la Création, traité mystique juif datant du iie ou iiie s.) qu’apparaît cette quête de la transmutation de la matière inerte en vivante par l’homme, qui ne cessera plus d’irriguer l’histoire de la pensée philosophique et symbolique, puis de la littérature et des autres arts, et enfin des sciences et des techniques, jusqu’à nos jours : c’est d’abord une interrogation sur le mystère de sa propre création qui se transforme graduellement en une aspiration à étendre son emprise sur le monde par des artifices vivants, des alter ego tout à la fois puissants et obéissants1. Cette instrumentalisation de la curiosité et de la recherche de la connaissance ne rappelle-t-elle pas celle de la génération des hommes de la Tour de Babel qui, voulant voir toujours plus loin en montant plus haut, aspiraient ainsi à égaler le Créateur, voire à le supplanter ?
 Au Moyen Âge, des mystiques juifs utilisent ce terme pour désigner un être vivant créé artificiellement, à l’aide de rituels cabalistiques. C’est dans la France de l’époque des croisades qu’apparaît l’un des tous premiers homoncules : R. Samuel le Cabaliste prétendait en avoir créé un, mais il n’avait pas été capable de lui donner la parole ; cet être le suivait là où il allait, serviteur et garde du corps. Un nombre croissant de textes2 relate des discussions savantes sur la création de ces êtres, et les légendes se répandent, surtout dans le monde judéo-allemand, nourrissant la curiosité et l’intérêt des cabalistes chrétiens. Ainsi, à la fin du xve s., l’un d’eux, l’italien Lodoico Lazzarelli, décrit la création d’un Golem, ce qui sera sans doute la source de la ballade de L’Apprenti sorcier de Goethe (dont s’est inspiré à son tour le compositeur Paul Dukas) puis de Frankenstein de Mary Shelley, illustrant le glissement progressif de la perception de cet être qui, à l’origine, serviteur et aide, devient un monstre menaçant son créateur. Avec l’apparition des automates au xviiie s. puis des robots au xxe s., il symbolisera la crainte de l’emprise croissante et inéluctable du système technicien sur l’homme. Au xxe s., le cinéma s’emparera dès les années 1910 de cette légende pleine de potentiel dramatique, et de nombreux genres littéraires – et notamment la science fiction – ne cesseront d’en utiliser l’imagerie, illustrant ainsi les grandes peurs accompagnant la modernité.
Au Moyen Âge, des mystiques juifs utilisent ce terme pour désigner un être vivant créé artificiellement, à l’aide de rituels cabalistiques. C’est dans la France de l’époque des croisades qu’apparaît l’un des tous premiers homoncules : R. Samuel le Cabaliste prétendait en avoir créé un, mais il n’avait pas été capable de lui donner la parole ; cet être le suivait là où il allait, serviteur et garde du corps. Un nombre croissant de textes2 relate des discussions savantes sur la création de ces êtres, et les légendes se répandent, surtout dans le monde judéo-allemand, nourrissant la curiosité et l’intérêt des cabalistes chrétiens. Ainsi, à la fin du xve s., l’un d’eux, l’italien Lodoico Lazzarelli, décrit la création d’un Golem, ce qui sera sans doute la source de la ballade de L’Apprenti sorcier de Goethe (dont s’est inspiré à son tour le compositeur Paul Dukas) puis de Frankenstein de Mary Shelley, illustrant le glissement progressif de la perception de cet être qui, à l’origine, serviteur et aide, devient un monstre menaçant son créateur. Avec l’apparition des automates au xviiie s. puis des robots au xxe s., il symbolisera la crainte de l’emprise croissante et inéluctable du système technicien sur l’homme. Au xxe s., le cinéma s’emparera dès les années 1910 de cette légende pleine de potentiel dramatique, et de nombreux genres littéraires – et notamment la science fiction – ne cesseront d’en utiliser l’imagerie, illustrant ainsi les grandes peurs accompagnant la modernité.
Le terreau qui a vu naître le Golem est celui où émerge, bien plus tard, la musique klezmer. Terme yiddish issu de l’hébreu, celui-ci signifie, dès ses lointaines origines, « instrument de musique »3. Il viendra à dénoter la musique populaire des « troubadours » juifs d’Europe centrale et orientale, musiciens itinérants se déplaçant seuls ou en petit groupe avec leurs instruments (violon et clarinette, principalement) de communauté en communauté, pour y jouer et chanter ces airs tout à la fois joyeux et tristes, entraînants et mélancoliques, qui reflétaient le quotidien religieux et séculier de ce peuple explosé. Connus de tous, ils étaient repris par l’assistance, fredonnés ou chantés, et souvent dansés. Les mélodies, quant à elles, n’étaient pas étrangères à celles du milieu géographique : c’est ainsi qu’on y trouve des airs qui ne sont pas sans rappeler ceux des tziganes. Cette interpénétration sera d’ailleurs une des sources du renouveau de la musique klezmer à son arrivée aux États-Unis avec les immigrants juifs dès la fin du xixe s. qui se frottera, quelques temps plus tard, au jazz – musique issue d’une autre communauté minoritaire et explosée –, ce qui lui donnera un air plus enlevé et dynamique en y incorporant un swing irrésistible, qui se rajoutera à l’humour typique de cette immigration tout en conservant ses caractéristiques du vieux pays. Ce rapprochement avec les Noirs (que des conflits plus récents ont fait facilement oublier) a donné d’ailleurs un chef d’œuvre dans un autre domaine, celui du cinéma, puisque le tout premier film parlant de l’histoire, Le Chanteur de jazz (1927), relate l’histoire d’un jeune juif issu d’une famille très pratiquante ; ce fils de chantre, se rebellant contre sa tradition, veut devenir chanteur de jazz, et pour réussir à Broadway, il doit se grimer en Noir4. L’arrivée de la musique klezmer aux USA avant la guerre a d’ailleurs été un facteur de vitalité pour elle comme pour ceux qui l’ont amenée avec eux ; si cela n’avait été le cas, la Shoah l’aurait figée dans un éternel souvenir élégiaque et sacralisé. Diffusée à la radio et dans des vaudevilles et des comédies musicales à succès, elle continuera à évoluer après la guerre et jusqu’à nos jours, interprétée, enrichie et transformée par une multiplicité de groupes et d’ensembles ainsi que de labels de disques, du traditionnel au plus radical.
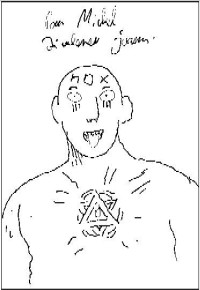 Le dessinateur Joann Sfar s’est approprié le Golem5 et la musique klezmer dans deux séries de bandes dessinées qui en encadrent une troisième, Le Chat du Rabbin. S’ils sont loin d’être la majorité des thèmes sur lesquels porte sa prolifique production, ils reflètent toutefois une partie significative de son identité complexe et la synthèse, parfois difficile, qu’il fait de ces riches éléments : héritage juif sépharade (père juif algérien) et ashkénaze (du côté de sa mère) d’une part6, et pensée et culture occidentales de l’autre (il est titulaire d’une maîtrise de philosophie et ancien élève des Beaux Arts de Paris). Il s’en est récemment expliqué dans un entretien accordé à Télérama et lors d’une soirée à la Maison de la culture yiddish à l’occasion de la sortie de son livre dessiné Klezmer. La Conquête de l’Est, épopée imaginaire et truculente dont le titre est déjà tout un programme qui reflète sa forte conviction pour le cosmopolitisme.
Le dessinateur Joann Sfar s’est approprié le Golem5 et la musique klezmer dans deux séries de bandes dessinées qui en encadrent une troisième, Le Chat du Rabbin. S’ils sont loin d’être la majorité des thèmes sur lesquels porte sa prolifique production, ils reflètent toutefois une partie significative de son identité complexe et la synthèse, parfois difficile, qu’il fait de ces riches éléments : héritage juif sépharade (père juif algérien) et ashkénaze (du côté de sa mère) d’une part6, et pensée et culture occidentales de l’autre (il est titulaire d’une maîtrise de philosophie et ancien élève des Beaux Arts de Paris). Il s’en est récemment expliqué dans un entretien accordé à Télérama et lors d’une soirée à la Maison de la culture yiddish à l’occasion de la sortie de son livre dessiné Klezmer. La Conquête de l’Est, épopée imaginaire et truculente dont le titre est déjà tout un programme qui reflète sa forte conviction pour le cosmopolitisme.
 Curieux avatar de la déterritorialisation, le cosmopolitisme a été l’accusation lancée aux Juifs, peuple sans terre « par excellence » (auquel on a reproché d’en avoir obtenu une, dès que ce fut le cas), et qui a pris forme dans un ouvrage infect inventé par la police secrète russe (et écrit à Paris) pour inciter le Tsar à se retourner contre eux, Les Protocoles des Sages de Sion, qui serait un plan secret des Juifs pour prendre le pouvoir mondial. Ce texte n’est qu’un plagiat d’un pamphlet écrit par Maurice Joly contre Napoléon III, Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, ou La politique de Machiavel au xixe siècle, par un contemporain. X-Files avant l’heure, cet ouvrage est régulièrement imprimé et diffusé dans le monde de l’internationale antisémite. Un autre dessinateur, le génial Will Eisner, a réalisé peu avant sa mort un ouvrage en bandes dessinées qui en relate les avatars7. Comme l’écrit l’essayiste Cynthia Ozick sur la quatrième de couverture,
Curieux avatar de la déterritorialisation, le cosmopolitisme a été l’accusation lancée aux Juifs, peuple sans terre « par excellence » (auquel on a reproché d’en avoir obtenu une, dès que ce fut le cas), et qui a pris forme dans un ouvrage infect inventé par la police secrète russe (et écrit à Paris) pour inciter le Tsar à se retourner contre eux, Les Protocoles des Sages de Sion, qui serait un plan secret des Juifs pour prendre le pouvoir mondial. Ce texte n’est qu’un plagiat d’un pamphlet écrit par Maurice Joly contre Napoléon III, Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, ou La politique de Machiavel au xixe siècle, par un contemporain. X-Files avant l’heure, cet ouvrage est régulièrement imprimé et diffusé dans le monde de l’internationale antisémite. Un autre dessinateur, le génial Will Eisner, a réalisé peu avant sa mort un ouvrage en bandes dessinées qui en relate les avatars7. Comme l’écrit l’essayiste Cynthia Ozick sur la quatrième de couverture,
« Il se pourrait que Le Complot soit aux Protocoles ce que Maus fut à l’Holocauste : un moyen de diffuser la vérité auprès d’un large public. La puissance artistique du livre et l’aspect saisissant du récit, conçu pour dénoncer, une fois pour toutes, ce mensonge qui a répandu son venin de par le monde, font d’Eisner le véritable super-héros de notre époque ».
Époque qui, soit dit en passant, s’accommode encore mieux de la rumeur et de la supercherie, même lorsque celles-ci ont été démontées. Il y aura toujours des gens convaincus que la terre est plate.
 Le plaidoyer de Sfar pour le cosmopolitisme, un cosmopolitisme ancré dans une identité, n’est pas sans me rappeler l’ouvrage de Dominique Wolton, L’autre mondialisation (Flammarion, 2003) dans lequel ce spécialiste des nouveaux médias et de la communication analyse leur impact sur notre exposition illimitée aux cultures du monde, et à la nécessite d’une réflexion sur la cohabitation culturelle et à son réancrage dans le physique (par contraste au virtuel) et dans le temps (par contraste à l’instantané), enjeux citoyen et politique de première importance qu’on tend à éluder avec les conséquences qu’on a vues encore récemment. La dispersion de l’homme sur la face de la terre depuis le big bang de la Tour de Babel, n’a pas fini de bouleverser nos vies.
Le plaidoyer de Sfar pour le cosmopolitisme, un cosmopolitisme ancré dans une identité, n’est pas sans me rappeler l’ouvrage de Dominique Wolton, L’autre mondialisation (Flammarion, 2003) dans lequel ce spécialiste des nouveaux médias et de la communication analyse leur impact sur notre exposition illimitée aux cultures du monde, et à la nécessite d’une réflexion sur la cohabitation culturelle et à son réancrage dans le physique (par contraste au virtuel) et dans le temps (par contraste à l’instantané), enjeux citoyen et politique de première importance qu’on tend à éluder avec les conséquences qu’on a vues encore récemment. La dispersion de l’homme sur la face de la terre depuis le big bang de la Tour de Babel, n’a pas fini de bouleverser nos vies.
1 Et qui n’est pas étrangère à la quête des alchimistes de transformer une matière vile en or, autre source de pouvoir.
2 L’un des plus célèbres est celui attribué au R. Loeb de Prague (dont j’ai parlé précédemment).
3 Zimra (fém. de zemer) dénote dans le Livre des Chroniques le « chant », produit souvent par la voix, mais parfois uniquement par des instruments, tels que la lyre, le violon ou le tambourin. Quant à l’expression, c’est un proche synonyme, kli shir (shir est la voix chantée), qui y est mentionnée.
4 Chemin qu’un Michael Jackson a voulu suivre à l’inverse…
5 J’en ai parlé précédemment.
6 Si on attend d’un dessinateur qu’il s’exprime surtout par le trait, Sfar n’a pas la langue dans sa poche : discours vif et construit, politique avant tout, émaillé plus souvent de citations de grands philosophes que de textes juifs, semblant finalement refléter une meilleure connaissance des premiers que les seconds dont il avait entendu parler de seconde main, en quelque sorte, par son grand-père. Ceci se reflète d’ailleurs dans Klezmer où les archétypes ashkénazes ont un curieux air sépharade (comportement, langue) qui ne me semble pas être uniquement le fait d’un choix conscient de leur créateur.
7 Will Eisner : Le Complot. L’histoire secrète des Protocoles des Sages de Sion, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, introduction de Umberto Eco. Grasset.
 Enfin, ce n’étaient pas exactement des pigeons. Ils étaient tous deux du sexe fort. L’amour les saisit dans la nature, et ils s’aimèrent durant de longues années, envers et contre tout. Jusqu’à ce que l’un des deux se trouva une compagne. L’autre tomba en dépression. Finalement, il se maria, lui aussi.
Enfin, ce n’étaient pas exactement des pigeons. Ils étaient tous deux du sexe fort. L’amour les saisit dans la nature, et ils s’aimèrent durant de longues années, envers et contre tout. Jusqu’à ce que l’un des deux se trouva une compagne. L’autre tomba en dépression. Finalement, il se maria, lui aussi. Quant aux deux cowboys du film en question, la situation et son développement sont, somme toute, convenus. Ce qui en fait surtout l’originalité est le genre – le « grand » cinéma genre Hollywood – et donc son circuit de diffusion et sa visibilité. Heath Ledger joue le rôle d’un cowboy de peu de mots et mal à l’aise avec la parole, surtout au début, mais c’est son jeu que je trouve laborieux et peu convainquant. Le vrai héros du film est finalement la nature, presque inhumaine dans son immensité et sa beauté grandioses, monde en marge du monde, paradis sur terre d’où le couple sera chassé vers la réalité.
Quant aux deux cowboys du film en question, la situation et son développement sont, somme toute, convenus. Ce qui en fait surtout l’originalité est le genre – le « grand » cinéma genre Hollywood – et donc son circuit de diffusion et sa visibilité. Heath Ledger joue le rôle d’un cowboy de peu de mots et mal à l’aise avec la parole, surtout au début, mais c’est son jeu que je trouve laborieux et peu convainquant. Le vrai héros du film est finalement la nature, presque inhumaine dans son immensité et sa beauté grandioses, monde en marge du monde, paradis sur terre d’où le couple sera chassé vers la réalité. C’est aussi un homme « nature » et de peu de paroles, le trappeur Jed Cooper, que joue Victor Mature dans The Last Frontier (La Charge des tuniques bleues). Cet excellent film d’Anthony Mann, datant de 1955, vient d’être montré sur le splendide écran de la Cinémathèque française (dans le cadre d’une rétrospective) dans une version très bien restaurée. Quel jeu que celui de Cooper ! Ici aussi, il s’agit d’un homme pris dans ses contradictions – entre son besoin de solitude et l’appel de la nature, d’une part, et le sort qui le place dans un milieu antithétique, celui de l’armée, de ses règles et de sa hiérarchie, d’autre part. Ce personnage est loin d’être unidimensionnel et fait montre de profondeur, d’humour et de sentiments tout en se débattant dans un réseau complexe de circonstances historiques et sociales auquel sont convoqués des personnages de tragédie grecque : le Colonel (Robert Preston), d’une rigidité inhumaine et mortifère qui dissimule mal son sentiment d’infériorité et d’inadéquation ; sa femme (Anne Bancroft, récemment décédée), d’un excellent milieu, qui, après avoir aimé son mari malgré tout, en méprise la dure faiblesse et tombe amoureuse du trappeur qui s’humanise à son contact ; le jeune et beau Capitaine (Guy Madison), qu’on aurait pu croire destiné par des conventions de casting à convoler, tel un jeune premier, avec la toute aussi jeune et belle Colonelle, mais que nenni : il représentera l’honneur de l’armée et son humanité. Ce sont les Indiens dépossédés feront les frais de l’utopie américaine.
C’est aussi un homme « nature » et de peu de paroles, le trappeur Jed Cooper, que joue Victor Mature dans The Last Frontier (La Charge des tuniques bleues). Cet excellent film d’Anthony Mann, datant de 1955, vient d’être montré sur le splendide écran de la Cinémathèque française (dans le cadre d’une rétrospective) dans une version très bien restaurée. Quel jeu que celui de Cooper ! Ici aussi, il s’agit d’un homme pris dans ses contradictions – entre son besoin de solitude et l’appel de la nature, d’une part, et le sort qui le place dans un milieu antithétique, celui de l’armée, de ses règles et de sa hiérarchie, d’autre part. Ce personnage est loin d’être unidimensionnel et fait montre de profondeur, d’humour et de sentiments tout en se débattant dans un réseau complexe de circonstances historiques et sociales auquel sont convoqués des personnages de tragédie grecque : le Colonel (Robert Preston), d’une rigidité inhumaine et mortifère qui dissimule mal son sentiment d’infériorité et d’inadéquation ; sa femme (Anne Bancroft, récemment décédée), d’un excellent milieu, qui, après avoir aimé son mari malgré tout, en méprise la dure faiblesse et tombe amoureuse du trappeur qui s’humanise à son contact ; le jeune et beau Capitaine (Guy Madison), qu’on aurait pu croire destiné par des conventions de casting à convoler, tel un jeune premier, avec la toute aussi jeune et belle Colonelle, mais que nenni : il représentera l’honneur de l’armée et son humanité. Ce sont les Indiens dépossédés feront les frais de l’utopie américaine. C’est dans le Livre des Psaumes (139:16) que l’on trouve le premier usages du mot Golem, dans le sens d’embryon, d’ébauche, de masse encore brute mais potentiellement capable de prendre forme et de s’animer. Le Talmud (traité Sanhérin 38b) appliquera ce qualificatif à Adam pendant les douze premières heures de sa vie, lorsqu’il était encore un corps sans âme, et c’est dans le Sefer Yetsirah (Livre de la Création, traité mystique juif datant du
C’est dans le Livre des Psaumes (139:16) que l’on trouve le premier usages du mot Golem, dans le sens d’embryon, d’ébauche, de masse encore brute mais potentiellement capable de prendre forme et de s’animer. Le Talmud (traité Sanhérin 38b) appliquera ce qualificatif à Adam pendant les douze premières heures de sa vie, lorsqu’il était encore un corps sans âme, et c’est dans le Sefer Yetsirah (Livre de la Création, traité mystique juif datant du  Au Moyen Âge, des mystiques juifs utilisent ce terme pour désigner un être vivant créé artificiellement, à l’aide de rituels cabalistiques. C’est dans la France de l’époque des croisades qu’apparaît l’un des tous premiers homoncules : R. Samuel le Cabaliste prétendait en avoir créé un, mais il n’avait pas été capable de lui donner la parole ; cet être le suivait là où il allait, serviteur et garde du corps. Un nombre croissant de textes
Au Moyen Âge, des mystiques juifs utilisent ce terme pour désigner un être vivant créé artificiellement, à l’aide de rituels cabalistiques. C’est dans la France de l’époque des croisades qu’apparaît l’un des tous premiers homoncules : R. Samuel le Cabaliste prétendait en avoir créé un, mais il n’avait pas été capable de lui donner la parole ; cet être le suivait là où il allait, serviteur et garde du corps. Un nombre croissant de textes Le plaidoyer de Sfar pour le cosmopolitisme, un cosmopolitisme ancré dans une identité, n’est pas sans me rappeler l’ouvrage de Dominique Wolton, L’autre mondialisation (Flammarion, 2003) dans lequel ce spécialiste des nouveaux médias et de la communication analyse leur impact sur notre exposition illimitée aux cultures du monde, et à la nécessite d’une réflexion sur la cohabitation culturelle et à son réancrage dans le physique (par contraste au virtuel) et dans le temps (par contraste à l’instantané), enjeux citoyen et politique de première importance qu’on tend à éluder avec les conséquences qu’on a vues encore récemment. La dispersion de l’homme sur la face de la terre depuis le big bang de la
Le plaidoyer de Sfar pour le cosmopolitisme, un cosmopolitisme ancré dans une identité, n’est pas sans me rappeler l’ouvrage de Dominique Wolton, L’autre mondialisation (Flammarion, 2003) dans lequel ce spécialiste des nouveaux médias et de la communication analyse leur impact sur notre exposition illimitée aux cultures du monde, et à la nécessite d’une réflexion sur la cohabitation culturelle et à son réancrage dans le physique (par contraste au virtuel) et dans le temps (par contraste à l’instantané), enjeux citoyen et politique de première importance qu’on tend à éluder avec les conséquences qu’on a vues encore récemment. La dispersion de l’homme sur la face de la terre depuis le big bang de la  J’étais encore un adolescent romantique vivant à l’étranger quand j’ai vu Belle de Jour de Luis Buñuel. Je ne me souviens que de Catherine Deneuve, de l’effet qu’elle m’a fait alors : celui d’un glaçon brûlant et d’une perfection dépravée, celui d’un secret insondable et d’un mystère noir. Sous son halo blond cendré, je devinais Lilith. Ce n’est que bien des années plus tard que je réalisai que derrière cette « beauté façonnée de mystères nombreux (…) elle était simplement, pour sa part, un sphinx sans secret »1. Puis il me sembla percevoir un côté dur et impatient, hautain voire méprisant. J’étais tombé en désamour.
J’étais encore un adolescent romantique vivant à l’étranger quand j’ai vu Belle de Jour de Luis Buñuel. Je ne me souviens que de Catherine Deneuve, de l’effet qu’elle m’a fait alors : celui d’un glaçon brûlant et d’une perfection dépravée, celui d’un secret insondable et d’un mystère noir. Sous son halo blond cendré, je devinais Lilith. Ce n’est que bien des années plus tard que je réalisai que derrière cette « beauté façonnée de mystères nombreux (…) elle était simplement, pour sa part, un sphinx sans secret »1. Puis il me sembla percevoir un côté dur et impatient, hautain voire méprisant. J’étais tombé en désamour. Si Geneviève la brune se prend pour Catherine Deneuve, dans la pièce de théâtre
Si Geneviève la brune se prend pour Catherine Deneuve, dans la pièce de théâtre 
