Quand la BnF se confie à Google
Il ne faudrait pas un mauvais procès à notre Bibliothèque nationale en prétendant qu’elle ne fait que défier l’Aspirateur géant de l’information (« de toute l’information ») tant aimé (par) ailleurs ou partout. Elle en fait aussi usage pour indexer les pages de la bibliographie nationale française qui ne propose malheureusement pas de recherche par champs indexés : comment faire pour y trouver aisément la date de la première édition d’un titre particulier – en l’occurrence Les Racines du ciel, de Romain Gary, récemment cité ? Il faut alors se rabattre sur le catalogue de la BnF, et y rechercher l’ouvrage ; on trouve trois notices pour « Les Racines du ciel », dont la plus ancienne remonte à 1972, tandis que sous « Les Racines du ciel, roman » se trouvent trois autres notices dont deux remontent à 1956.
 Puisqu’on évoque les moteurs, il ne faut pas ignorer l’existence du nouveau bolide français, Exalead, qui tente de sortir1 de sa chrysalide. Celui-ci se qualifie sur son blog comme « l’autre moteur de recherche » dans un style résolument djeun’. Dans un style plus sobre, il annonce sur son serveur corporate que « l’ambition d’Exalead n’est pas de “gagner” la compétition contre Google, mais d’offrir une alternative crédible, offrant un service de qualité équivalente ou meilleure pour l’ensemble de la problématique “search”, et de se positionner les cinq meilleurs moteurs de recherche mondiaux. » (sic). Une des fonctionnalités très utiles qu’il propose (et que l’on retrouve dans Europeana, le prototype de bibliothèque numérique européenne proposé par la BnF) est la possibilité de préciser la recherche après réception d’une liste de réponses (ce qu’ils appellent « la zapette thématique ») : par termes associés (ce n’est pas nouveau en soi – on le trouvait dans l’ancien Altavista2 – mais fort utile, et absent dans les principaux moteurs), par type de site (avec recherche limitée aux blogs, par exemple), par type de document multimédia, par langue… Ce type de recherche par affinages successifs est, pour certains, plus utile qu’une « recherche avancée » initiale, puisqu’il fait remonter des catégories dans les réponses trouvées, auxquelles on n’aurait pas forcément pensé.
Puisqu’on évoque les moteurs, il ne faut pas ignorer l’existence du nouveau bolide français, Exalead, qui tente de sortir1 de sa chrysalide. Celui-ci se qualifie sur son blog comme « l’autre moteur de recherche » dans un style résolument djeun’. Dans un style plus sobre, il annonce sur son serveur corporate que « l’ambition d’Exalead n’est pas de “gagner” la compétition contre Google, mais d’offrir une alternative crédible, offrant un service de qualité équivalente ou meilleure pour l’ensemble de la problématique “search”, et de se positionner les cinq meilleurs moteurs de recherche mondiaux. » (sic). Une des fonctionnalités très utiles qu’il propose (et que l’on retrouve dans Europeana, le prototype de bibliothèque numérique européenne proposé par la BnF) est la possibilité de préciser la recherche après réception d’une liste de réponses (ce qu’ils appellent « la zapette thématique ») : par termes associés (ce n’est pas nouveau en soi – on le trouvait dans l’ancien Altavista2 – mais fort utile, et absent dans les principaux moteurs), par type de site (avec recherche limitée aux blogs, par exemple), par type de document multimédia, par langue… Ce type de recherche par affinages successifs est, pour certains, plus utile qu’une « recherche avancée » initiale, puisqu’il fait remonter des catégories dans les réponses trouvées, auxquelles on n’aurait pas forcément pensé.
 Exalead vient de rajouter une autre fonctionnalité intéressante à la recherche d’images, celle permettant de limiter les réponses uniquement aux visages. La recherche par contenu significatif dans le multimédia (images fixes ou animées, documents sonores – paroles ou musique) pour le grand public est un défi qui, une fois relevé, fera date dans le développement des moteurs de recherche : qui n’a cherché à identifier une photo (celle d’un tableau ou d’une personne, par exemple), à trouver une image qui ressemble à une autre, ou qui contient des éléments (objets, personnes, paysages, scènes…) qui ne sont pas forcément décrits dans le texte l’accompagnant ? Même si des recherches très savantes sont effectuées depuis longtemps pour l’analyse sémantique des contenus (que ce soit des images fixes, des vidéos ou de la musique, par exemple), elles ne sont pas encore disponibles pour le grand public3, et loin d’être intégrées dans les moteurs de recherche. Il n’est donc pas étonnant qu’Exalead tente de le relever, dans le cadre du projet Quaero dont le partenaire allemand s’est retiré fin 2006. Est-il encore temps ? Ils ne sont pas les seuls.
Exalead vient de rajouter une autre fonctionnalité intéressante à la recherche d’images, celle permettant de limiter les réponses uniquement aux visages. La recherche par contenu significatif dans le multimédia (images fixes ou animées, documents sonores – paroles ou musique) pour le grand public est un défi qui, une fois relevé, fera date dans le développement des moteurs de recherche : qui n’a cherché à identifier une photo (celle d’un tableau ou d’une personne, par exemple), à trouver une image qui ressemble à une autre, ou qui contient des éléments (objets, personnes, paysages, scènes…) qui ne sont pas forcément décrits dans le texte l’accompagnant ? Même si des recherches très savantes sont effectuées depuis longtemps pour l’analyse sémantique des contenus (que ce soit des images fixes, des vidéos ou de la musique, par exemple), elles ne sont pas encore disponibles pour le grand public3, et loin d’être intégrées dans les moteurs de recherche. Il n’est donc pas étonnant qu’Exalead tente de le relever, dans le cadre du projet Quaero dont le partenaire allemand s’est retiré fin 2006. Est-il encore temps ? Ils ne sont pas les seuls.
 Enfin, un autre moteur qui a du mal à s’imposer est Live de Microsoft, qui vient de perdre sa place de « première marque de la planète » au profit de Google. Pourtant, il innove certainement de son côté : utilisant de nouvelles techniques d’interface, sa recherche d’images fournit une « page continue » de réponses : il n’est plus nécessaire de passer de page à page, il suffit de parcourir l’unique page des vignettes à l’aide de l’ascenseur ; il n’est plus nécessaire de cliquer sur une vignette pour obtenir des informations à son sujet (taille, site, commentaires…), il suffit de l’effleurer avec la souris. Cette présentation est bien plus efficace que celles des concurrents : d’un coup d’œil, on localise les images potentiellement intéressantes – aucun texte n’intervenant entre elles ; puis on vérifie ce qui pourrait être pertinent. Live fournit aussi la possibilité d’effectuer des recherches par proximité géographique : une librairie à Paris ? un cinéma à Sydney ? La liste des réponses affiche, outre leur adresse, une carte avec leur localisation et l’itinéraire pour s’y rendre.
Enfin, un autre moteur qui a du mal à s’imposer est Live de Microsoft, qui vient de perdre sa place de « première marque de la planète » au profit de Google. Pourtant, il innove certainement de son côté : utilisant de nouvelles techniques d’interface, sa recherche d’images fournit une « page continue » de réponses : il n’est plus nécessaire de passer de page à page, il suffit de parcourir l’unique page des vignettes à l’aide de l’ascenseur ; il n’est plus nécessaire de cliquer sur une vignette pour obtenir des informations à son sujet (taille, site, commentaires…), il suffit de l’effleurer avec la souris. Cette présentation est bien plus efficace que celles des concurrents : d’un coup d’œil, on localise les images potentiellement intéressantes – aucun texte n’intervenant entre elles ; puis on vérifie ce qui pourrait être pertinent. Live fournit aussi la possibilité d’effectuer des recherches par proximité géographique : une librairie à Paris ? un cinéma à Sydney ? La liste des réponses affiche, outre leur adresse, une carte avec leur localisation et l’itinéraire pour s’y rendre.
Dans cette version new age des 24 heures du Mans, c’est le moteur superboosté en technologie, hypersimple à utiliser et permettant de « tout » faire d’un clic d’un seul qui prendra le dessus. Surtout si son nom de marque accroche. Les enjeux financiers sont si gigantesques qu’ils obscurcissent certaines considérations sociales, éthiques ou morales.
1 On peut se demander en effet pourquoi la BnF n’a pas choisi d’utiliser ce moteur sur ses pages. On vient aussi d’apprendre qu’AOL France a lâché Exalead pour Google.
2 Ce n’est pas un hasard : François Bourdoncle, PDG d’Exalead, avait travaillé en 1993-4 sur le moteur de recherche Altavista, où il avait précisément créé cette fonction d’affinage des recherche.
3 Certaines le sont pour des secteurs stratégiques – industriels, militaires, policiers…
 Il était
Il était 
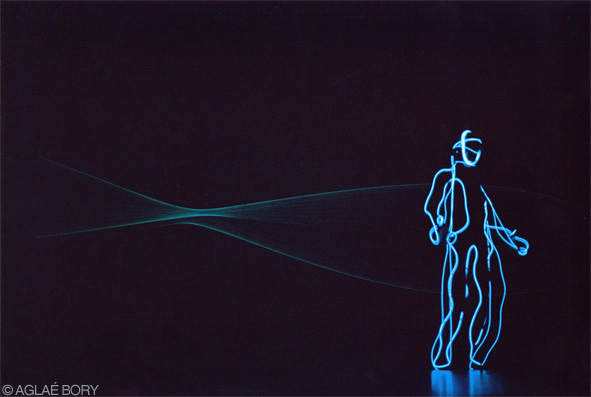

Jean-Paul.Lozouet.jpg)
