Olga m’a tuer

Un homme et deux femmes, vêtus décontracté d’habits couleur de saison, marchent d’un air décidé, leurs pieds nus martelant le sol. Autour, des sacs en plastic remplis d’eau, suspendus chacun à deux fils. Parfois, l’un des personnages se plaque au sol, s’y tord ou reste inerte pour se relever plus tard. à d’autres moments, le trio s’arrête pour fixer du regard un point, puis un autre, indéfiniment, infiniment ; combien de temps resteront-ils ainsi immobiles ? Un deuxième homme joue à l’alto des sons souvent grinçants ; quand il n’est pas occupé à ne rien faire, il prend un cube translucide à moitié rempli d’eau et le retourne : on entend alors l’eau couler dans l’objet, sans que cela ne dérange ses trois acolytes, qui continuent à évoluer impassibles, comme indifférents au monde. Plus tard, l’un d’eux se couchera sur un ballon de caoutchouc, et lorsque celui-ci explose, son bruit induit un moment de frénésie, qui se calmera rapidement. À la fin, l’un des deux fils maintenant chacun des sacs en plastic remplis d’eau est détaché, et l’autre amorce un lent mouvement de balancier. L’un des quatre personnages se couche par terre sous l’un d’eux, les autres s’en vont. Après un long moment, il se relève et s’en va aussi. Le public applaudit.
C’était éclats mats, de la chorégraphe Olga de Soto (parce que c’était un spectacle de danse), ce soir au Centre Pompidou. Spectacle dans lequel elle « s’interroge sur la pensée qui précède ou accompagne tout mouvement ». Comme elle l’écrit ailleurs, « Il s’agit d’un travail sur l’instant présent et sur un temps réel, sans personnages. Pour moi, la forme du solo confronte l’interprète à soi-même, accompagné comme il est, inévitablement, par sa connaissance et sa méconnaissance de soi (…). C’est cet autre, absent, qui a donné corps aux présences des quatre corps qui partageaient l’espace-temps du spectacle éclats mats. » Je dois être trop bête, je n’ai vraiment rien compris, je me suis ennuyé à mort, l’espace était vide et le temps ne passait pas. Pour moi, la danse c’est autre chose, vraiment.
 J’aime la danse contemporaine. Enfin, je l’ai cru pendant longtemps. Depuis le jour où j’ai vu, au ciné-club de la fac américaine où je faisais mes études le film documentaire Making Dances : Seven Post-Modern Choreographers de Michael Blackwood. J’y avais découvert avec émerveillement le travail de Trisha Brown, Lucinda Childs, David Gordon, Douglas Dunn, Kenneth King, Meredith Monk et Sara Rudner – ce qui a eu pour effet entre autres de me faire perdre mon goût pour le ballet classique, mais passons. Une vraie découverte de polyphonies de lignes et de rythmes rapprochant curieusement minimalisme et Bach.
J’aime la danse contemporaine. Enfin, je l’ai cru pendant longtemps. Depuis le jour où j’ai vu, au ciné-club de la fac américaine où je faisais mes études le film documentaire Making Dances : Seven Post-Modern Choreographers de Michael Blackwood. J’y avais découvert avec émerveillement le travail de Trisha Brown, Lucinda Childs, David Gordon, Douglas Dunn, Kenneth King, Meredith Monk et Sara Rudner – ce qui a eu pour effet entre autres de me faire perdre mon goût pour le ballet classique, mais passons. Une vraie découverte de polyphonies de lignes et de rythmes rapprochant curieusement minimalisme et Bach.
 C’est à mon arrivée à Paris que j’ai pu voir les spectacles de ces chorégraphes, principalement durant le Festival d’Automne et à d’autres moments, au Théâtre de la Ville à la programmation si éclectique et novatrice, mais aussi à Créteil (une splendide recréation d’un spectacle de Martha Graham), à la MC93 (la troupe de Lucinda Childs dans Einstein on the Beach de Philip Glass, mis en scène par Bob Wilson), à Chaillot (Twyla Tharp) et d’autres aussi: Pina Bausch (dans ses extraordinaires Kontakthof et Barbe-Bleue), Merce Cunningham le patriarche à la créativité bouillonnante, Alwin Nikolais magique par sa recomposition des corps et des couleurs, mais aussi une nouvelle génération avec Sidi Larbi Cherkaoui ou les Ballets C. de la B. Passionnants, jubilatoires, poétiques, intelligents, fous, abstraits – leurs univers parlent directement à tous nos sens.
C’est à mon arrivée à Paris que j’ai pu voir les spectacles de ces chorégraphes, principalement durant le Festival d’Automne et à d’autres moments, au Théâtre de la Ville à la programmation si éclectique et novatrice, mais aussi à Créteil (une splendide recréation d’un spectacle de Martha Graham), à la MC93 (la troupe de Lucinda Childs dans Einstein on the Beach de Philip Glass, mis en scène par Bob Wilson), à Chaillot (Twyla Tharp) et d’autres aussi: Pina Bausch (dans ses extraordinaires Kontakthof et Barbe-Bleue), Merce Cunningham le patriarche à la créativité bouillonnante, Alwin Nikolais magique par sa recomposition des corps et des couleurs, mais aussi une nouvelle génération avec Sidi Larbi Cherkaoui ou les Ballets C. de la B. Passionnants, jubilatoires, poétiques, intelligents, fous, abstraits – leurs univers parlent directement à tous nos sens.
Mais ce sont des spectacles de chorégraphes – principalement français – qui m’ont fait prendre conscience d’une toute autre « danse contemporaine », qui était sans doute destinée à interpeller un certain type d’intellect (pas le mien, en tout cas) et qui m’a laissé le plus souvent froid, malgré les danseurs nus de Boris Charmatz dans Herses (une lente introduction) sur une musique non moins difficile ; le Mauvais genre nu/couche-culotte d’Alain Buffard (il faut lire une longue analyse pour tenter de comprendre, mais cela ne fait pas aimer et est-on vraiment convaincu ?), ou Ceci est mon corps à l’esthétique christico-homoérotique « tendance backroom » (comme le dit si efficacement Philippe Verrièle) d’Angelin Preljocaj ; le carrément ennuyeux spectacle de Mathilde Monnier dans lequel elle déambule sur la scène, se couche par terre, se relève…
Dorénavant, on donne même carrément dans le gore ; voici comment Olivier Brunel parle (dans un article qui vaut la peine d’être lui pour y voir à quelle sauce on accommode Mozart) de ce « [...] “Tannhaüser” d[e] Jan Fabre à Bruxelles qui montrait au Venusberg des femmes enceintes nues se masturbant. à Paris, (…) on a pu voir successivement trois (…) affligeantes provocations comme “The Crying Body” du même Fabre où filles et garçons urinaient sur scène en se crachant dessus et insultant le public. “Sonic Boom” de Wim Wandekeybus, (…) ayant la cote dans les milieux branchés, montrait des scènes d’automutilation sanguinolentes. Dans la foulée, Marco Berrettini avec “No Paraderan” proposait un non spectacle dont les personnages insultaient le public, assorti d’une expérience révélatrice : plongé dans le noir, le public a copieusement répondu à ces injures ; une fois la lumière rétablie plus personne n’osait protester. » Il semblerait que branché = trash ou hyperintellobfuscation, de nos jours, dans la danse et ailleurs. Ce n’est pas vraiment un signe de maturité mais plutôt de régression infantile.
À la sortie du spectacle de ce soir, un collègue accompagné d’une jeune femme me hèle : « je parlais justement de toi et je disais que j’étais sûr que le spectacle t’avait plu ». À ma réponse brève (le titre de cet article), la compagne dudit collègue me dit, « mais c’était si sensualiste ! ». Il faut l’excuser, il est philosophe ; mais elle ? Moi, je ne le suis pas.
15/1/05 – 9/6/05

 Arte vient de
Arte vient de  Ironie et poncifs intentionnels (la noire au gros cul), tendresse si émouvante, violence jamais gratuite, images frappantes (l’homme pendu la tête en bas), déclarations fulgurantes (« I am séropositive, so what ? », dit la noire), croix et mater dolorosa, mur (des lamentations), solos et mouvements d’ensemble magnifiques dans ce paysage de désastre… Ce spectacle est rempli de fulgurances. Si d’aventure
Ironie et poncifs intentionnels (la noire au gros cul), tendresse si émouvante, violence jamais gratuite, images frappantes (l’homme pendu la tête en bas), déclarations fulgurantes (« I am séropositive, so what ? », dit la noire), croix et mater dolorosa, mur (des lamentations), solos et mouvements d’ensemble magnifiques dans ce paysage de désastre… Ce spectacle est rempli de fulgurances. Si d’aventure 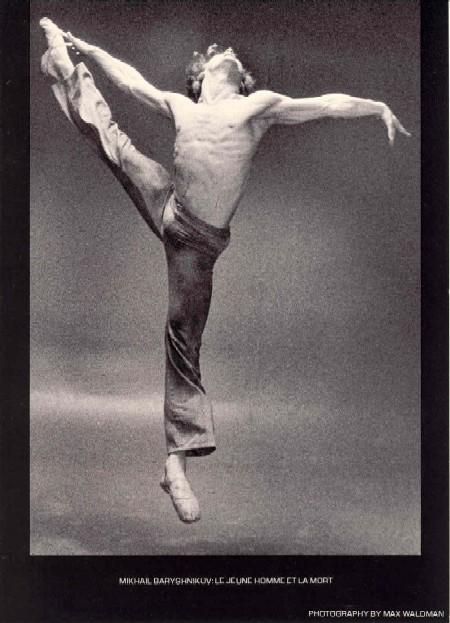
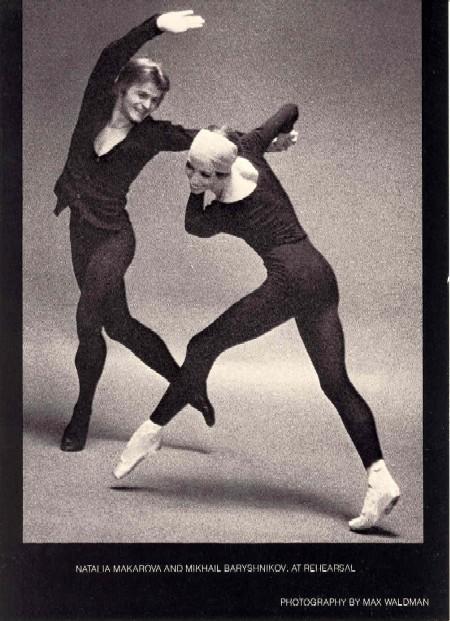

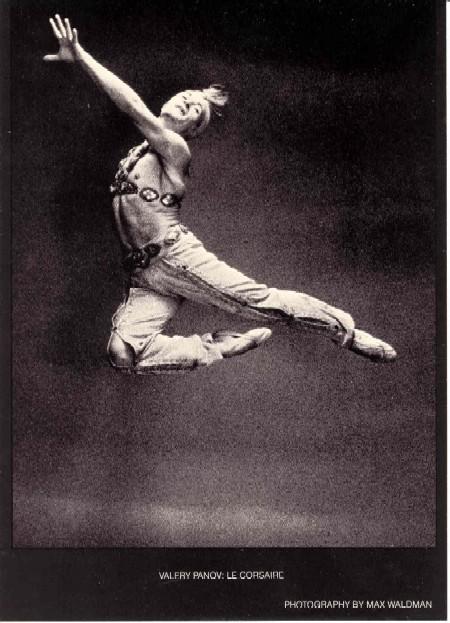


 Le spectacle s’est ouvert par une séquence dans laquelle Mette Edvardsen rampait sous le tapis de scène. Une fois sortie, elle a passé le reste du temps à déambuler, en parlant parfois au public. Et ça, est-ce de la danse ? Quant au trio Game over us, chorégraphié et interprété par deux hommes et une femme, il y avait enfin des moments très bien dansés (qui rappelaient du Trisha Brown), et quelques séquences dites très droles, notamment celles que déclamait Lisi Estaras avec une voix imperturbable à l’accent espagnol si chaud et rrrrocailleux :
Le spectacle s’est ouvert par une séquence dans laquelle Mette Edvardsen rampait sous le tapis de scène. Une fois sortie, elle a passé le reste du temps à déambuler, en parlant parfois au public. Et ça, est-ce de la danse ? Quant au trio Game over us, chorégraphié et interprété par deux hommes et une femme, il y avait enfin des moments très bien dansés (qui rappelaient du Trisha Brown), et quelques séquences dites très droles, notamment celles que déclamait Lisi Estaras avec une voix imperturbable à l’accent espagnol si chaud et rrrrocailleux : Pour finir, nous avons eu droit au long court-métrage d’Anaïs et Olivier Spiro The Unclear Age dans lequel Erna Ömarsdóttir et Damien Jalet (le grand inspirateur de Sidi Larbi Cherkaoui) évoluaient dans une décharge publique, avec des moments souvent trash : critique de la société de consommation dont les objets amoncellés sont l’univers du couple, mourant à l’image du monde occidental contemporain qui s’étouffe sous le poids de sa modernité – sans doute, belle idée (ou est-ce un concept ?) bien filmée, mais est-ce de la danse ?
Pour finir, nous avons eu droit au long court-métrage d’Anaïs et Olivier Spiro The Unclear Age dans lequel Erna Ömarsdóttir et Damien Jalet (le grand inspirateur de Sidi Larbi Cherkaoui) évoluaient dans une décharge publique, avec des moments souvent trash : critique de la société de consommation dont les objets amoncellés sont l’univers du couple, mourant à l’image du monde occidental contemporain qui s’étouffe sous le poids de sa modernité – sans doute, belle idée (ou est-ce un concept ?) bien filmée, mais est-ce de la danse ?