« Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. »

Villa Léandre à Montmartre.
Autres photos de Montmartre.
«J’avoue en souriant que j’aime Montmartre, que je l’ai aimé de tout temps, et, puisque Montmartre va bientôt disparaître, ou, du moins, se transformer profondément, je veux consacrer à Montmartre quelques lignes de souvenir.
Comment expliquer cela ? Montmartre me fait l’effet d’un de ces pays créés en même temps que la Bibliothèque bleue et les images d’Epinal. Une idée naïve s’y rattache invinciblement. Je me rappelle avec délices les plaisanteries sur l’Académie de Montmartre, sur les moulins « où les enfants d’Éole broient les dons de Cérès », selon l’expression d’un poète classique1, et surtout la fameuse inscription : C’est ici le chemin des ânes2.
Paris me semblerait incomplet sans Montmartre. J’aime, lorsque je passe sur le boulevard des Italiens, à m’arrêter en face de la rue Laffitte et à saluer du regard l’ancienne tour du télégraphe, qui apparaît, dans une verte échappée, au-dessus de Notre-Dame de Lorette.
 Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. Il a été aplani, rogné, diminué par tous ses abords. Chaque jour, des maisons montent à l’escalade et l’envahissent. Puis, il a perdu une de ses principales curiosités : les carrières, qui ont été comblées. — Elles ouvraient encore, il y a une quinzaine d’années, leurs perspectives mystérieuses ; la plupart offraient des constructions régulières ; les voûtes étaient soutenues par des piliers. On les traversait en tous sens.
Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. Il a été aplani, rogné, diminué par tous ses abords. Chaque jour, des maisons montent à l’escalade et l’envahissent. Puis, il a perdu une de ses principales curiosités : les carrières, qui ont été comblées. — Elles ouvraient encore, il y a une quinzaine d’années, leurs perspectives mystérieuses ; la plupart offraient des constructions régulières ; les voûtes étaient soutenues par des piliers. On les traversait en tous sens.
Ces carrières avaient eu trois races très distinctes de locataires : d’abord les animaux antédiluviens, dont les ossements retrouvés ont fourni de si ingénieuses hypothèses à Cuvier ; ensuite les carriers, qui y travaillaient à toute heure de jour et de nuit ; et enfin, quand les carriers furent partis, les vagabonds de toute espèce en quête d’un asile, c’est-à-dire d’une pierre pour reposer leur front.
Un autre coup porté à la physionomie pittoresque de Montmartre, ç’a été la suppression de sa fête annuelle, une des plus animées et des plus joyeuses, et, par suite, la disparition de son champ de foire, célèbre dans l’univers entier. Après la déchéance du carré Marigny, la place Saint-Pierre était devenue, en effet, le principal refuge des saltimbanques. J’y ai vu les dernières marionnettes convaincues jouer la Pie voleuse ; j’y ai entendu le dernier saint Antoine supplier, en sautant sur ses genoux :
Messieurs les démons,
Laissez-moi donc !
tandis qu’un paquet de petits diablotins se ruait en bonds désordonnés contre sa cabane ébranlée par l’orage.
Non ! tu danseras !
Tu chanteras !
 Et c’étaient chaque soir, pendant deux ou trois semaines, sur cette place relativement étroite, un bacchanal, une foule, une démence, des cirques en toile, des dioramas dans des berlines, des tableaux de toute dimension représentant des géantes, des physiciens, le tremblement de terre de la Guadeloupe, le mont Blanc, des oiseaux savants, des albinos, un serpent faisant six fois le tour du corps d’un voyageur, des estrades garnies d’athlètes en brodequins fourrés et de danseuses de corde en jupons à paillettes, des parades à coups de pied, de grosses têtes en carton s’agitant sur des tréteaux, un ouragan de pistons et de clarinettes, des hurlements dans des porte-voix, des réveils de ménagerie et des illuminations soudaines !
Et c’étaient chaque soir, pendant deux ou trois semaines, sur cette place relativement étroite, un bacchanal, une foule, une démence, des cirques en toile, des dioramas dans des berlines, des tableaux de toute dimension représentant des géantes, des physiciens, le tremblement de terre de la Guadeloupe, le mont Blanc, des oiseaux savants, des albinos, un serpent faisant six fois le tour du corps d’un voyageur, des estrades garnies d’athlètes en brodequins fourrés et de danseuses de corde en jupons à paillettes, des parades à coups de pied, de grosses têtes en carton s’agitant sur des tréteaux, un ouragan de pistons et de clarinettes, des hurlements dans des porte-voix, des réveils de ménagerie et des illuminations soudaines !
Maintenant, sur cette place, c’est le silence et c’est la solitude. Une statue informe de saint Pierre se dresse au milieu de ces ruines sablonneuses.
On a fait à la butte elle-même une ceinture de planches qui en interdit l’ascension. Plus de promenades à la butte ! Comprenez-vous cela, ô Parisiens de la banlieue ?… C’était aussi une des gaietés de Montmartre, ces parties sur ce coteau escarpé, ces glissades, ces défis, ces envolées de robes claires, ces chutes suivies d’éclats de rire. Il y avait tel dimanche où rien n’était plus charmant à voir que cette fourmilière humaine. Des familles entières étaient assises, laissant pendre leurs jambes au bord des talus ; des bourgeois, armés de longues-vues, interrogeaient l’horizon, un horizon sans pareil, une vapeur d’or baignant des milliards de toits, de grands nuages empourprés du côté de l’arc de triomphe de l’Étoile !
Qu’on ne s’y trompe pas : la butte Saint-Pierre est, avec la rampe du Trocadéro, un des plus beaux points de vue du monde.
Tel qu’il est encore, Montmartre mérite une étude, une aquarelle si vous voulez, car Montmartre se compose de tons très différents. Ses aspects sont plus variés qu’on ne croirait. Il est impossible d’en saisir l’ensemble, même du faîte de la tour Solferino.
Et puis, en fin de compte, il reste quelque chose du vieux Montmartre ; il reste un village singulier, perché à une hauteur respectable, avec des rues étroites et tortueuses, des masures toutes noires, des cours qui exhalent des odeurs de laiterie, de vacherie, de crémerie. Les habitants vous regardent passer avec étonnement par la porte à claire-voie de leurs boutiques. On arrive à ce hameau escarpé par des escaliers assez nombreux, et dont quelques-uns sont d’un effet pittoresque, entre autres celui qui s’appelle passage du Calvaire. On y arrive aussi par une succession de rues tournantes, accessibles aux voitures. Pourtant je ne réponds pas que vous déterminiez une expression de satisfaction bien vive sur le visage d’un cocher, lorsque vous lui jetez négligemment cette indication :
« À Montmartre ! place de l’Église ! »
Elle n’a rien de remarquable, cette église ; on va voir, dans le jardin du presbytère, son Calvaire, qui est aussi célèbre que l’était celui du mont Valérien. Tout alentour, dans la rue des Rosiers, dans la rue de la Bonne, dans la rue Saint-Vincent, dans la rue des Réservoirs, le long de l’ancien cimetière, se cachent des maisons de campagne ravissantes et ignorées, remplies d’arbres de toute espèce et de tout pays ; des retraites silencieuses, touffues, enceintes de vieilles murailles brodées de fleurs. Le plateau compris entre l’église et les moulins est certainement le point le plus agréable de Montmartre ; le versant qui regarde la plaine Saint-Ouen, ourlé par la rue Marcadet, est tout à fait coquet et riant. Il y a là des ravins, des sentiers, des champs sérieux, des damiers de culture, des cabanes de bonne mine. L’œil embrasse une ligne onduleuse de coteaux bleuâtres, au bas desquels apparaît, entre vingt tuyaux d’usines, la basilique de Saint – Denis, veuve de son clocher.
 Le côté vilain de Montmartre, le côté pelé, déchiré, tourmenté, est celui qui commence au Moulin de la Galette, un des derniers moulins dont la hauteur était jadis couronnée. Deux autres ne sont plus que des squelettes de bois pourri. C’est la région des guinguettes, des bals, le dimanche, dans les arrière-boutiques de marchands de vins. La semaine, on n’y rencontre que des terrassiers, occupés auprès des charrettes remplies de gravois. Ces hangars noirs sont des fabriques de bougies, m’a-t-on assuré. J’ai découvert, près de là, un café orné de cette enseigne passablement ambitieuse : Café des Connaisseurs.
Le côté vilain de Montmartre, le côté pelé, déchiré, tourmenté, est celui qui commence au Moulin de la Galette, un des derniers moulins dont la hauteur était jadis couronnée. Deux autres ne sont plus que des squelettes de bois pourri. C’est la région des guinguettes, des bals, le dimanche, dans les arrière-boutiques de marchands de vins. La semaine, on n’y rencontre que des terrassiers, occupés auprès des charrettes remplies de gravois. Ces hangars noirs sont des fabriques de bougies, m’a-t-on assuré. J’ai découvert, près de là, un café orné de cette enseigne passablement ambitieuse : Café des Connaisseurs.
Ce versant s’incline sur le nouveau cimetière et est bordé par la rue des Dames, puis par la rue des Grandes-Carrières.
Tels sont les principaux aspects, assurément particuliers, de Montmartre. Ils ont eu leur peintre spécial dans Michel, un artiste peu connu, pauvre, bizarre, qui avait trouvé là sa campagne romaine. Les études de Michel n’étaient guère recherchées et guère payées, il y a trente ans, dans les ventes publiques, où elles se produisaient en assez grand nombre. Il est vrai qu’elles n’offraient rien de bien séduisant : c’étaient des toiles d’une dimension importante, représentant des carrés de sol, la plupart sans accident, des amas de broussailles avec le ciel à ras de terre, un ciel brouillé, profond, triste. Mais tout cela était largement peint, d’un ton juste. Aujourd’hui, les tableaux de Michel sont mieux appréciés ; on les paye, sinon un prix élevé, du moins un prix honorable. Ce sont surtout les artistes qui les achètent.
Dans les nouvelles dénominations de rues, j’aurais souhaité de voir la rue Michel, à Montmartre.
Les deux plus récents historiens de Montmartre sont Gérard de Nerval et M. Léon de Trétaigne.
Le premier, dans sa Bohême galante, au chapitre intitulé : « Promenades et souvenirs, » a écrit six de ses pages les plus exquises. Il raconte comment il faillit acheter autrefois, au prix de 3,000 francs, la dernière vigne de Montmartre.
« Ce qui me séduisait, dit-il, dans ce petit espace abrité par les grands arbres du Château des Brouillards, c’était d’abord ce reste de vignoble lié au souvenir de saint Denis. C’était ensuite le voisinage de l’abreuvoir, qui, le soir, s’anime du spectacle de chevaux et de chiens que l’on y baigne, — et d’une fontaine construite dans le goût antique, où les laveuses causent et chantent, comme dans un des premiers chapitres de Werther. Avec un bas-relief consacré à Diane, et peut-être deux figures de naïades sculptées en demi-bosse, on obtiendrait, à l’ombre des vieux tilleuls qui se penchent sur le monument, un admirable lieu de retraite, silencieux à ses heures… »
À côté de cet abreuvoir s’élève aujourd’hui une maison élégante, dont le propriétaire est cet aimable Berthelier, le chanteur de chansonnettes et de vaudevilles.
« Il ne faut plus y penser ! — s’écrie Gérard avec ce doux sourire que je revois toujours ; — je ne serai jamais propriétaire ! » Et ses visions d’antiquité lui reviennent de plus belle. Il aurait fait faire dans cette vigne une construction si légère ! « Une petite villa dans le goût de Pompéi, avec un impluvium et une cella, quelque chose comme la maison du poète tragique. Le pauvre Laviron, mort depuis, m’en avait dessiné le plan. »
C’est ainsi qu’en peu de lignes ce délicat esprit a su dégager toute la poésie agreste de Montmartre.
Le second historien, dans le sens grave et imposant du mot, est, comme je l’ai dit, M. Léon de Trétaigne. Ses études sur Montmartre et Clignancourt, constituant un volume in-octavo, ont paru en 1862. Elles résument tous les travaux précédents et embrassent une période considérable de siècles. C’est le volume qu’il faut ouvrir si l’on veut connaître les révolutions de cette éminence de terrain depuis le supplice de saint Denis, date à laquelle elle entre violemment dans l’histoire.
Que d’événements importants se sont passés à Montmartre ! Que d’hommes fameux y ont paru, pour prier ou pour combattre !
L’empereur de Germanie, Othon II, y a fait chanter un formidable Alleluia qui s’entendit jusqu’à Notre-Dame épouvantée.
Le pape Eugène III y a officié solennellement, saint Bernard lui servant de diacre.
Charles VI, au lendemain du ballet des sauvages, où il faillit trouver la mort dans les flammes3, s’y est rendu en pèlerinage, accompagné de toute sa cour.
Ignace de Loyola et François Xavier y ont prononcé leurs vœux et jeté les premières bases de la Compagnie de Jésus.
Henri IV y a établi son quartier général lors de son troisième siège de Paris. On veut même qu’il y ait senti battre son cœur, — qui battait d’ailleurs assez facilement, — pour une abbesse d’un couvent de bénédictines.
À ce même couvent, transformé et purifié, le Régent et le jeune roi Louis XV sont venus maintes fois faire leurs dévotions.
Puis le vent de la Révolution a soufflé ; et, sous la Terreur, Montmartre, l’innocent et tranquille Montmartre, a vu son nom changé en celui de Mont-Marat.
Tranquille, viens-je de dire ! Ne vous y fiez pas. En 1814, quatre cents dragons y ont lutté héroïquement contre vingt mille hommes de l’armée de Silésie.
Vous voyez que les souvenirs abondent en cette localité.
Ce livre, très complet, mène le lecteur jusqu’à l’administration de M. le baron Michel de Trétaigne, père de l’auteur et maire de Montmartre pendant plusieurs années.
MM. de Trétaigne père et fils habitent eux-mêmes, au bas de Montmartre, dans la rue Marcadet, un ravissant domaine composé d’une maison, ou plutôt d’une petite maison, ornée de bas-reliefs érotiques, et d’un parc d’une étendue qu’on ne soupçonnerait jamais dans un faubourg parisien. De longues avenues de tilleuls et de marronniers, d’épaisses charmilles, des pelouses immenses, des peupliers gigantesques, des cèdres, des arbres de Judée contribuent à rendre invraisemblable cette propriété magnifique.
Aujourd’hui, le maire de Montmartre est M. Leblanc.
Ce n’est pas la faute à cet honorable fonctionnaire s’il est forcé de signer tous ses actes : Le maire, Leblanc. »
Charles Monselet, De Montmartre à Séville. Paris, 1865.
_________________
1. Ponce-Denis Écouchard-Lebrun (surnommé le pindarique, 1729-1807) qui dit de Montmartre dans son ode Le Triomphe de nos paysages :
La colline qui, vers le Pôle,
Borne nos fertiles marais,
Occupe les enfants d’Éole
À broyer les dons de Cérès.
2. Écrite sous la forme d’une prétendue inscription romaine trouvée sur une pierre à Montmartre et envoyée par Piron à l’Académie des inscriptions et belles lettres, lui demandant de bien vouloir la déchiffrer :
CES. TI. C.
ILEC. HE.
M. INDE. SANES.
La Diligence, Journal des voyageurs de 1849 qui rapporte cette anecdote relate ainsi celle d’une autre inscription du même acabit : « Sur un petit vase trouvé non loin des bords de la Saône, on lit l’inscription suivante, qui a donné bien des insomnies aux antiquaires de Mâcon :
MVL. T. AR.
D. ADI. V. I. O.
N. EN.
SIS.
Un des plus habiles membres de l’Académie de cette ville l’a développée ingénieusement de la façon suivante : MULieres. Tinurtii. ARaris. Dicaverunt. ADIpatam. Vrnam. Iovi. Optimo. Nautis. ENavigantibus. SospItibuS. Ce qui se traduit ainsi : — Les femmes de Tournus sur Saône ont dédié cette urne pleine de graisse à Jupiter très bon ; les matelots de la rivière ayant terminé leur traversée sains et saufs. — Ce sens est assez naturel et assez facile ; mais en voici un autre qui l’est pour le moins autant. En rapprochant les lettres et lisant couramment, on trouve MVLTARDA DIVIONENSIS, latin peu classique, mais se traduisant fort nettement : Moutarde de Dijon !
Ces calembours ne sont pas sans rappeler le non moins fameux :
Cesarem legato alacrem eorum.
Sumpti dum est hic apportavit legato.
qui se déchiffre sur un coin de sa table de cuisine sans même faire appel au Gaffiot.
3. Jean Juvenal des Ursins raconte cet épisode ainsi : « Audit temps le roy avoit aucunement recouvert sa santé, et luy donnoit-on le plus de plaisance, comme dit est, qu’on pouvoit ; et fut ordonné une feste au soir en l’hostel de la royne Blanche à Saint-Marcel près Paris, d’hommes sauvages enchaisnez, tous velus ; et estoient leurs habillemens proppices au corps, velus, faits de lin, ou d’étoupes attachées à poix resine, et engraissez aucunement pour mieux reluire ; et vinrent comme pour danser en la sale où il y avoit torches largement allumées : et commença-on à jetter parmy les torches, torchons de fouërre ; et pour abreger, le feu se bouta aux habillemens qui estoient bien lacez et cousus. Il estoit grande pitié de voir ainsi les personnes embrasées, et combien qu’il s’entretinssent, toutefois si delaissèrent-ils : et d’iceux hommes sauvages, est à noter que le roy en estait un ; et y eut une dame veuve qui avoit un manteau dont elle affubla le roy, et fut le feu tellement estouffé, qu’il n’eut aucun mal : il y en eut aucuns ars et brulez qui moururent piteusement : un y eut qui se jetta en un puits, l’autre se jetta dans la rivière. »





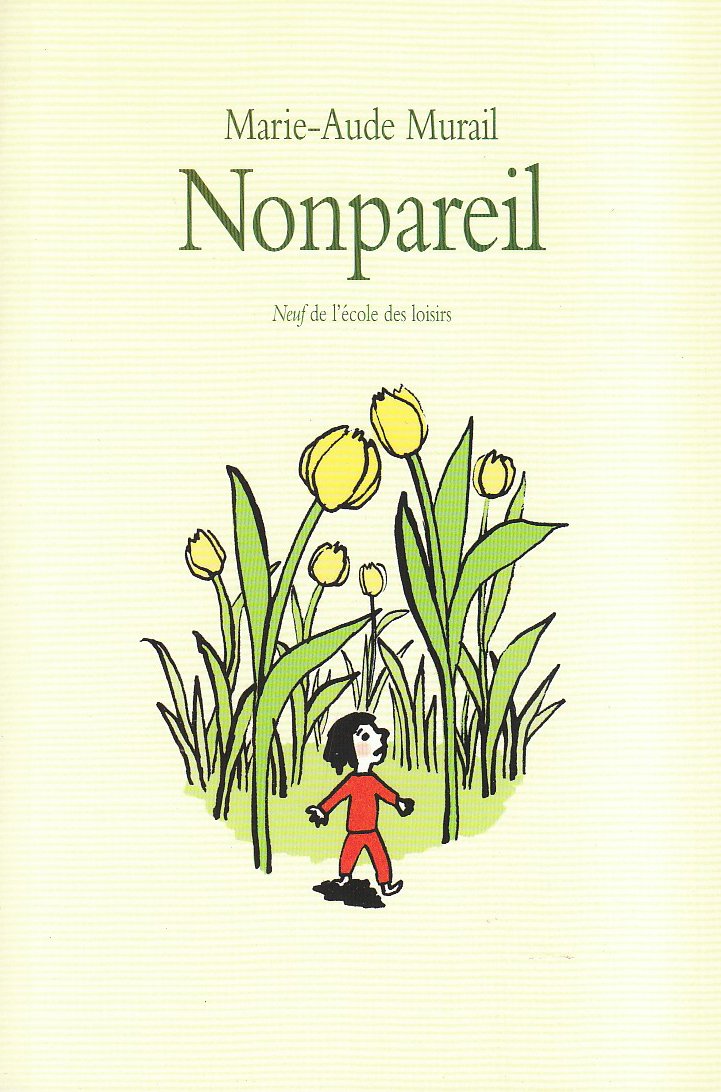
 On se permet de la citer intégralement, parce que les versions fantaisistes qu’en donnent autant la ville de Mende que la Wikipedia dénaturent le propos de l’auteur. Quant à en comprendre le sens, c’est une autre paire de manches. Pierre Brind’amour en donne la paraphrase suivante dans son édition de Nostradamus. Les Premières centuries, ou, Prophéties (Droz, 1996) : « Pour les grands de Mende, de Rodez et Millau, Cahors, Limoges, Castres, ce sera une mauvaise semaine ; il y aura l’entrée de nuit, un caillou de Bordeaux, par le Périgord, au son du tocsin ».
On se permet de la citer intégralement, parce que les versions fantaisistes qu’en donnent autant la ville de Mende que la Wikipedia dénaturent le propos de l’auteur. Quant à en comprendre le sens, c’est une autre paire de manches. Pierre Brind’amour en donne la paraphrase suivante dans son édition de Nostradamus. Les Premières centuries, ou, Prophéties (Droz, 1996) : « Pour les grands de Mende, de Rodez et Millau, Cahors, Limoges, Castres, ce sera une mauvaise semaine ; il y aura l’entrée de nuit, un caillou de Bordeaux, par le Périgord, au son du tocsin ». C’est le sujet de l’amusante Satire II que Boileau adresse à Molière, et dans laquelle on retrouve le souvenir de sa célèbre injonction, « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ». À propos de l’un des vers de cette Satire, « Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire », Jean-François de la Harpe écrit dans son Lycée, ou, Cours de littérature ancienne et moderne (1799) que le dédicataire « fut frappé par ce vers comme d’un trait de lumière. Voilà, dit-il au jeune poète en lui serrant la main, une des plus belles vérités que vous ayez dites. Je ne suis pas de ces esprits sublimes dont vous parlez : mais, tel que je suis, je n’ai rien fait en ma vie dont je sois véritablement content. ».
C’est le sujet de l’amusante Satire II que Boileau adresse à Molière, et dans laquelle on retrouve le souvenir de sa célèbre injonction, « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ». À propos de l’un des vers de cette Satire, « Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire », Jean-François de la Harpe écrit dans son Lycée, ou, Cours de littérature ancienne et moderne (1799) que le dédicataire « fut frappé par ce vers comme d’un trait de lumière. Voilà, dit-il au jeune poète en lui serrant la main, une des plus belles vérités que vous ayez dites. Je ne suis pas de ces esprits sublimes dont vous parlez : mais, tel que je suis, je n’ai rien fait en ma vie dont je sois véritablement content. ». La marquise de Sévigné savait bien tourner les lettres, et apprécier celles qui l’étaient. Voici ce qu’elle écrit en 1672 à sa fille, la comtesse de Grignan, en préambule à l’une des nombreuses lettres qu’elles se sont échangées :
La marquise de Sévigné savait bien tourner les lettres, et apprécier celles qui l’étaient. Voici ce qu’elle écrit en 1672 à sa fille, la comtesse de Grignan, en préambule à l’une des nombreuses lettres qu’elles se sont échangées :

.jpg) Je le soutiens, les noms d’Aristide, de Platon, de Socrate, de Corneille, de Voltaire, de tous les grands hommes présents et passés, sont moins illustres, moins brillants que ceux des bijoutiers : comment cela, me direz-vous ? c’est que les noms de ceux-ci sont écrits en lettres de diamants au fond de leur boutique, et éblouissent la vue lorsqu’on veut les lire ; ils effacent donc tous les noms connus par leur éclat
Je le soutiens, les noms d’Aristide, de Platon, de Socrate, de Corneille, de Voltaire, de tous les grands hommes présents et passés, sont moins illustres, moins brillants que ceux des bijoutiers : comment cela, me direz-vous ? c’est que les noms de ceux-ci sont écrits en lettres de diamants au fond de leur boutique, et éblouissent la vue lorsqu’on veut les lire ; ils effacent donc tous les noms connus par leur éclat  Gâteaux Fourrés
Gâteaux Fourrés
