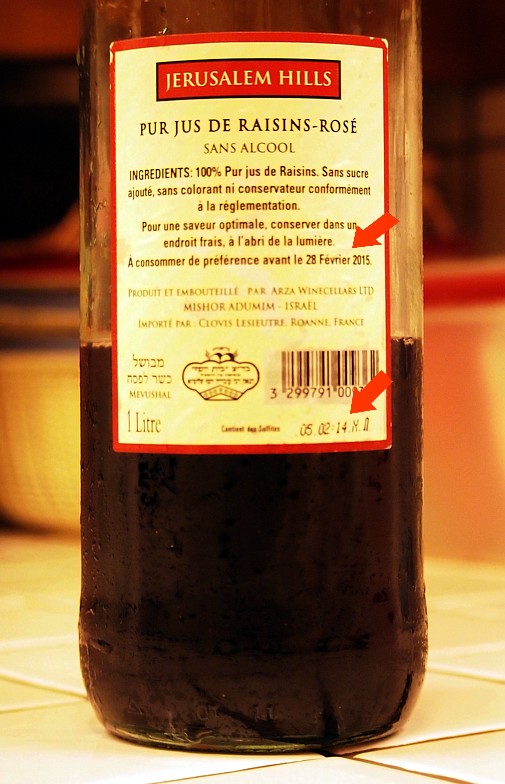La pie a la réputation d’être pleine de curiosité. Celle-ci, qu’on a aperçu récemment sur une pelouse normande, n’a pas hésité à retirer pour un moment sa tête de la terre où elle tentait d’attraper un quelconque ver et à nous jeter par-dessus l’épaule ce regard inquisiteur.
Curieux nous aussi, on s’est empressé de rechercher ce qu’en disaient les poètes ou les savants. Gaudeamus igitur, on a trouvé ce joli texte de Julien-Joseph Virey (1775-1846), personnage curieux s’il en est, puisqu’il s’agit d’un naturaliste à l’âme de poète mâtiné de psychologie (humaine mais aussi animale) – ce que lui reprochaient ses collègues uniquement scientifiques. Il faut de tout pour faire un monde, et heureusement qu’il n’est pas uniquement peuplé des uns ou des autres.
Ce passage est extrait des deux chapitres qu’il consacre aux « mœurs naturelles des oiseaux » dans son très sérieux ouvrage L’Histoire des mœurs et de l’instinct des animaux. L’affect qui traverse ce texte, les comparaisons qu’il ne manque de faire entre le caractère, les caractéristiques et le comportement de la gent ailée et ceux de l’espère humaine, ses considérations sur le langage et la vie amoureuse et sociale des uns et des autres et qui vont jusqu’à la place de la femme dans la société occidentale ! ne pouvaient manquer de surprendre, d’amuser, voire de toucher, son auditoire – il s’agissait de cours qu’il avait donnés à l’Athénée royal de Paris – comme il peut nous toucher aujourd’hui : comment rester insensible au passage où il indique qu’une société dans laquelle les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes est plus civilisée que celles qui enferment celles-ci, et que « Les femmes deviennent peut-être, par le langage même, l’une des principales causes du perfectionnement des sociétés modernes » ?
C’est, pour le moins, inhabituel, sans pour autant être farfelu.

«Toute la classe des oiseaux se montre en général plus sensible que celle des quadrupèdes ; elle est aussi plus vive et plus ardente en toutes ses actions, à cause de la grande respiration de ces volatiles ; le repos est pour eux un tourment : toujours agités, turbulents, inquiets, dormant peu, ils passent la vie dans une activité perpétuelle ; volages, impétueux, ils sont aussi très colères et très amoureux. En général, leur fibre est mince, tendue, sèche même comme celle des personnes délicates, fluettes, qui sont mobiles, excitables. La rapidité, l’étendue de leur vue accroît encore ce besoin du changement et de la variété ; mais leurs autres sens, tels que ceux du toucher et du goût, paraissent très bornés. Cette bouillante impétuosité les rend moins capables de réflexion et d’une vraie instruction, que des animaux plus tranquilles. Ils éprouvent des impressions promptes, mais fugitives et subites, que le temps efface aisément comme de légers aperçus. Rien ne se grave en eux profondément ; ils sentent plus qu’ils ne conçoivent : c’est qu’il faut une sorte de gravité, un caractère posé et réfléchi pour se bien pénétrer de la connaissance des choses ; et si l’on parvient à donner quelque instruction aux serins, aux chardonnerets, aux merles, aux sansonnets, aux perroquets, c’est en les tenant emprisonnés, c’est en les forçant d’être longuement oisifs ; c’est surtout le soir ou la nuit, lorsqu’ils sont plus tranquilles, que les leçons leur profitent mieux. Les oiseaux devenus aveugles, étant moins distraits et moins mobiles, s’instruisent beaucoup plus aisément que les autres, et les oiseleurs ont mis à profit cette observation, en brûlant avec un fer rouge les yeux des rossignols et d’autres oiseaux chanteurs qu’on tient en cage. C’est ainsi qu’Homère, Milton, ces poètes si sublimes, furent aveugles, et durent peut-être une partie de leur génie à ce malheur, parce que la force vitale ne se dissipant plus par la vue, s’accumule, pour ainsi dire, dans l’organe de la pensée, et les méditations deviennent plus profondes dans la solitude, le repos et l’obscurité.
Quoique les oiseaux soient déjà plus éloignés de notre nature que les quadrupèdes, et quoique nous ayons vu leur cerveau moins parfait, par le défaut de corps calleux, de la voûte, de la cloison transparente, et par la disposition des six tubercules qui le composent ; cependant ces animaux sont encore très intelligents et très industrieux, comme nous nous proposons d’en offrir des preuves. L’homme, qui possède le cerveau le mieux organisé, et qui se vante d’être le plus sage des animaux, est cependant le seul d’entr’eux qui soit exposé à devenir fou : les plus illustres génies ont souvent manifesté quelque grain d’extravagance, et l’ont avoué eux-mêmes. Il ne faut point chercher, dans l’antiquité, les Démocrite ou les Héraclite ; on en a vu pareillement des exemples parmi les plus célèbres modernes, et le Tasse et Pascal, et une foule d’autres, en offriraient la preuve. Si les bêtes ne deviennent jamais folles, c’est qu’elles sont plus voisines de la sottise que de l’esprit ; et il semblerait, par là, que les sots n’auraient pas même le triste privilège de devenir fous.
Ces quadrupèdes, malgré la simplicité bornée de leur intelligence, qui ne leur permet point de sortir du droit chemin, sont susceptibles pourtant d’éprouver la rage et des vertiges qui troublent leur cerveau ; mais ces maladies ne sont point de la nature de la folie, qui est une exaltation extraordinaire et désordonnée des facultés intellectuelles trop vives, trop impétueuses. L’oiseau ne paraît nullement exposé à la rage comme les quadrupèdes, mais il est sujet aux vertiges, à l’épilepsie et à des boutades. Comme il est naturellement ardent, emporté, il n’écoute que le sentiment présent ; il est peu capable de se plier, de déguiser son moral ; il semble que la franchise du caractère se décèle plus librement, plus fortement chez les individus qui obéissent toujours à leurs premières impressions, comme le volatile.
Aussi les oiseleurs ont surtout remarqué une assez grande variété de caractères parmi les diverses espèces d’oiseaux. Tout le monde observe combien le paon est vain et présomptueux, combien le stupide dindon se rengorge sottement, le hibou est sauvage et taciturne, la pie curieuse, babillarde et voleuse ; l’autruche, la bécasse, encore plus sottes que la buse ; le pinson gai, le moineau pétulant et lascif, l’étourneau et le sansonnet étourdis, la linotte a la tète légère, l’oie est soupçonneuse et vigilante de nuit, le pigeon doux et amoureux, le héron triste et mélancolique, l’épervier rapace, les mouettes sont insatiables et criardes, etc. Parmi les perroquets, les merles, les geais, les corbeaux élevés et instruits, il y a même plusieurs nuances dans le naturel de chaque espèce, indépendantes de l’instruction qu’on leur a donnée.
[…]
Nous avons dit que l’étendue de la respiration, dans la classe des oiseaux, était l’action principale de leur économie, et qu’elle semblait communiquer à toutes les autres son branle et son activité ; que la chaleur vitale, l’ardeur amoureuse, la rapidité des mouvements tenaient à l’énergie de cette fonction. Il en résulte encore d’autres dispositions remarquables et innées parmi ces animaux.
Considérez, Messieurs, combien cette grande respiration leur donne d’aptitude, de facilité pour le chant, accroît l’étendue de leur voix, surtout à l’époque de leurs amours. Tout le monde sait que la voix de l’homme et de la femme acquiert du timbre et de la force au temps de la puberté, et qu’elle se casse lorsque la puissance générative se perd avec l’âge. De même les quadrupèdes prennent, dans la saison de leurs ardeurs, un ton de voix sonore et quelquefois effrayant. Le chant, parmi les oiseaux, n’est que l’expression de l’amour ; car après l’époque de la ponte, ils se taisent dans les bocages, presque tous. Le rossignol, qui déployait tous les charmes de sa voix mélodieuse, n’a plus, après ses amours, qu’un vilain cri semblable au sifflement d’un reptile. Les oiseaux en cage ne chantent jamais plus fort que lorsqu’ils sont privés de leurs jouissances, et l’on en a vu de si transportés à l’aspect d’une femelle dont ils ne pouvaient approcher, qu’ils chantaient avec une sorte de fureur, et jusqu’à tomber en épilepsie ; aussi les nourritures échauffantes sont très propres à exciter le chant de ces animaux. Au contraire, les chapons et d’autres espèces mutilées n’ont plus de chant, parce qu’elles n’ont plus d’amour, et partant plus de joie. Les femelles ont aussi la voix bien plus faible ou plus délicate que les mâles ; leur larynx n’acquiert point autant de développement ; elles sont même la plupart presque muettes, ou n’ont que ces accents primitifs, cette sorte de langage naturel bien différent du ramage amoureux des mâles.
Il résulte de cette multiplication des voix et des sons, que les oiseaux forment plus de liaisons sociales entr’eux que les autres animaux ; qu’ils ont plus de rapports entre leurs sexes, et qu’il s’établit un vrai langage de la mère à ses petits. L’hirondelle gazouillant dans son nid, semble converser avec sa couvée ; les jeunes poussins entendent les différents piaulements de leur mère, soit pour se mettre à couvert sous ses ailes, soit pour accourir à la pâtée, soit pour se cacher à la vue du milan. Les divers accents de douleur, de joie, de surprise, de frayeur, etc., se comprennent chez toutes les espèces d’animaux qui peuvent, a l’aide de poumons, exhaler cette sorte de langage et s’entrecommuniquer leurs affections, avec d’autres gestes ou signes corporels.
Indépendamment de ce langage primitif, il en est un d’acquisition, résultat des relations sociales, et surtout des rapports des sexes entr’eux : puisque l’amour est le principe de toute réunion naturelle, un être qui suffirait seul à ses besoins, n’emploierait que quelques accents ou signes ; aussi les oiseaux solitaires, tels que ceux de proie, n’ont point de ramage, mais seulement quelques cris sauvages. Le chien, en quittant la domesticité, perd l’aboiement. L’homme enrichit et perfectionne son langage, d’autant plus que la société des sexes est plus rapprochée et plus intime. Les peuples chez lesquels règne le plus de galanterie et d’amour, sont les plus causeurs et aussi les plus policés, comme les anciens Grecs ; de là vient que les Européens, chez lesquels les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes dans le commerce de la vie, sont plus civilisés que les Asiatiques, qui renferment celles-ci, et qui vivent taciturnes entr’eux. Les femmes deviennent peut-être, par le langage même, l’une des principales causes du perfectionnement des sociétés modernes. Les oiseaux les plus sociables ont aussi un langage plus étendu que les autres espèces. L’on s’est assuré que les rossignols de certains pays chantaient différemment que ceux d’autres contrées ; comme si ces nations aériennes avaient chacune leur idiome ou leur dialecte particulier ; nous tenons d’un savant ornithologiste, M. Vieillot, que des rossignols chantent moins bien d’eux seuls lorsqu’ils ne sont pas enseignés par leurs parents. Les oiseaux polygames, tels que les gallinacés, n’ont jamais dans le chant cette flexibilité de tons, ces modulations touchantes, propres à attendrir leur femelle, comme les oiseaux monogames. Le coq, sultan impérieux en son sérail, s’exprimant avec arrogance, force les femelles à se soumettre à ses volontés ; sa voix altière est celle du despote qui commande ; tandis qu’un tarin, un chardonneret, aimables troubadours de nos bois, captivent, par de tendres romances, le cœur de leurs douces amies, et ne veulent rien devoir qu’à l’amour. Il en est chez les oiseaux comme dans l’espèce humaine : lorsque les femelles sont plus nombreuses ou plus faciles, les mâles, despotes et jaloux, se font valoir par leur rareté même ; si les femelles sont rares à leur tour, ou, ce qui revient au même, si elles sont plus sévères et plus réservées, elles obtiennent l’empire, et les mâles se rendent leurs esclaves. »
Julien-Joseph Virey, Histoire des mœurs et de l’instinct des animaux, avec les distributions méthodiques et naturelles de toutes leurs classes. Cours fait à l’Athénée royal de Paris. Paris, 1822.