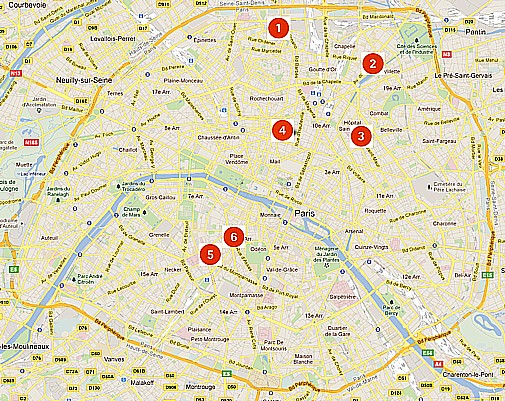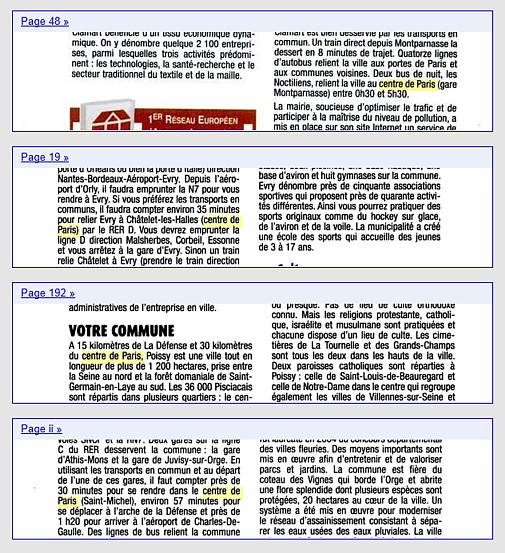Life in Hell: les tribulations de Jeff et Akbar en Indochine

Suivant de très loin le célèbre exemple du jeune, riche et généreux Kin-Fo et de son maître le philosophe Wang, Jeff et Akbar se décident à parcourir l’Indochine, non pas l’un à la poursuite de l’autre, mais ensemble. Ils n’en font pas le tour en ballon en 80 jours, mais la parcourent du nord au sud et à l’ouest en avion, en voiture, en jonque, à dos de scooter, en tuk-tuk et à pied.
 Dans les rues de Hanoï se déverse un torrent dense et tumultueux de scooters, qui, à l’instar d’une nuée de sauterelles stridulantes, semble se diriger uniformément dans une même direction mais où, lorsqu’on s’en rapproche, on distingue des individus filant à droite ou à gauche, à contresens de la circulation ou perpendiculairement que les feux soient au vert ou au rouge, sur la chaussée comme sur les trottoirs, se glissant dans le moindre interstice, même entre Jeff et Akbar, dans le but unique d’avancer en évitant les obstacles tout en klaxonnant à tout bout de champ, tandis que les marchandes ambulantes – à bicyclettes surchargées au point de ressembler à un éléphant ou portant avec une démarche déhanchée bien particulière leurs marchandises sur deux lourds plateaux accrochés en balancier aux deux extrémités d’une barre de bois posée en équilibre sur leurs épaules – et les autres piétons traversent imperturbablement ce flot qui les contourne en les frôlant, à défaut de négocier les trottoirs occupés par les cuisines de rue et leurs clients assis à croupetons sur de minuscules tabourets, aspirant bruyamment les nouilles qu’ils extraient avec des baguettes d’un bol fumant, cernés de scooters garés en rangs d’oignon serrés.
Dans les rues de Hanoï se déverse un torrent dense et tumultueux de scooters, qui, à l’instar d’une nuée de sauterelles stridulantes, semble se diriger uniformément dans une même direction mais où, lorsqu’on s’en rapproche, on distingue des individus filant à droite ou à gauche, à contresens de la circulation ou perpendiculairement que les feux soient au vert ou au rouge, sur la chaussée comme sur les trottoirs, se glissant dans le moindre interstice, même entre Jeff et Akbar, dans le but unique d’avancer en évitant les obstacles tout en klaxonnant à tout bout de champ, tandis que les marchandes ambulantes – à bicyclettes surchargées au point de ressembler à un éléphant ou portant avec une démarche déhanchée bien particulière leurs marchandises sur deux lourds plateaux accrochés en balancier aux deux extrémités d’une barre de bois posée en équilibre sur leurs épaules – et les autres piétons traversent imperturbablement ce flot qui les contourne en les frôlant, à défaut de négocier les trottoirs occupés par les cuisines de rue et leurs clients assis à croupetons sur de minuscules tabourets, aspirant bruyamment les nouilles qu’ils extraient avec des baguettes d’un bol fumant, cernés de scooters garés en rangs d’oignon serrés.
 La myriade d’îles de la baie d’Along plongée dans une épaisse brume sont colorées d’une infinie palette de gris et leurs silhouettes aux formes fantasmagoriques, dolichocéphales pour certaines dont une coiffée d’une petite pagode, dentelées comme les Dolomites et aux profils parfois curieusement humains pour d’autres, roches sombres nues ou couvertes de végétation, inhabitées à part par quelques singes guettant les bananes que leur lance Akbar, falaises tombant à pic dans l’eau ou rivages bordés d’une plage de sable fin, rochers plantés sur la mer tels des châssis de décors de théâtre les uns derrière les autres et entre lesquels évoluent tels des vaisseaux fantômes les innombrables jonques de touristes, les barques des pêcheurs lançant leurs filets et celles des magasins flottants aussi bien achalandés qu’une petite épicerie de quartier partis à l’abordage des navires ancrés dans la baie pour s’en détacher une fois l’affaire conclue, tandis qu’un large rapace noir plane silencieusement dans les airs à l’affût d’un quelconque poisson.
La myriade d’îles de la baie d’Along plongée dans une épaisse brume sont colorées d’une infinie palette de gris et leurs silhouettes aux formes fantasmagoriques, dolichocéphales pour certaines dont une coiffée d’une petite pagode, dentelées comme les Dolomites et aux profils parfois curieusement humains pour d’autres, roches sombres nues ou couvertes de végétation, inhabitées à part par quelques singes guettant les bananes que leur lance Akbar, falaises tombant à pic dans l’eau ou rivages bordés d’une plage de sable fin, rochers plantés sur la mer tels des châssis de décors de théâtre les uns derrière les autres et entre lesquels évoluent tels des vaisseaux fantômes les innombrables jonques de touristes, les barques des pêcheurs lançant leurs filets et celles des magasins flottants aussi bien achalandés qu’une petite épicerie de quartier partis à l’abordage des navires ancrés dans la baie pour s’en détacher une fois l’affaire conclue, tandis qu’un large rapace noir plane silencieusement dans les airs à l’affût d’un quelconque poisson.
(À suivre)
Jeff et Akbar sont les personnages d’une série de bandes dessinées de Matt Groening, qui est aussi le père de la fameuse – et infâme – famille Simpson.