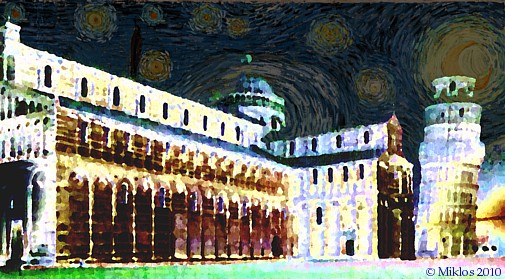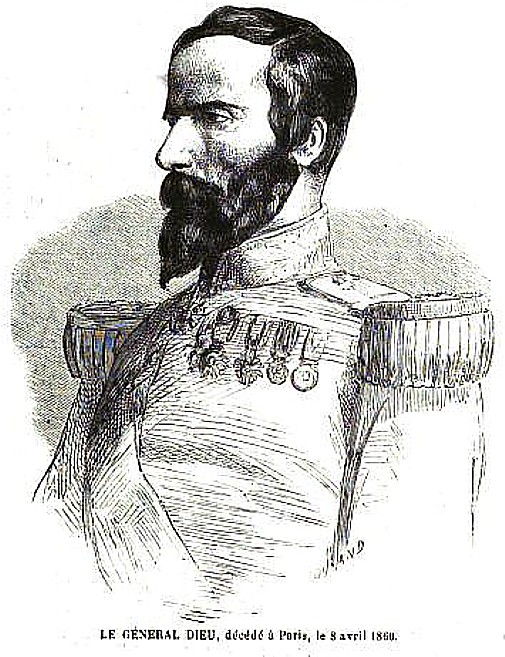Voici l’étymologie de quelques-unes des rues de Paris au XVIIe siècle (voir aussi les rues du Paris coquin un siècle plus tôt), selon un extrait du Supplément du Théâtre italien, ou recueil des scènes françaises qui ont été présentées sur le Théâtre italien de l’Hôtel de Bourgogne, lesquelles n’ont point encore été imprimées (1697), où on a rajouté quelques notes pour en faciliter la lecture. La plupart ont été supprimées.
Le vieillard.
Mon ami que vends-tu là ?
Arlequin, vendeur d’Almanachs.
Toute sorte de bons Livres : Pierre de Provence, la Belle Maguelone, Robert le Diable, Richard sans Peur, Roland le Furieux, Tiel l’Espiègle, les quatre fils Aimon, les Rues de Paris en Vers Burlesque et leur étymologie.
Le vieillard.
Voyons, je te prie, ce livre des rues de Paris ?
Arlequin.
Tenez, Monsieur, les voilà. Écoutez :
Rue d’Hablon.
Rue des Coquilles.
Rue des deux Portes.
Rue des Poupées…
Le vieillard.
Dis-moi un peu, d’où vient que ces rues-là se nomment comme cela : me le diras-tu bien ?
Arlequin.
Oui-da, Monsieur, je vous le dirai, avec plaisir.
Le vieillard.
Pourquoi la rue d’Hablon1 ?
Arlequin.
C’est la rue de Paris la plus passante, et comme il y passe beaucoup de Hâbleurs, on la nommée rue d’Hablon.
Le vieillard.
Pourquoi rue des Coquilles2 ?
Arlequin.
C’est une Rue où logeaient beaucoup de menteurs, et lorsqu’ils faisaient leurs mensonges on leur disait ; à qui vendez-vous vos coquilles3. C’est de là qu’est venu ce nom.
Le vieillard.
Rue des deux Portes4 ?
Arlequin.
Cette Rue est où demeurent tous les méchants Payeurs, lesquels ont chacun deux Portes à leurs maisons, et quand on leur vient demander de l’argent par une porte, ils sortent par l’autre, pour éviter leurs créanciers.
Le vieillard.
Et que veut dire celle-ci, Rue Poupée5 ?
Arlequin.
C’est où demeure une partie des Précieuses6 de Paris.
Le vieillard.
Rue Jean Pain-mollet7 : Celle-ci est drôle, vraiment ?
Arlequin.
C’est où demeurait un Garçon Boulanger lequel s’appelait Jean, et ne faisait que du pain mollet ; c’est pourquoi cette rue portait son nom.
Le vieillard.
Rue Princesse8, que veut dire celle-ci ?
Arlequin.
C’est une Rue où demeurait la Maîtresse de Jean Pain-mollet, et Jean Pain-mollet l’appelait toujours, en lui faisant l’amour, ma Princesse ; et ce nom est demeuré à la rue.
Le vieillard.
Oh ! par ma foi, en voici une drôle, je ne sais ce que tu pourrais dire pour son étymologie : Rue Jean Tison9 ?
Arlequin.
Dans cette Rue il y demeurait un garçon qui s’appelait Jean, et portait tous les matins à la Princesse un tison pour allumer son feu, et cette rue fut nommée la Rue Jean Tison.
Le vieillard.
Rue des Andouilles10 : Oh ! oh ! voilà une drôle de Rue ?
Arlequin.
C’est où furent achetées les Andouilles pour donner à la Princesse le jour de la Fête, par Jean Pain-mollet.
Le vieillard.
Rue du Pied de Bœuf11 ?
Arlequin.
C’est où fut acheté le Pied de Bœuf, que jean Tison donna à la Princesse pour sa Fête.
Le vieillard.
Rue Tireboudin12 : Oh ! voilà une plaisante rue ?
Arlequin.
C’est où la Princesse leur donna un bon morceau de bon Boudin pour payer sa Fête, l’un le tira par un bout, l’autre par l’autre : c’est pourquoi cette rue porte le nom de Tireboudin.
Le vieillard.
Rue du Sabot13, que veut dire celle-ci ?
Arlequin.
C’est où Jean Pain-mollet jeta son Sabot à la tête de Jean Tison.
Le vieillard.
Rue des Orties14 : et celle-là que veut-elle dire ?
Arlequin.
C’est que la Princesse passant dans un jardin elle tomba sur des Orties, qui lui piquèrent les fesses.
Le vieillard.
La Rue de la Moignon15 : oh ! en voilà une drôle ?
Arlequin.
C’est où Jean Pain-mollet prit le couperet d’un Boucher dont il coupa le poing à Jean Tison, et ne lui resta que le moignon : c’est pourquoi on la nomme la Rue de la Moignon.
Le vieillard.
Rue du Pet au Diable16 : oh ! foi d’homme d’honneur en voilà une qui est drôle ?
Arlequin.
C’est que la Princesse en courant, cria arrête de par tous les Diables ; en criant elle s’efforça et fit un pet : c’est pourquoi on la nomme la Rue du Pet au Diable.
Le vieillard.
La Rue de la Femme sans Tête17 : oh ! oh ! voilà une drôle de rue ?
Arlequin.
C’est comme Jean Pain-mollet étant aveuglé de colère ne prît pas garde où il frappait, et coupa la tête à la Princesse.
1 Il s’agit de la rue d’Ablon (l’auteur a rajouté un h pour justifier l’étymologie fantaisiste qu’il en donne), actuellement rue Saint-Médard. Son nom provient « du territoire d’Ablun, sur lequel il y avait des vignes appartenantes à l’Abbaye Sainte Geneviève » (Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, 1779).
2 Actuellement partie de la rue du Temple. Source : nomenclature officielle des voies publiques et privées, Ville de Paris (NOVP)
4 Actuellement partie de la rue des Archives, entre les rues de Rivoli et de la Verrerie. Dès la fin du XIIIe siècle, on l’appelait rue Entre Deux Portes et rue des Deux Portes, ou aussi rue Percée ; au XVIIe siècle, on la désignait sous le nom de rue de la Galiace. (NOVP)
5 Supprimée par l’ouverture du boulevard Saint-Michel. Elle commençait rue de la Harpe et finissait rue Hautefeuille. Elle avait porté anciennement le nom de Laas ou de Lias. En 1200, on la nommait Popée. En 1300, Poupée. On a aussi écrit Poinpée et Pompée. (NOVP)
6 « Précieuse, est aussi une épithète qu’on a donné ci devant à des filles de grand mérite et de grande vertu, qui savaient bien le monde et la langue : mais parce que d’autres ont affecté et outré leurs manières, cela a décrié le mot, et on les a appelées fausses précieuses, ou précieuses ridicules ; dont Molière a fait une Comédie, et de Pures un roman. » (Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690)
7 Supprimée par l’ouverture de la rue de Rivoli. Elle commençait rue de la Coutellerie (supprimée) et finissait rue des Arcis (rue Saint-Martin). Avant sa suppression elle avait été réunie à la rue des Ecrivains. Sauval prétend qu’elle s’est appelée rue du Croc. Sur le plan de la Tapisserie on lui donne le nom de la Radrerie. (NOVP)
8 Ouverte en 1630. Doit son nom à une princesse de la maison de Guise. (NOVP)
9 Doit son nom à Jean Tison, bourgeois du XIIIe siècle. Cette voie existait en 1205. Une partie de cette voie, comprise entre la rue de Rivoli et la rue des Fossés Saint-Germain l’Auxerrois (actuellement rue Perrault), a été supprimée pour le dégagement du Louvre et des Tuileries (1854). (NOVP)
10 Il doit s’agir de la rue pavée d’Andouilles, ou Pavée. Actuellement rue Séguier. (NOVP)
11 Supprimée en 1813 pour la formation de la place du Châtelet. Elle commençait rue de la Tuerie (sup.) et finissait rue de la Joaillerie (sup.). Elle se continuait autrefois jusqu’à la rivière et a été souvent confondue avec la rue de la Triperie. (NOVP)
12 Actuellement rue Marie Stuart. (NOVP)
13 Nom tenant son origine d’une enseigne. C’était au XVIe siècle, la rue Copieuse ; rue de l’Arpenteur en 1595 et déjà rue du Sabot sous Louis XIII. En 1723, rue aux Vaches. Elle aurait aussi porté le nom de rue Saunet le Breton. (NOVP)
14 Ou Orties Saint-Honoré. Supprimée par l’ouverture de l’avenue de l’Opéra. Elle commençait rue d’Argenteuil et finissait rue Sainte-Anne. (NOVP)
15 Ou Lamoignon. Supprimée par une ordonnance royale de 1840. Elle était située dans le Palais de Justice. (NOVP)
16 Supprimée par l’agrandissement de l’Hôtel de Ville. Elle commençait rue du Martroi (sup.) et finissait rue de la Tixeranderie (sup.). Elle a porté les noms de rue du Chevet Saint-Jean, du Cloître Saint-Jean, du Sanhédrin. En 1815, elle prit le nom de rue du Tourniquet. (NOVP)
17 Actuellement partie de la rue Le Regrattier (4e arrondt.). (NOVP)