Life in Hell : Made in Italy
« Quand on arrive de France, et que l’on vient de traverser les Alpes de la Savoie, Turin semble une ville italienne ; quand on revient de Naples ou de Rome, on se croirait dans une ville française. Turin, la plus petite des capitales, est peut-être la plus propre et la plus régulière des villes. La plupart de ses rues sont tracées au cordeau et décorées de chaque côté d’édifices semblables. Quelques-unes sont même bordées d’une double rangée de portiques à arcades. » Frédéric Bourgeois de Mercey, « La Galerie royale de Turin », in La Revue des deux mondes, t. 28, 1841.
Le chef d’orchestre s’ennuyait. Il ne dirigeait que d’une main distraite et sans grandes nuances l’orchestre qui n’avait d’ensemble que le nom : les musiciens – peu nombreux, l’œuvre requérant une formation de chambre – devaient s’ennuyer aussi et, ne prêtant pas une attention particulière à leurs collègues, ne brillaient pas par la synchronie de leur jeu. Quant au public, il était tout aussi peu nombreux, la salle aux trois-quarts vide, programme sans doute trop contemporain pour les habitués : c’était pourtant des Danses concertantes que l’orchestre de la RAI était en train d’exécuter (littéralement), mais le nom du compositeur – Stravinsky – fait fuir encore bien des auditeurs près de quarante ans après sa mort.
L’œuvre suivante, le Concerto pour violon de Korngold avait pourtant tout pour les charmer : le néo-romantisme débordant, qui faisait se pâmer la jeune soliste qui possédait une bonne technique et une belle sonorité, mais qu’on s’attendait à se voir liquéfier d’émoi sur la scène quand elle ne se lançait pas dans des trémolos vigoureux (un regain de l’école russe de violon, que Chloë Hanslip avait suivie ?), les leitmotifs insistants limite harcèlement, le réveil de Jeffrey Tate qui se mit à diriger avec entrain, et le bref rappel hypervirtuose et néo-paganinien de John Corigliano… À l’entracte, Anna, Luca et Akbar décidèrent comme un seul homme de ne pas se soumettre aux 45 minutes de la première symphonie de Walton qui s’ensuivait et sortirent de l’auditorium de la RAI. Dommage, l’acoustique y était vraiment excellente, se dit Akbar.
•
 Avant le concert, Anna les avait emmené manger léger – une nécessité après les délicieux repas qui avaient ponctué la conférence – dans un petit restaurant de quartier, Alla Mole, situé via Giuseppe Verdi, comme il se doit pour une soirée musicale. Sa pizza à la roquette méritait non seulement une mention particulière – dont acte – mais de revenir le lendemain soir, ce qu’Akbar n’hésita pas à faire, nonobstant son régime : la pâte fine, élastique, savoureuse et légèrement dorée et croustillante sur les bords, le sel discret à souhait ; une fine couche de mozzarella, des tomates fraîches, des feuilles de roquette et un soupçon d’origan ; chaude et généreuse tout en étant parfaitement digeste, quel plaisir !
Avant le concert, Anna les avait emmené manger léger – une nécessité après les délicieux repas qui avaient ponctué la conférence – dans un petit restaurant de quartier, Alla Mole, situé via Giuseppe Verdi, comme il se doit pour une soirée musicale. Sa pizza à la roquette méritait non seulement une mention particulière – dont acte – mais de revenir le lendemain soir, ce qu’Akbar n’hésita pas à faire, nonobstant son régime : la pâte fine, élastique, savoureuse et légèrement dorée et croustillante sur les bords, le sel discret à souhait ; une fine couche de mozzarella, des tomates fraîches, des feuilles de roquette et un soupçon d’origan ; chaude et généreuse tout en étant parfaitement digeste, quel plaisir !
Ce restaurant tient son nom du bâtiment qui héberge actuellement le musée national du cinéma à l’architecture aussi singulière que son histoire, et devenu le symbole de Turin : destinée à être une synagogue, la Mole Antonelliana est le fruit du délire de son architecte auquel elle doit son nom (Alessandro Antonelli) dépassant, en budget et en hauteur (113 m, et ultérieurement, 167 m), la commande initiale de la communauté juive (67 m) qui se retira du projet. L’intérieur, vide, est aménagé de façon spectaculaire en cinq niveaux sur le pourtour de l’édifice et propose une très riche histoire du cinéma, les merveilleuses inventions qui l’ont émaillée – les ombres chinoises, les lanternes magiques, la photographie, les chambres obscures, la stroboscopie… – ses metteurs en scène, ses acteurs et ses stars mythiques… Le rez-de-chaussée du musée est une immense salle de cinéma avec deux écrans géants et où trône un immense Moloch, et dont le pourtour consiste en des décors reconstituant des lieux magiques.
•
Turin n’a pas que la Mole de spectaculaire. On est, après tout, en Italie, et tout y est spectacle : les galeries couvertes, même celles d’immeubles plus récents, sont monumentales (sept à huit mètres de haut), les façades sont monumentales, les places sont monumentales. Les palais sont légions. Les étalages et les devantures – de pâtisseries, de glaces (Akbar préféra celle au parfum de cassate à la ricotta) –, les magasins d’habits, sont des combinaisons chatoyantes et d’une grande élégance. On est dans la mise en scène permanente.
La visite de la La Venaria Reale, à l’origine pavillon de chasse de la famille de Savoie, transformé en un complexe et labyrinthique palais royal, puis abandonné, voire partiellement détruit ou brûlé à diverses époques, et enfin récemment restauré de façon remarquable et agrémenté d’une mise en scène intéressante de Peter Greenaway, a constitué un splendide point d’orgue à ce bref séjour. Guidés par l’historien et le conservateur Andrea Merlotti, un homme passionné et particulièrement bien informé, Akbar et Anna ont traversé avec étonnement et plaisir, en parcourant ce très riche complexe, les quelque mille ans de l’histoire de la Maison de Savoie, celle de ses principaux personnages et de ses États aux frontières fluctuantes au fil des siècles.
•
Revenu à Paris, Akbar regretta le caffè, la polenta et les autres petits plaisirs quotidiens qu’il avait appréciés durant son séjour.
•
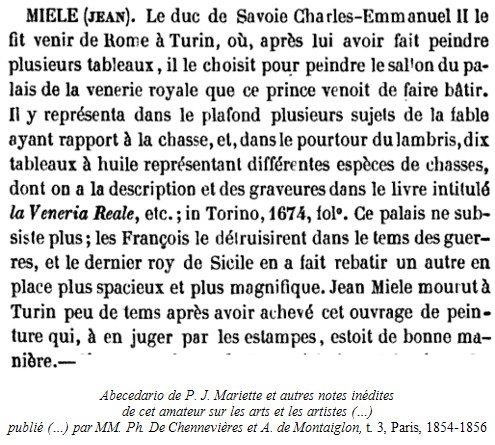
Jeff et Akbar sont les personnages d’une série de bandes dessinées de Matt Groening, qui est aussi le père de la fameuse – et infâme – famille Simpson.



