Un voyage dans l’essentiel







 L’Occident est irrémédiablement engrécé : mythes originels, musique, poésie, théâtre, sculpture, architecture, mathématiques, physique et astronomie, philosophie et politique, il doit une grande partie de sa pensée, de ses sciences et de ses arts (et donc de l’éthique, du savoir et de l’esthétique) à la Grèce antique, qui est aussi à la source de nombre de mots quotidiens ou savants qui nous aident à percevoir et à structurer le monde dans lequel nous vivons ; même le christianisme est le fruit de la transformation opérée sur la tradition juive par le monde hellène.
L’Occident est irrémédiablement engrécé : mythes originels, musique, poésie, théâtre, sculpture, architecture, mathématiques, physique et astronomie, philosophie et politique, il doit une grande partie de sa pensée, de ses sciences et de ses arts (et donc de l’éthique, du savoir et de l’esthétique) à la Grèce antique, qui est aussi à la source de nombre de mots quotidiens ou savants qui nous aident à percevoir et à structurer le monde dans lequel nous vivons ; même le christianisme est le fruit de la transformation opérée sur la tradition juive par le monde hellène.
Et aujourd’hui ? L’influence de la Grèce contemporaine est moins universelle qu’alors (du moins en ce qui concerne l’Occident se voyant comme l’univers), mais l’on ne peut ignorer, pour ne parler que des arts, les contributions de grands créateurs tels que celles de Constantin Cavafy ou Georges Seferis à la poésie, de Cornelius Castoriadis à la philosophie, de Theodoros Angelopoulos ou de Costa-Gavras au cinéma, celles des compositeurs Iannis Xenakis, Georges Aperghis et Mikis Theodorakis à la musique, de Georges Moustaki à la chanson, et de Manos Hadjidakis ou de Vangelis au pop. Quant à ses interprètes, qui ne connaît la cantatrice Maria Callas, l’actrice Irène Papas, le pianiste Dimitri Vassilakis ou les chanteuses Melina Mercouri et Nana Mouskouri ?
Dans le domaine du chant on a malheureusement relégué trop rapidement aux oubliettes des fonds discographiques inexploités la très grande Maria Farantouri1 au profit d’interprètes de bien moindre envergure2 que celle dont François Mitterrand disait, avec ce sens si profond de l’histoire, de la culture et de la formulation qu’il possédait, “Maria, pour moi, c’est la Grèce. Je me représente Hera, comme cela, forte, vigilante. Je ne connais pas d’artiste qui m’ait à ce point fourni le sens du mot sublime”.

Sa voix chaude et sombre, puissante et profonde, sobre et émouvante est inséparable pour moi comme pour d’autres de la musique de Mikis Theodorakis qui l’avait découverte quand elle avait seize ans, et dont elle a chanté certaines des œuvres les plus fortes, et, au tout premier chef, la déchirante Ballade de Mauthausen, écrite sur des poèmes de Iakovos Kambanellis qui avait survécu miraculeusement à ce terrible camp (et que Theodorakis a transformée, trente ans plus tard, en une Cantate). Voici le premier de ces quatre poèmes où on peut entendre Maria Farantouri en chanter la première strophe :
| Cantique des Cantiques | Ασμα Ασματμων |
|---|---|
| Qu’elle est belle, mon amour Avec sa robe de tous les jours Avec un petit peigne dans ses cheveux Personne ne le savait, qu’elle était aussi belle. — Jeunes filles d’Auschwitz, Jeunes filles de Dachau, N’avez-vous pas vu mon amour ? — Nous l’avons vue, dans un lointain voyage Elle ne portait plus sa robe Ni de peigne dans ses cheveux. Qu’elle est belle, mon amour Choyée par sa mère et les baisers de son frère. Personne ne le savait, qu’elle était aussi belle. — Jeunes filles de Mauthausen, Jeunes filles de Belsen, N’avez-vous pas vu mon amour ? — Nous l’avons vue sur la place gelée, Un numéro dans sa main blanche et une étoile jaune sur le cœur. Qu’elle est belle, mon amour Choyée par sa mère et les baisers de son frère. Personne ne le savait, qu’elle était aussi belle. |
Τι ωραία που είναι η αγάπη μου με το καθημερινό της φόρεμα κι ένα χτενάκι στα μαλλιά! Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Άουσβιτς, του Νταχάου κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου; Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι. Δεν είχε πια το φόρεμα της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και τ’ αδελφού της τα φιλιά! Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Μαουτχάουζεν, κοπέλες του Μπέλσεν, μην είδατε την αγάπη μου; Την είδαμε στην παγερή πλατεία μ’ ένα αριθμό στο άσπρο της το χέρι, με κίτρινο άστρο στην καρδιά. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και τ’ αδελφού της τα φιλιά! Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. |
Le protéiforme Theodorakis (dont le site est un labyrinthe rempli de trésors) est une voix de la conscience, contre les tyrannies et les dictatures — autant celle des colonels en Grèce que le nazisme ou le colonialisme —, contre les massacres et les exterminations, contre la misère de l’homme. Parmi ses autres cycles de chant auxquels Farantouri a donné sa voix, il y a l’oratorio Canto General, la grande œuvre du poète chilien Pablo Neruda, dans laquelle il décrit “la naissance [du] continent [américain] et l’histoire des peuples qui y ont vécu, qui y vivent, y souffrent et y luttent contre les oppresseurs venus avec les armes pour exploiter les hommes et la richesse d’une nature exubérante”. Le compositeur y a effectué des choix sous la recommandation d’Allende et de Neruda, et en a fait une œuvre qui exprime autant l’âme latine que la culture grecque, se retrouvant toutes deux dans l’universel qui fait l’homme dans sa diversité.
1 Son nom de famille est transcrit du grec de diverses façons (dues à la proximité des plosives alvéolaires τ et δ…) — Farandouri ou Farantouri — c’est cette dernière forme, utilisée sur son site, que nous avons adoptée ici.
2 Telle Angelica Ionatos, dont j’ai parlé ailleurs.

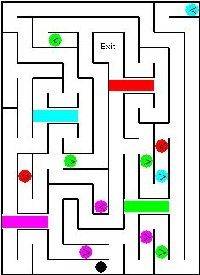 Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “
Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “


 Ce n’est pas uniquement dû aux sièges inconfortables ; pourtant, je devais faire le grand écart assis (déjà que debout ça n’est pas facile pour un homme…) pour placer mes genoux en évitant d’avoir à les remonter jusqu’à mon menton, de par la proximité des sièges encore plus grande que dans la classe économique d’un charter pakistanais. Ce n’est pas que j’étais assis cette fois-ci à une place sans visibilité comme il m’arrive assez souvent, d’où l’on aperçoit un bout du côté cour de la scène tandis que l’action se passe côté jardin. Ce n’est même pas le public — qui toussait ce soir comme la Dame aux Camélias à sa dernière extrémité, entrant et sortant de la salle en plein concert (comme lors du Pavillon des Pivoines, mais cet opéra chinois durait 18 heures), ni cette voisine qui, à l’instar d’un Casals ou d’un Gould (mais sans violoncelle ni piano) fredonnait la musique, ou encore mon jeune voisin de gauche qui s’endormait à chaque pièce pour se réveiller au moment où elle se terminait. Et aucun téléphone portable n’a sonné durant le concert, cette fois-ci. Thank God for small blessings.
Ce n’est pas uniquement dû aux sièges inconfortables ; pourtant, je devais faire le grand écart assis (déjà que debout ça n’est pas facile pour un homme…) pour placer mes genoux en évitant d’avoir à les remonter jusqu’à mon menton, de par la proximité des sièges encore plus grande que dans la classe économique d’un charter pakistanais. Ce n’est pas que j’étais assis cette fois-ci à une place sans visibilité comme il m’arrive assez souvent, d’où l’on aperçoit un bout du côté cour de la scène tandis que l’action se passe côté jardin. Ce n’est même pas le public — qui toussait ce soir comme la Dame aux Camélias à sa dernière extrémité, entrant et sortant de la salle en plein concert (comme lors du Pavillon des Pivoines, mais cet opéra chinois durait 18 heures), ni cette voisine qui, à l’instar d’un Casals ou d’un Gould (mais sans violoncelle ni piano) fredonnait la musique, ou encore mon jeune voisin de gauche qui s’endormait à chaque pièce pour se réveiller au moment où elle se terminait. Et aucun téléphone portable n’a sonné durant le concert, cette fois-ci. Thank God for small blessings. Ce n’est surtout pas le programme : le premier livre du Clavier bien tempéré de J.S. Bach est une œuvre devant laquelle on ne peut rester insensible, même si on n’est pas un inconditionnel du Cantor de Leipzig comme je le suis (sur une île déserte, équipée d’électricité et d’une chaîne stéréo, je ne manquerai pas d’y emporter les enregistrements que je possède de ce compositeur, avant tout autre). C’était l’interprétation. Daniel Barenboim est sans conteste un musicien extrêmement doué. C’était d’ailleurs un enfant prodige, qui a donné son premier concert à l’âge de sept ans. Il a croisé les plus grands : Artur Rubinstein et Adolf Busch ; Wilhelm Fürtwangler, Sergiu Celibidache, Josef Krips ou Otto Klemperer ; il prendra des cours de piano avec Edwin Fischer (photo ci-contre), le plus grand mozartien du
Ce n’est surtout pas le programme : le premier livre du Clavier bien tempéré de J.S. Bach est une œuvre devant laquelle on ne peut rester insensible, même si on n’est pas un inconditionnel du Cantor de Leipzig comme je le suis (sur une île déserte, équipée d’électricité et d’une chaîne stéréo, je ne manquerai pas d’y emporter les enregistrements que je possède de ce compositeur, avant tout autre). C’était l’interprétation. Daniel Barenboim est sans conteste un musicien extrêmement doué. C’était d’ailleurs un enfant prodige, qui a donné son premier concert à l’âge de sept ans. Il a croisé les plus grands : Artur Rubinstein et Adolf Busch ; Wilhelm Fürtwangler, Sergiu Celibidache, Josef Krips ou Otto Klemperer ; il prendra des cours de piano avec Edwin Fischer (photo ci-contre), le plus grand mozartien du  Ce soir (comme il y a une trentaine d’années, quand j’avais entendu Barenboim jouer le concerto n° 20 en ré mineur K. 466 de Mozart), il n’y avait pas d’âme, il y manquait de la profondeur, de la rigueur, de la structure : une œuvre de Bach est une architecture majestueuse et complexe qui n’est pas sans rappeler les œuvres des peintres de la Renaissance italienne après qu’ils aient découvert la perspective, tels le Tintoret ou Véronèse. Ce soir, c’était plat. Non pas que la dynamique n’était pas variée, bien au contraire : Barenboim a su faire sonner le piano du plus doux au plus fort (et souvent trop fort, parfois brutalement), mais est-ce justement ce que l’on attend dans Bach, où l’intensité s’exprime bien plus dans le contenu musical et la tension qu’il induit que par la mécanique de l’instrument — et pour cause, les instruments à clavier de son époque (clavecin ou orgue) n’étant capables de varier cette intensité que par des artifices de registration ? Son utilisation de la pédale était aussi outrée, et contribuait à produire une macédoine de sons là où la clarté s’impose. Approche finalement romantique très
Ce soir (comme il y a une trentaine d’années, quand j’avais entendu Barenboim jouer le concerto n° 20 en ré mineur K. 466 de Mozart), il n’y avait pas d’âme, il y manquait de la profondeur, de la rigueur, de la structure : une œuvre de Bach est une architecture majestueuse et complexe qui n’est pas sans rappeler les œuvres des peintres de la Renaissance italienne après qu’ils aient découvert la perspective, tels le Tintoret ou Véronèse. Ce soir, c’était plat. Non pas que la dynamique n’était pas variée, bien au contraire : Barenboim a su faire sonner le piano du plus doux au plus fort (et souvent trop fort, parfois brutalement), mais est-ce justement ce que l’on attend dans Bach, où l’intensité s’exprime bien plus dans le contenu musical et la tension qu’il induit que par la mécanique de l’instrument — et pour cause, les instruments à clavier de son époque (clavecin ou orgue) n’étant capables de varier cette intensité que par des artifices de registration ? Son utilisation de la pédale était aussi outrée, et contribuait à produire une macédoine de sons là où la clarté s’impose. Approche finalement romantique très 


