La Venise du Proche-Orient, ou, l’histoire d’un piqué et de son marteau-piqueur
Si Tel Aviv a gagné en 2011 la réputation d’être la ville la plus gay du monde – comble dans un pays où théocratie et démocratie font un bien curieux ménage –, elle a, dans un monde parallèle, acquis en 1968 le statut de Venise du Proche-Orient. Voici comment.
Profitant de l’inattention d’un gardien lors du passage d’un camion laitier venu effectuer une livraison dans l’asile d’aliénés où il est enfermé, Blaumilch – on n’apprendra que beaucoup plus tard son nom, c’est d’ailleurs le seul mot qu’on l’entendra prononcer – s’échappe. Pourquoi y était-il ? Pour une névrose obsessionnelle qui l’occupe jour et nuit : creuser, creuser, et encore creuser. Des tranchées, des tunnels, n’importe quoi. Jour et nuit.
Le véhicule dans lequel il s’était caché s’arrête dans un chantier. Blaumilch en descend en catimini – personne ne semble étonné de le voir habillé d’une camisole de force dont il est arrivé à délier les manches – et tombe en arrêt, fasciné, devant un marteau-piqueur et son générateur électrique mobile. Il s’en saisit et le traîne derrière lui le long des quelques kilomètres qui le séparent de Tel Aviv.
Il s’installe au beau milieu de l’un des carrefours les plus passants de la ville : celui au coin des rues Allenby – qui commémore le général Allenby (1961-1936) à qui le Royaume Uni doit la conquête de la Palestine des mains des Ottomans – et Ben Yehuda – Eliézer de son prénom, à qui l’on doit la renaissance de l’hébreu comme langue parlée. Ce carrefour se trouve à quelques centaines de mètres de la mer et on y voit en proéminence le bâtiment de la Zim, compagnie de navigation israélienne (dont, soit dit en passant, mon père dirigeait le bureau européen).
Il commence à creuser. Immédiatement, c’est l’embouteillage. Un policier chargé de la circulation, dont la bonne volonté et le respect de la loi sont inversement proportionnels à son QI, se disant que si cet ouvrier était là, c’est qu’il devait l’être, et qu’il fallait donc l’aider à remplir sa mission, commence à ériger des barrières pour le protéger, ce qui a pour effet de bloquer entièrement la circulation.
Les chauffeurs israéliens – ce sont des méditerranéens, après tout, même si pour certains d’origine récente – ont le sang très chaud : cris, insultes, rixes, klaxons, se rajoutent au vacarme incessant du marteau-piqueur. Le voisinage en perd la raison : l’établi de l’horloger tremble tellement qu’il ne peut plus réparer les montres qu’on lui apporte, le dentiste n’ose plus utiliser sa fraise, le jeune couple d’amoureux est refroidi par le bruit insoutenable, les personnes plus âgées s’énervent, crient, jettent des pots de fleur par la fenêtre. Il n’y a que les vendeurs de casques anti-bruit qui profitent de l’occasion pour augmenter subrepticement leurs prix. Imperturbable, imperturbé, Blaumilch continue de creuser, s’arrêtant parfois pour donner un coup de marteau-piqueur dans une conduite d’eau pour aider une personne à se laver les mains, tandis le policier serviable fait le vide autour de lui et le protège des tentatives d’agression destinées à mettre fin à ce vacarme. Une tranchée se dessine, puis une autre. Des tas de gravats s’amoncellent et dessinent un paysage de champ de bataille. Les voitures ne passent plus.
La municipalité en est vite saisie et ce qui n’est à l’origine qu’un fait-divers tourne au politique. Ziegler, un jeune homme bien de sa personne et dont l’amoureuse habite sur le carrefour, est l’assistant du directeur du département de la mairie de Tel Aviv chargé des travaux publics. Son patron, Dr Kouïbyshevski (à l’époque, sous l’influence de l’immigration d’origine allemande, toute personne importante s’appelait « Docteur ») est plus intéressé par les formes de sa secrétaire aussi bête que sexy et à faire virevolter des boîtes d’allumettes d’une pichenette que par le quotidien de son service dont s’occupe le jeune Ziegler.
Personne ne sait « qui a donné l’ordre » – phrase oh combien célèbre en Israël, allusion à l’« affaire Lavon ». Si ce n’est pas ce département, serait-ce celui que dirige Schultheiss, pantin aux mains de son assistante (qui, elle, a oublié d’être bête) et ennemi juré de Kouïbyshevski sauf quand ils sirotent un verre de thé – à la russe – à quatre, avec leurs assistants ?
Quant au maire, dont la taille singulièrement réduite est inversement proportionnelle à son ambition et à sa volonté de gagner les élections qui se rapprochent en évitant tout scandale et en présentant ces travaux comme un accomplissement de la municipalité qui veille au bien être des Telaviviens, il a, lui aussi, son assistant qui lui dit quand parler et quand la fermer.
L’engrenage est inévitable : la municipalité, tout en ne sachant pas le pourquoi du comment, mobilise les quelques autres marteaux-piqueurs et pelleteuses en sa possession pour assister Blaumilch dans sa tâche. Entre temps, Ziegler, qui a deviné de quoi il en relève – qu’il s’agit finalement d’un fou – essaie de prévenir sa hiérarchie, mais celle-ci fait la sourde oreille : à ce stade, cette vérité serait catastrophique, toutes ces grosses huiles auraient beaucoup à perdre, leur poste et les élections à venir. C’est donc Ziegler qui doit être fou.
Et l’apocalypse joyeuse arrive, malgré une tentative de sabotage organisée par quelques voisins du chantier, qui se terminera de façon hallucinante (et hilarante) au commissariat : les tranchées de Blaumilch, dorénavant occupant toute la largeur des artères qu’elles remplacent, rejoignent finalement la mer qui s’y engouffre, balayant par la même occasion la commission d’enquête chargée de déterminer les responsabilités mais dont le président, copain comme cul et chemise avec Kouïbyshevski, n’a d’évidence pas envie d’aller au fond de l’affaire.
Voilà les rues transformées en canaux, que le maire inaugure dans une fête solennelle et splendide au cours de laquelle sont organisées des manifestations de ski nautique, d’aviron et de natation se déroulant au pied de l’immeuble de la Zim dont on comprend finalement la raison d’être en ce lieu ; une chorale entonne des chants patriotiques et nostalgiques, combinaison commune dans les quelques premières décennies de l’État d’Israël ; le rabbinat donne sa bénédiction, et le tout se termine par le discours du maire, qui démontre que son initiative personnelle d’engager ces travaux n’aura été que pour le bien des habitants. Et ceux-ci sont ravis : ces rues, autrefois si bruyantes du fait de la circulation puis des travaux gigantesques et incessants sont devenues relativement calmes ; il y a bien des échauffourées entre les chauffeurs de taxis fluviaux, ceux-là même qui s’étripaient quand ils conduisaient des camions sur la même voie, il y a bien le jeune couple qui, pour faire l’amour, doit mettre en musique de fond un enregistrement des marteaux piqueurs, mais globalement tout le monde est aux anges.
Sauf Blaumilch. Personne ne lui a rendu hommage. Il s’éclipse. Et Ziegler, qu’une ambulance emmène pour l’enfermer dans l’asile d’où s’était échappé Blaumilch, l’aperçoit installé avec son marteau-piqueur au beau milieu du carrefour de la mairie qu’il commence à défoncer, avec, à ses côtés, un policier pour le protéger.

Le canal de Blaumilch (en anglais The Big Dig, en hébreu תעלת בלאומילך ) est un film réalisé en 1968 – quatre ans après l’achèvement du long canal amenant de l’eau du lac de Tibériade vers le désert du Néguev – par Efraïm Kishon (1924-2005), grand humoriste israélien d’origine hongroise (il avait gardé son accent toute sa vie). Satire aimable de nombreux travers de la société israélienne, de ses comportements sociaux et (a)culturels, de son administration pléthorique et irrationnelle, et dont l’inéluctable et sympathique victime est l’individu – thème que Kishon traitait aussi dans ses autres productions –, ce film, fort bien filmé et joué, est interprété par d’excellents acteurs, parmi les meilleurs de leur époque en Israël, pour la plupart venus du théâtre.
Certains passages (notamment ceux où l’on voit Kouïbyshevski se déplacer, avec une démarche très particulière, dans les couloirs de la mairie, suivi par sa cour) font inévitablement penser au génial Brazil, sorti 17 ans plus tard, à se demander si Terry Gillam aurait vu ce film qui avait été retenu (« nominé ») au Golden Globe Award dans la catégorie « meilleur film étranger ». L’absurde de la situation, les décors et leurs couleurs vives, la pantomime des acteurs (l’un d’eux a d’ailleurs été le premier mime israélien) rappellent aussi immanquablement les films de Jacques Tati, qui, eux, ont précédé celui-ci (à l’exception de Trafic et de Parade).
On en trouve deux versions intégrales sur YouTube, l’une doublée en allemand, l’autre sous-titrée en russe. C’est cette dernière qu’on a préféré afficher ici : dans la majeure partie du film, le langage des corps se suffit. Et là où le texte compte, au moins on en entendra les voix et les sonorités d’origine.

Les anglophones – ou ceux qui pensaient jusqu’ici comprendre cette langue – apprécieront sans nul doute cette page de Qwika, se(r)vice de recherche dans toutes les Wikipediae et les wikis en général, consacrée au film en question. Pour nos lecteurs francophones, on tentera d’en donner ici une fidèle traduction dans la langue de Molière en en préservant la police (qui joue d’ailleurs un rôle si important dans ce film) :
le canal bleu (hébr. Unité de largeur alat lait bleu et/ou. Anglais. Au Creusement tourné) est le titre d’une pièce radiophonique d’Ephraim gravier-de-pierre-ponce et un film éponyme, qui sous la direction de gravier-de-pierre-ponce d’après la pièce radiophonique pièce une devenu.
la pièce radiophonique est dans un livre éponyme de 1971 (titre : Le canal bleu. Satires. Pièces radiophoniques et pièces d’un acte), qui est présent dans la traduction allemande de la montagne de la porte Friedrich.
l’acte de satire bureaucratique du lait bleu Kasimir, qui s’est enfui de la psychiatrie et creuse dans le milieu avec un marteau-pneumatique volé à Tel Aviv la rue principale. Quand la police commence, quelles rues commence à fermer et les résidents adjacents peser environ les 24-Stunden-Lärm les autorités commence avec la recherche de l’auteur de toute la conduite. […]
Ephraim gravier-de-pierre-ponce, pardon, Efraïm Kishon, aurait, lui aussi, apprécié.

On conclura cette excursion dans les liquides par le texte suivant qui démontre les vertus du lait bleu, et notamment dans le cas de l’acrimonie huileuse du sang. Il provient de Discourses on Tea, Sugar, Milk, Made-Wines, Spirits, Punch, Tobacco, &c., with Plain and Useful Rules for Gouty People, écrit par Dr Thomas Short et publié à Londres en 1750.
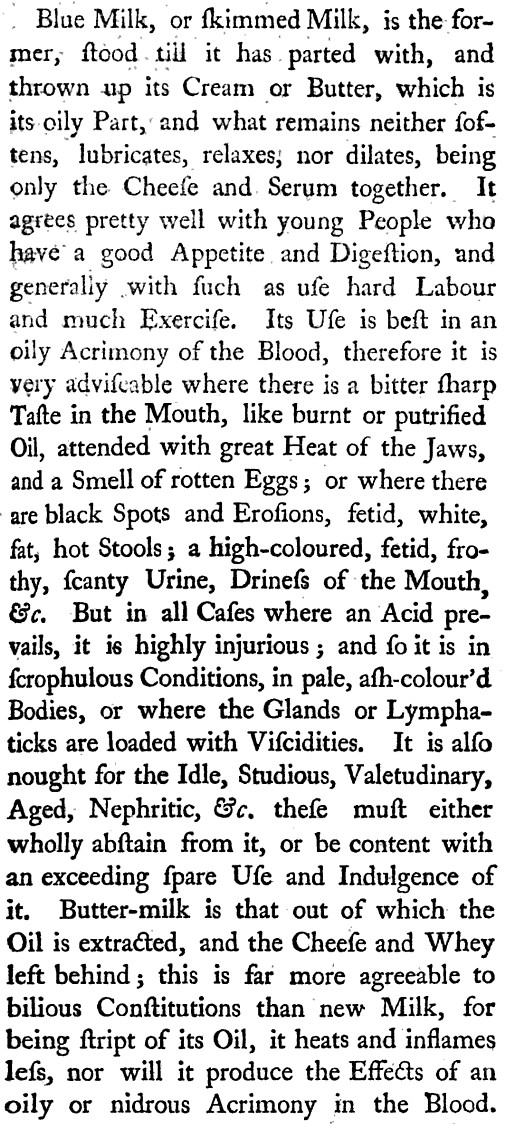


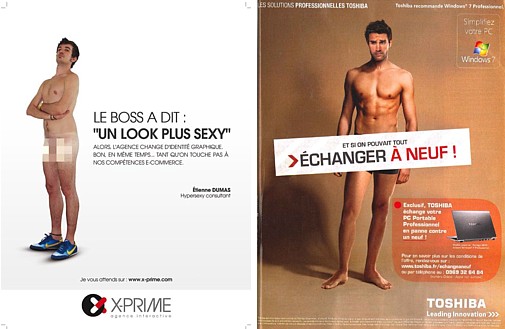
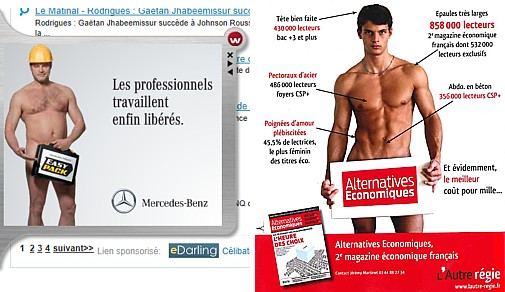



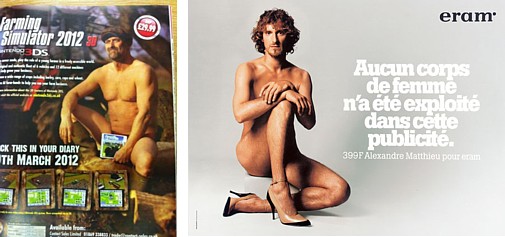







 Si vous avez aimé
Si vous avez aimé 
