Paris et le concert symphonique
Les Français sont plus fâchés que les Allemands ou les Anglais avec la musique symphonique – et chorale, d’ailleurs. Est-ce dû à l’engouement français pour l’opéra dans la première moitié du 19e s., comme le relate ironiquement Pierre Lalo (fils d’Édouard) – ou à l’esprit national prétendument individualiste et frondeur ? Force est de constater que le répertoire français en est moins riche que celui de nos voisins, et que les orchestres symphoniques français ne sont pas souvent cités parmi les trois ou quatre meilleurs du monde. Cause ou effet, Paris souffre du manque de salles de concert adéquates, comme l’analysait Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la Musique, lors d’une séance de l’Académie des Beaux-Arts en 2004. La seule qui s’en rapproche est la salle Pleyel, « aujourd’hui mal adaptée aux réalités de la vie symphonique internationale, tant en termes d’acoustique que d’accueil du public, voire surtout d’accueil des musiciens. »
On aura suivi les débats souvent vifs qui se sont tenus, il y a quelques années, autour de cette problématique : réhabiliter Pleyel (que la Ville et l’État n’avaient pu racheter lors de sa vente par le Crédit Lyonnais en difficulté, et qui était passé aux mains d’un propriétaire privé) ? construire une nouvelle salle à la Cité de la musique (comme le défendait Pierre Boulez) ? ailleurs (par exemple du côté du Grand Palais, de la Gaieté Lyrique ou de Chaillot) ? Quid de la problématique de sa localisation à Paris ? Tous ces aspects avaient été analysés par André Larquié – qui avait été président de RFI et deviendra celui de la Cité de la musique – dans un rapport que lui avait demandé Catherine Trautmann, ministre de la culture en 1999.
Eh bien, les deux premières alternatives ont été choisies : Pleyel vient d’être réhabilité et rouvrira en 2006 (avec 1900 places), et la Ville et l’État se sont finalement accordées à parité pour la réalisation d’une grande salle symphonique de 2000 à 2500 places à la Cité de la musique, avec réouverture en 2012. Et dans la foulée, un nouvel auditorium (de 1500 places) viendra remplacer le studio Olivier Messiaen dans une Maison de Radio France réhabilitée en 2010.
Ces trois annonces ont été faites par le ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres, lors de la présentation de la saison de réouverture de la salle Pleyel qui s’est tenue à la Cité de la musique lundi dernier, en présence du maire de Paris, Bertrand Delanoë – qui a annoncé pour sa part son intention de faire étendre le tramway en construction jusqu’à la Cité de la musique – , du président-directeur général de Radio-France, Jean-Paul Cluzel, du directeur général de l’Orchestre de Paris, Georges-François Hirsch et de Pierre Boulez. Pourquoi à la Cité ? Parce que Laurent Bayle préside Cité-Pleyel, la filiale de la Cité (dont les statuts ont été changés in extremis pour lui permettre d’avoir des filiales) chargée de gérer l’exploitation de la salle Pleyel.
Si le prétexte était la présentation par Laurent Bayle de la saison de réouverture de Pleyel, ce qui a retenu l’attention du public et des médias a été l’annonce de la construction de la grande salle à la Cité. Comme l’a remarqué le ministre, « Pierre Boulez n’a pas applaudi. Il attend sans doute pour le faire que la première note soit jouée dans cette salle », et si c’est le cas, il a bien raison d’être prudent. On sait le sort que des changements politiques peuvent réserver à des projets de fins de mandature, et il doit se souvenir de celui qui a été réservé à la grande salle de concert qui aurait dû être construite à l’Opéra Bastille. Enfin, on ne sait toujours pas quelle sera la participation financière de la Région dans ce projet. À ma question à ce propos, Bertrand Delanoë a répondu qu’il avait décidé que la Ville serait partenaire à parité avec l’État quand il avait constaté que la Région ne pourrait l’assumer à la même hauteur, qu’il venait de voir Jean-Paul Huchon à ce sujet, et que ce dernier allait se déterminer prochainement.
La première saison du nouveau Pleyel sera riche, très riche. Trois orchestres en résidence : l’Orchestre de Paris (résidence permanente), l’Orchestre philharmonique de Radio-France, et le London Symphony Orchestra qui y assurera tous ses concerts à Paris ; des orchestres prestigieux invités (tels l’Orchestre Philharmonique de Berlin), des solistes célèbres mais aussi la génération montante ; une dimension historique de la musique symphonie, ses antécédents baroque et classique, mais aussi d’autres genres (vocal, lyrique, chambriste) et les musiques actuelles (jazz, musiques du monde, variétés) ; une articulation avec les autres principaux orchestres parisiens et avec les régions… La Cité de la musique s’impose comme acteur majeur sur l’échiquier musical parisien.
Un sujet passé sous silence, toutefois : quelle sera l’articulation entre le Pleyel d’aujourd’hui et la grande salle de la Cité de demain ? Et dans une période qui a vu des faillites d’orchestres pourra-t-on assurer le remplissage de ces trois nouveaux lieux ? On ne peut que souhaiter une telle réussite. Peut-être entraînera-t-elle dans sa foulée un renouveau de l’écriture symphonique, comme on voit la réémergence de l’opéra.
Un sujet qui fâche, malgré tout : à peine quelques semaines plus tôt, le ministère de la culture a supprimé sa subvention pour 2005 à la branche française de l’AIBM (l’association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux) et ne compte pas la reporter pour 2006. Cette association fédère la profession en France, encourage la coopération inter-bibliothécaire et représente ses membres au niveau international ; elle organise des journées de travail, et publie des ouvrages de référence, autant sur papier qu’en ligne. Les bibliothèques musicales sont une charnière essentielle dans la vie musicale, autant pour les amateurs que les professionnels. Si le ministère affiche une volonté forte de l’encourager, il serait important que cela ne se fasse pas uniquement dans une optique de centralisation et de concentration.


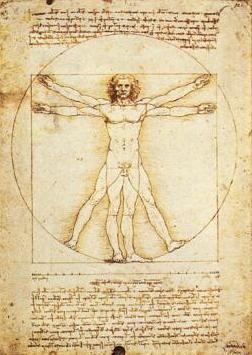 Ce sont trois de ces suites – la deuxième en ré mineur, la troisième en ut majeur et la sixième en ré majeur – qui ont été le prétexte musical au ballet In den Winden im Nichts de
Ce sont trois de ces suites – la deuxième en ré mineur, la troisième en ut majeur et la sixième en ré majeur – qui ont été le prétexte musical au ballet In den Winden im Nichts de 
