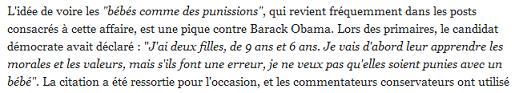« To see a world in a grain of sand. »
— William Blake.
« Je m’estime moins qu’un de ces grains de sable,
Car ce sable roulé par les flots inconstants,
S’il a moins d’étendue, hélas ! a plus de temps. »
— Lamartine, L’Infini dans les Cieux.
Le cinéma La Pagode présentait avant-hier en avant-première L’Homme de Londres du grand réalisateur hongrois de l’intemporel Béla Tarr (dont on a admiré Damnation et surtout Les Harmonies Werckmeister). Le Centre Wallonie-Bruxelles inaugurait hier l’exposition Lumières sur Brüsel, consacrée aux talentueux auteurs de bandes dessinées François Schuiten et Benoît Peeters, architectes de la démesure (dont nous avions récemment évoqué certains aspects de leur œuvre).
La caméra de Béla Tarr est-elle l’œil d’un vieil homme fatigué qui parcourt lentement, très lentement, comme épuisé par l’effort nécessaire à tout saisir et à donner sens à ce qui s’offre à son regard et qui ne peut se détacher de la scène même après que les protagonistes l’aient quittée ? Ou est-ce un regard particulièrement attentif à l’imperceptible, au mouvement le plus infime, à ce qui reste longtemps suspendu dans l’air après qu’un événement ait troublé l’espace ? Le film – en noir et blanc – s’ouvre sur une image floue et scintillante ; on entend comme une corne de brume. Après un moment, comme le temps de l’adaptation de l’œil dans la pénombre, on s’aperçoit qu’il s’agit de l’eau dans un port et de la corde d’amarrage d’un bateau dont la caméra gravira si lentement le long de l’étrave fine comme la lame d’un couteau qui coupe l’écran en deux. Plus haut, un hublot de chaque côté de la proue lui donnera l’air d’un animal étrange – est-ce la baleine des Harmonies Werckmeister (auquel ce film fera une brève allusion, avec la danse des hommes dans le bar du port) ? – puis continuera à glisser vers le pont. On comprendra alors que c’est le regard de Maloin l’aiguilleur de nuit (encore un parallèle, involontaire ou non, avec Janos, le postier des Harmonies, chargé d’aiguiller le courrier vers ses destinataires ?), posté dans sa tour au-dessus de la voie ferrée qui aboutit sur le quai plongé dans la brume et auprès duquel est amarré ce navire qui ne part ni n’arrive et dont on verra sortir, de temps à autre, des voyageurs seuls, une valise à la main, qui s’engouffreront dans le train qui les attend à quelques pas. Quant à la triste et profonde sonnerie qui accompagne cette spectaculaire ouverture, ce sont les premières notes de la très belle et très discrète musique (celle de Miháli Vig, qui a aussi composé celle des Harmonies Werckmeister) qui accompagne le film comme un long soupir, tout en sachant souvent être silencieuse.
L’histoire est somme toute banale : Maloin aperçoit un voyageur jeter subrepticement une valise à un homme à quai, le rejoindre plus tard pour se battre avec lui. L’un tombe à l’eau avec la valise, l’autre disparaît. Maloin retrouve la valise pleine d’argent ce qui bouleverse son quotidien et sa vie très modeste. Il utilise quelques billets pour acheter un boa de fourrure à sa fille, se fâche sans raison avec sa femme. Plus tard, il retrouvera l’autre homme – Brown, l’homme de Londres, qui avait dérobé cette somme à son patron puis éliminé son complice – le tuera, et rendra la valise à l’inspecteur chargé de la retrouver. Celui-ci remerciera Maloin et fourrera quelques billets dans le sac de la veuve de Brown, dont le visage impassible dans sa désolation restera longtemps à l’écran avant qu’il ne s’éteigne.
Ce roman de Simenon, adapté par Béla Tarr et László Krasznahorkai (auteur de l’extraordinaire Mélancolie de la résistance dont sont tirées Les Harmonies Werckmeister et dont les longs plans font magnifiquement écho aux longues phrases du roman), est celui de l’incommunicabilité et du bouleversement de l’ordre établi qui jette le protagoniste et son entourage dans une crise insoluble, seule mesure du temps qui n’en finit pas de passer, sans qu’il puisse en comprendre les causes ni en saisir les effets ; c’est aussi le cas du Chat de Simenon – compatriote de Schuiten et de Peeters –, face à face saisissant d’un couple, Gabin et Signoret à l’écran, dans une maison du bout du monde, dernière survivante d’un chantier de démolition de tout un quartier, bâtisse délabrée à l’image du couple qui s’y accroche. Quelque chose doit inexorablement se passer, la résolution ne peut passer que par la violence ou par la mort, il n’y a pas d’autre issue. L’humour hongrois, grinçant et désespéré, est parfois proche de l’absurde et du surréalisme belge… Mais là où ce film se distingue des Harmonies, c’est qu’il n’en atteint pas la dimension universelle, voire cosmique, et qu’on ne perçoit pas la très longue et graduelle tension qui monte très graduellement, comme le crescendo qu’un grand chef sait construire au long d’une œuvre, pour exploser dans cette ruée de la foule vers l’asile de vieillards dans Les Harmonies puis sa résolution devant le corps décharné de l’homme qui leur fait face.
Il n’empêche : Tarr a une « écriture » reconnaissable entre toutes. La lumière et l’obscurité, la scène, les décors, les personnages, l’atmosphère évoquent les grands photographes hongrois des années 1930-1950, et surtout ceux que Paris a accueillis, à l’instar de Kertesz et de Brassaï (mais aussi de Robert et de Cornell Capa, par exemple). Maloin debout devant la cabane dans laquelle se trouve le corps de Brown qu’il a tué et où viennent d’entrer l’inspecteur et la veuve aussitôt avalés par l’obscurité qui y règne : l’écran est partagé en deux parties presque égales par la bâtisse à droite et la silhouette de l’homme debout devant la porte à gauche, se détachant sur l’horizon blanc : la caméra attend, immobile, comme Maloin attend. On entendra finalement la plainte lugubre de la femme. Rien de plus, mais comment ne pas être en être glacé ? Il en va ainsi du reste du film : saisissant comme une mise en scène de Bob Wilson (dans ses bonnes années), autre metteur en scène de l’immobile ou de l’imperceptible : les plans, immobiles ou non, sont construits avec une maîtrise admirable et une attention à l’ensemble comme aux détails rarement prise en défaut (on aura pourtant remarqué que tous les billets dans la valise portaient le même numéro de série…).
 Le talent de Schuiten et de Peeters réside, comme on l’a déjà remarqué, dans leur construction d’espace imaginaires spectaculaires et dans la scénarisation d’événements réels. L’exposition qui leur est consacrée et dont ils sont les commissaires est d’ailleurs fort bien mise en scène (par l’agence Bleu Lumière) : le sable et les pierres venus d’ailleurs et qui menacent d’envahir Brüsel dans le premier tome de La Théorie du grain de sable se déversent du Centre Wallonie-Bruxelles sur le trottoir et recouvrent le sol de la salle d’exposition, plongée dans la pénombre, et où se détachent les très belles planches choisies pour l’exposition dans le second et dernier volume de cette bande dessinée qui vient de sortir et qui était vendu exceptionnellement à l’accueil. Comme chez Tarr, c’est le noir-et-blanc qui y règne avec toutes ses nuances : le blanc n’est jamais tout à fait blanc, sauf lorsqu’il s’agit de ce sable ou des pierres, ce qui les rend éblouissants, surnaturels. Mais on aura remarqué aussi quelques autres planches, et notamment une affiche en couleurs réalisée pour le port de Bruxelles où se détachent deux proues de navire qui ont fait écho à celle de l’ouverture de L’Homme de Londres. L’exposition mérite le détour, autant pour l’aménagement du lieu que les dessins et quelques objets qu’on peut y admirer, et pour le court métrage consacré aux deux créateurs.
Le talent de Schuiten et de Peeters réside, comme on l’a déjà remarqué, dans leur construction d’espace imaginaires spectaculaires et dans la scénarisation d’événements réels. L’exposition qui leur est consacrée et dont ils sont les commissaires est d’ailleurs fort bien mise en scène (par l’agence Bleu Lumière) : le sable et les pierres venus d’ailleurs et qui menacent d’envahir Brüsel dans le premier tome de La Théorie du grain de sable se déversent du Centre Wallonie-Bruxelles sur le trottoir et recouvrent le sol de la salle d’exposition, plongée dans la pénombre, et où se détachent les très belles planches choisies pour l’exposition dans le second et dernier volume de cette bande dessinée qui vient de sortir et qui était vendu exceptionnellement à l’accueil. Comme chez Tarr, c’est le noir-et-blanc qui y règne avec toutes ses nuances : le blanc n’est jamais tout à fait blanc, sauf lorsqu’il s’agit de ce sable ou des pierres, ce qui les rend éblouissants, surnaturels. Mais on aura remarqué aussi quelques autres planches, et notamment une affiche en couleurs réalisée pour le port de Bruxelles où se détachent deux proues de navire qui ont fait écho à celle de l’ouverture de L’Homme de Londres. L’exposition mérite le détour, autant pour l’aménagement du lieu que les dessins et quelques objets qu’on peut y admirer, et pour le court métrage consacré aux deux créateurs.
 À lire les Cités invisibles, longue série de bandes dessinées commencées il y a plus d’une vingtaine d’années et dans laquelle ces deux tomes s’inscrivent, on reste curieusement insatisfait par le scénario des épisodes qu’ils y racontent (ce qui est le cas de ce film-ci de Tarr où, contrairement aux Harmonies, Krasznahorkai n’est que l’adaptateur, pas l’auteur), qui ne sont pas à la mesure du décor spectaculaire qu’ils plantent. Ainsi, ce dernier ouvrage raconte l’effet de la subtilisation d’un objet et sa restitution (ce qui n’est pas loin de rappeler le sujet du film de Tarr), mais l’intrigue est curieusement inintéressante en soi. La fin – dans laquelle les deux mondes parallèles se rencontrent brièvement, et où le « réel » perce un instant l’imaginaire, est incongrue et décevante. Quant aux personnages, pour certains récurrents dans la série, pris dans l’incompréhensible et le démesuré, ils sont fort bien campés mais rarement réellement attachants : ce qui attire l’émotion, ce sont les façades des immeubles, les rues, les perspectives. Et finalement, il en reste ces images saisissantes vers lesquels on revient avec émerveillement.
À lire les Cités invisibles, longue série de bandes dessinées commencées il y a plus d’une vingtaine d’années et dans laquelle ces deux tomes s’inscrivent, on reste curieusement insatisfait par le scénario des épisodes qu’ils y racontent (ce qui est le cas de ce film-ci de Tarr où, contrairement aux Harmonies, Krasznahorkai n’est que l’adaptateur, pas l’auteur), qui ne sont pas à la mesure du décor spectaculaire qu’ils plantent. Ainsi, ce dernier ouvrage raconte l’effet de la subtilisation d’un objet et sa restitution (ce qui n’est pas loin de rappeler le sujet du film de Tarr), mais l’intrigue est curieusement inintéressante en soi. La fin – dans laquelle les deux mondes parallèles se rencontrent brièvement, et où le « réel » perce un instant l’imaginaire, est incongrue et décevante. Quant aux personnages, pour certains récurrents dans la série, pris dans l’incompréhensible et le démesuré, ils sont fort bien campés mais rarement réellement attachants : ce qui attire l’émotion, ce sont les façades des immeubles, les rues, les perspectives. Et finalement, il en reste ces images saisissantes vers lesquels on revient avec émerveillement.

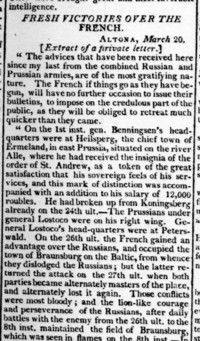 On aurait aimé lire les échos de la Révolution française dans la presse américaine de l’époque, mais rien n’est encore entré à ce sujet dans (la partie gratuite de) l’archive. En avançant dans le temps, on trouve
On aurait aimé lire les échos de la Révolution française dans la presse américaine de l’époque, mais rien n’est encore entré à ce sujet dans (la partie gratuite de) l’archive. En avançant dans le temps, on trouve 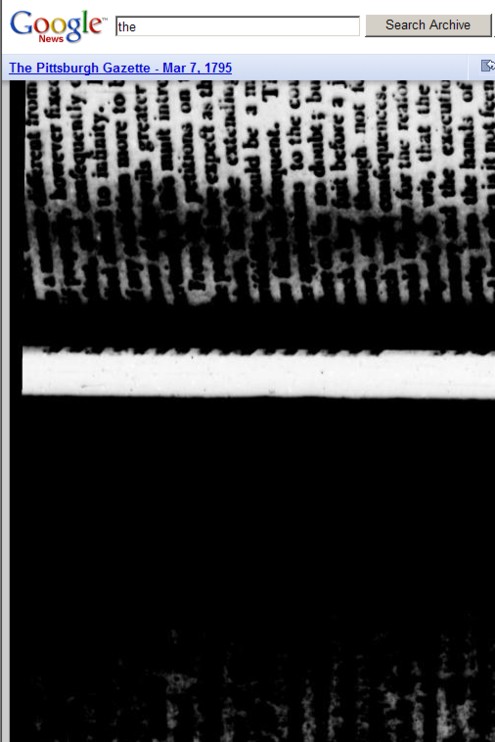 Contrairement au
Contrairement au  Un autre défaut, qu’on a aussi identifié dans leur rubrique de livres numérisés (mais dû probablement à d’autres raisons) est l’indexation incorrecte des dates des documents. Le Victoria Daily Standard daté de 1873 se retrouve classé en 1783, et des milliers de journaux,
Un autre défaut, qu’on a aussi identifié dans leur rubrique de livres numérisés (mais dû probablement à d’autres raisons) est l’indexation incorrecte des dates des documents. Le Victoria Daily Standard daté de 1873 se retrouve classé en 1783, et des milliers de journaux,  Quant au
Quant au 
 Le talent de Schuiten et de Peeters réside,
Le talent de Schuiten et de Peeters réside,  À lire les Cités invisibles, longue série de bandes dessinées commencées il y a plus d’une vingtaine d’années et dans laquelle ces deux tomes s’inscrivent, on reste curieusement insatisfait par le scénario des épisodes qu’ils y racontent (ce qui est le cas de ce film-ci de Tarr où, contrairement aux Harmonies, Krasznahorkai n’est que l’adaptateur, pas l’auteur), qui ne sont pas à la mesure du décor spectaculaire qu’ils plantent. Ainsi, ce dernier ouvrage raconte l’effet de la subtilisation d’un objet et sa restitution (ce qui n’est pas loin de rappeler le sujet du film de Tarr), mais l’intrigue est curieusement inintéressante en soi. La fin – dans laquelle les deux mondes parallèles se rencontrent brièvement, et où le « réel » perce un instant l’imaginaire, est incongrue et décevante. Quant aux personnages, pour certains récurrents dans la série, pris dans l’incompréhensible et le démesuré, ils sont fort bien campés mais rarement réellement attachants : ce qui attire l’émotion, ce sont les façades des immeubles, les rues, les perspectives. Et finalement, il en reste ces images saisissantes vers lesquels on revient avec émerveillement.
À lire les Cités invisibles, longue série de bandes dessinées commencées il y a plus d’une vingtaine d’années et dans laquelle ces deux tomes s’inscrivent, on reste curieusement insatisfait par le scénario des épisodes qu’ils y racontent (ce qui est le cas de ce film-ci de Tarr où, contrairement aux Harmonies, Krasznahorkai n’est que l’adaptateur, pas l’auteur), qui ne sont pas à la mesure du décor spectaculaire qu’ils plantent. Ainsi, ce dernier ouvrage raconte l’effet de la subtilisation d’un objet et sa restitution (ce qui n’est pas loin de rappeler le sujet du film de Tarr), mais l’intrigue est curieusement inintéressante en soi. La fin – dans laquelle les deux mondes parallèles se rencontrent brièvement, et où le « réel » perce un instant l’imaginaire, est incongrue et décevante. Quant aux personnages, pour certains récurrents dans la série, pris dans l’incompréhensible et le démesuré, ils sont fort bien campés mais rarement réellement attachants : ce qui attire l’émotion, ce sont les façades des immeubles, les rues, les perspectives. Et finalement, il en reste ces images saisissantes vers lesquels on revient avec émerveillement.