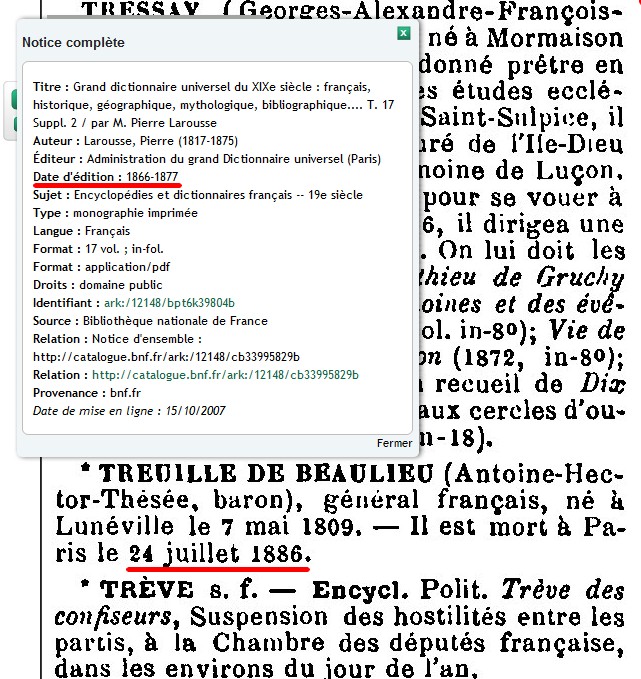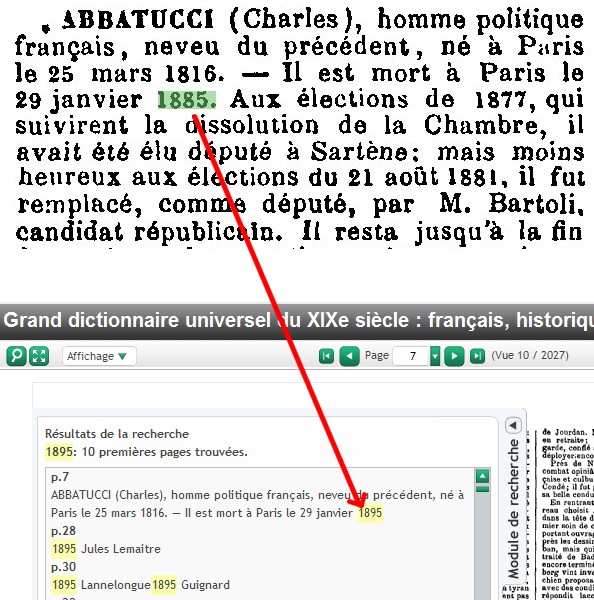L’intervention fort intéressante que l’on pourra lire ici a été prononcée il y a deux jours à l’Hôtel de Ville de Paris par Yitskhok Niborski à l’occasion de la présentation du Projet Pourim Shpil, qui vise à faire inscrire cette tradition carnavalesque juive multiséculaire – elle était déjà mentionnée au XIVe siècle – au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Son nom est composé de deux mots : l’un en hébreu, « Pourim », qui dénote la fête (au printemps) qui a donné lieu à ce type de manifestation ; l’autre en yiddish, « spil », qui signifie « jeu, jeu de scène ». Il vise à représenter, souvent de façon humoristique et avec des clins d’œil plus ou moins ironiques à l’actualité de la communauté qui le monte, l’événement fondateur de la fête, et qui est décrit dans le Livre d’Esther de l’Ancien testament : on y trouve tous les ingrédients d’une pièce à rebondissements – désir, amour, jalousie, trahison… mais aussi l’entrelacement souvent périlleux entre les sphères politique et personnelle chez les grands de ce monde. Tout est bien qui finit bien, d’où cette fête (presque) débridée qui exprime un réel soulagement.
Il pourrait sembler curieux qu’on ait utilisé le terme de « carnavalesque » pour qualifier cette tradition, puisqu’il dénote la période précédant le Carême chrétien. Mais non seulement il en partage le sens de « bouffonnerie plus ou moins grotesque », mais la période à laquelle il a lieu est curieusement comparable dans les calendriers juif et chrétien : la fête de Pourim précède d’un mois jour pour jour la Pâque juive, tandis que le Mardi gras a lieu un mois et demi avant Pâques – en 2014, les 16 et 4 mars respectivement, et donc précédant de peu le l’équinoxe de mars…
Enfin, on précisera à ceux qui ne le connaissent pas encore que l’orateur est non seulement l’« un des meilleurs connaisseurs au monde de la langue et de la littérature yiddish », mais un des meilleurs enseignants de langues qu’il m’ait été donné d’avoir au cours de ma vie (et ce n’est certainement pas de sa faute si j’ai été sans doute un de ses cancres les plus notoires). Un maître.

«La proposition d’inscrire le Purim-shpil aux listes pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco ne prendra tout son sens que si nous considérons cette vieille pratique théâtrale des Juifs ashkénazes sous l’aspect de ses véritables liens avec la langue yiddish et sa littérature. Je ne parle pas du fait, évident, que tout projet pour remettre en valeur les purim-shpiln devrait impliquer un effort sérieux pour approfondir et diffuser la connaissance et la pratique du yiddish. Cela va de soi. Je parle maintenant de certaines caractéristiques du purim-shpil qui peuvent illustrer ce que le yiddish lui-même représente.
Parce que c’est le yiddish qui est le véritable chef d’œuvre de la civilisation ashkénaze. Pas forcément à cause de la grande diversité de ses origines : allemand du moyen-âge, hébreu et araméen, langues romanes, langues slaves. C’est très intéressant, mais tout de même un phénomène linguistique courant. Pas non plus à cause de la manière, pourtant remarquable, dont tous ces ingrédients se sont recomposés jusqu’à former une langue distincte et cohérente. Cela passionne à juste titre les spécialistes, mais au demeurant toutes les langues résultent de fusions entre autres langues, toutes empruntent et assimilent des éléments étrangers. Non ; si le yiddish nous intéresse, c’est pour avoir été en même temps le produit, le vecteur, le facteur d’équilibre et finalement aussi la force transformatrice de la civilisation qui l’a parlé.
Je dis : le yiddish, produit de la tradition juive, parce que c’est le mode de vie traditionnel juif qui a forgé la langue. L’activité intellectuelle par excellence était l’étude des textes bibliques et talmudiques en hébreu et en araméen, qu’on expliquait et commentait oralement en yiddish. Au fil des générations, cette activité a élargi le vocabulaire de la langue parlée, diversifié ses formes, changé sa musique. En même temps, des milliers d’expressions naissaient pour nommer l’infinité de pratiques rituelles et coutumières rythmant la vie de tous les jours, ainsi que les nombreuses règles et institutions du système rabbinique. Une vie si complexe et si spécifique ne pouvait se vivre qu’avec une langue également singulière.
Je dis : le yiddish, vecteur de la tradition juive, parce que s’il est vrai qu’une élite d’hommes instruits étudiait directement les textes sacrés, des couches plus vastes parmi les hommes et la grande majorité des femmes recevaient leur formation religieuse et morale à travers le yiddish. Non seulement à travers les sermons de rabbins et prêcheurs, mais aussi par le yiddish écrit, auquel la plupart des hommes et des femmes avaient accès. Pour eux on éditait en yiddish des livres édifiants et des vulgarisations des lois rabbiniques.
Je dis : le yiddish, facteur d’équilibre dans la tradition juive, parce que par sa seule existence comme fusion de mille emprunts, la langue constituait une surface de contact avec la vie des autres. Dès ses débuts, il y a six cent ans, la littérature yiddish a servi aussi pour apporter aux masses juives un peu de la culture séculière de leurs voisins. Femmes et hommes juifs appréciaient les mêmes genres littéraires que les gens d’autres peuples et en étaient d’autant plus friands que, pour la plupart, eux ils savaient lire. C’est ainsi que des contes et des nouvelles, des récits de chevalerie, des chroniques de voyages fantastiques et bien d’autres textes en yiddish apportaient aux gens du commun un divertissement donnant un aperçu de ce qui existait en dehors du groupe juif. Les rabbins se méfiaient de ce type de littérature si populaire, mais ont dû composer avec elle. On peut trouver étonnant que la langue façonnée par les études et pratiques traditionnelles, pétrie de leur esprit, ait pu en même temps servir de véhicule à des contenus, voire à des valeurs, venus de l’extérieur. Mais derrière ce paradoxe apparent se cache le plus savant des équilibres. Comme un épiderme qui protège l’organisme tout en lui assurant une respiration, le yiddish et sa littérature jusqu’au 19e siècle ont préservé la spécificité de la vie juive tout en compensant les tendances à l’enfermement et au verrouillage.
Je dis : le yiddish, force transformatrice de la tradition juive, parce qu’à partir du 19e siècle il s’arrache à son rôle figé de langue subalterne, tantôt appoint de la discipline religieuse, tantôt passeur en fraude d’un peu de culture extérieure. C’est l’époque où, sous l’influence des Lumières, des intellectuels formés dans le moule traditionnel en sortent pour entreprendre la réforme de la société juive. Ils veulent convaincre les couches populaires juives des empires russe et austro-hongrois de l’intérêt d’ouvrir l’éducation aux langues européennes, aux sciences, aux lettres et aux arts. Ils veulent moderniser les structures de la famille et de la communauté. En se servant du yiddish pour diffuser leurs idées, ils fondent une littérature moderne. Celle-ci, en véhiculant des idées progressistes et plus tard des pensées politiques tant sociales que nationales, a modifié de fond en comble la sensibilité et la réalité de tous les Juifs, bien au delà de la branche ashkénaze.
Le purim-shpil incarne bien ces caractéristiques principales du yiddish. Produit de la tradition, il a servi à la perpétuer tout en compensant sa rigueur excessive et ses hiérarchies rigides par cette libre respiration qu’est l’irrévérence. Il a fait entrer dans l’espace juif pas mal d’éléments du théâtre populaire européen. Berceau du théâtre moderne, il se place par là à l’origine d’un facteur majeur d’ouverture et de transformation culturelle. Même après le génocide, il inspire encore certaines œuvres comme celles de Khayim Sloves, où convergent la farce de Purim et l’esprit du théâtre de Bertolt Brecht.
Notre démarche auprès de l’Unesco aura un sens si, indépendamment de son issue, nous affirmons pour nous mêmes, autour du symbole du Purim-shpil, »les valeurs de contestation féconde, d’ouverture et de partage qui sont celles de la culture yiddish moderne. Sans ça, nous risquons de jouer un bien mauvais purim-shpil.
Yitskhok Niborksi