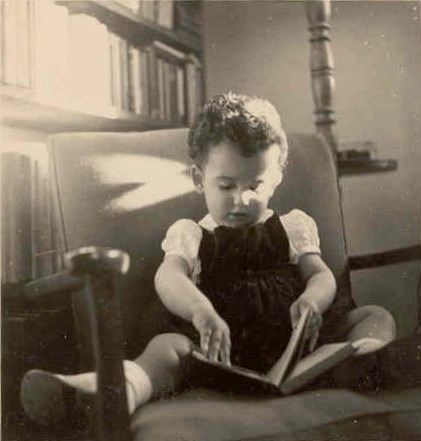Le diamand noir
 Diamanda Galás, une voix1 déchirante et désespérée, hurlant dans un paroxysme de douleur et de tristesse la tragédie des plaies de ce monde — exils, sida, haines, génocides, mort. Une voix parcourant quatre octaves, incroyablement agile et puissante, plongeant au plus profond des tripes pour s’élever au plus aigu, tantôt douce et souvent si forte qu’elle envahit l’esprit et tout le reste s’efface, mélodieuse quand elle chante la nostalgie des disparus, stridente lorsqu’elle exhale en de longs lamentos sa révolte devant l’inéluctable humain ou divin, l’abject et la transfiguration, les tribulations humaines ou le Jugement dernier. Intense, bouleversante, elle saisit, glace, fige. On est possédé par son exaltation. S’accompagnant souvent au piano, elle joue de cet instrument comme de sa voix, avec une intensité phénoménale, le transformant en un orchestre de dimension brucknérienne (et qui n’est pas sans rappeler le grand pianiste Ervin Nyiregyhazi, étoile noire du clavier dans la tradition de Liszt).
Diamanda Galás, une voix1 déchirante et désespérée, hurlant dans un paroxysme de douleur et de tristesse la tragédie des plaies de ce monde — exils, sida, haines, génocides, mort. Une voix parcourant quatre octaves, incroyablement agile et puissante, plongeant au plus profond des tripes pour s’élever au plus aigu, tantôt douce et souvent si forte qu’elle envahit l’esprit et tout le reste s’efface, mélodieuse quand elle chante la nostalgie des disparus, stridente lorsqu’elle exhale en de longs lamentos sa révolte devant l’inéluctable humain ou divin, l’abject et la transfiguration, les tribulations humaines ou le Jugement dernier. Intense, bouleversante, elle saisit, glace, fige. On est possédé par son exaltation. S’accompagnant souvent au piano, elle joue de cet instrument comme de sa voix, avec une intensité phénoménale, le transformant en un orchestre de dimension brucknérienne (et qui n’est pas sans rappeler le grand pianiste Ervin Nyiregyhazi, étoile noire du clavier dans la tradition de Liszt).
D’origine grecque orthodoxe, Galás a grandi aux Etats-Unis. Elle a explosé sur la scène lors du Festival d’Avignon de 1979, où elle a interprété le rôle titre de l’opéra Un Jour comme un autre du compositeur Vinko Globokar, basé sur le rapport d’Amnesty International concernant l’arrestation et la torture d’une femme en Turquie. Ses premiers disques, “The Masque of the Red Death” (Le Masque de la Mort rouge, titre d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe), “Plague Mass” (Messe de la Peste), “Vena Cava”, ou “Malediction and Prayer” (Malédiction et prière) concernent les malades du sida (son frère en est mort) ou de la dépression clinique ; Schrei 27 (Cri 27) — la torture dans l’isolement. “Defixiones, Will and Testament”, que je n’ai pas encore écouté (sauf les extraits disponibles dans le lien ci-contre), est consacré aux génocides et aux exils, et comprend des œuvres extraordinaires : sur des textes du poète Adonis, de Michaux ou de Pasolini, sur Todesfuge (La fugue de mort) de Paul Celan, dont j’avais parlé précédemment ; des extraits de la liturgie arménienne (que j’ai entendu, saisi, dans l’Église arménienne de Jérusalem), ou des compositions de Galás.
S’il y a bien un Requiem pour le temps présent, c’est Galás qui lui a donné corps et voix.
1 On peut en écouter une interprétation dans cet article, et de brefs extraits de la plupart de ses disques dans cette page-ci et celle-là.