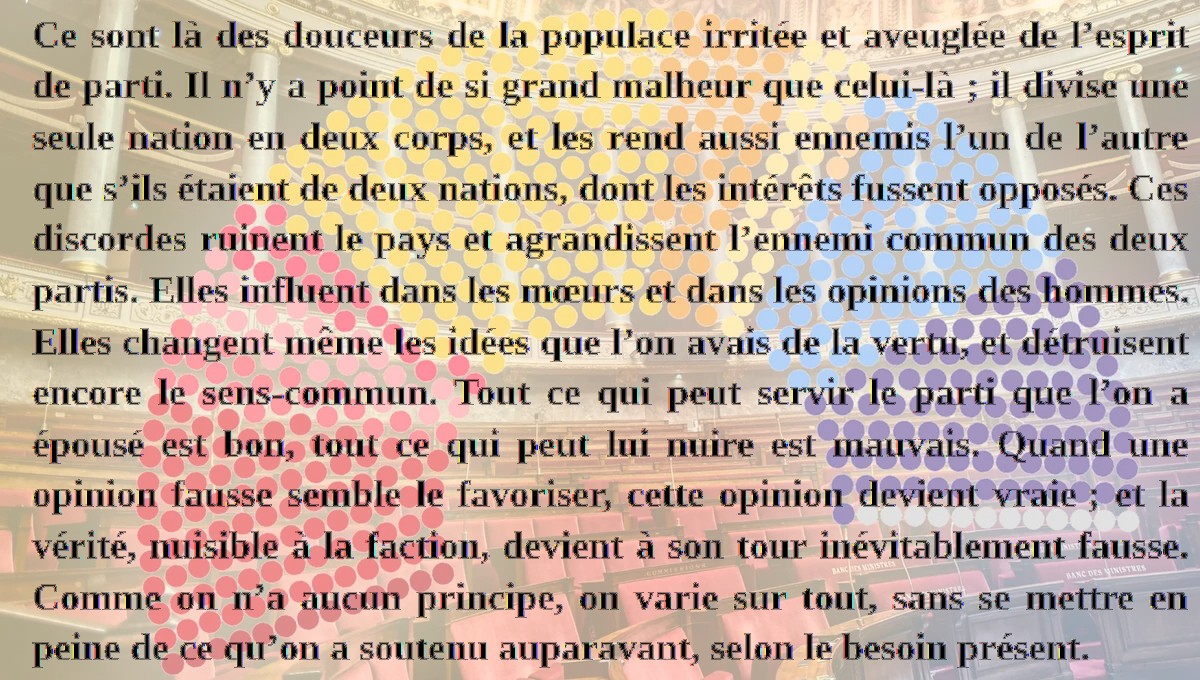De l’esprit de parti et de son effet destructeur sur la société
Le texte qui suit, extrait de Bibliothèque ancienne et moderne de Jean Le Clerc (1716), est une belle critique toujours d’actualité d’un ouvrage traduit de l’anglais, Le Spectateur, ou, Le Socrate Moderne, où l’on voit un portrait naïf des mœurs de ce siècle, t. II, 1716. L’édition originale, The Spectator, était un recueil d’articles rédigés principalement par Richard Steele et Joseph Addison, créé et lancé en 1711 (à ne pas confondre avec l’hebdomadaire britannique éponyme, créé en 1828). Jean Le Clerc (1657-1736) était un théologien et pasteur protestant genevois qui fut également historien, critique et journaliste.

«J’ai déja parlé au long du Spectateur, dans cette Bibliothèque, Tome I, p. 383. On peut connaître par-là le dessein de cet ouvrage, composé de discours sur toutes sortes de sujets qui ont quelque rapport aux mœurs, et surtout aux mœurs des Anglais, que les auteurs se sont proposés de purifier de bien des défauts en en faisant voir le ridicule. On en a donné des échantillons qui ont beaucoup plu à ceux qui ne peuvent pas recourir à l’original.
Voici le second tome de la version française de cet ouvrage, dont le premier s’est très bien débité. Il y a ici 70 Discours, qui sont la plupart d’un usage plus général que divers de ceux du volume I qui ne regardent que des manières anglaises et qui ne sont pas fort connues hors de l’Angleterre. Il y a néanmoins divers endroits qu’on peut lire avec plaisir et avec fruit, quoiqu’ils regardent plus particulièrement ce pays-là qu’un autre, et que l’on peut même appliquer à d’autres désordres, sujets aux mêmes suites, comme les Discours XXX et XXXVI, où il est parlé de l’esprit de faction.
Depuis le temps de Cromwell, il y avait toujours eu en Angleterre deux partis, dont l’un était celui de la Cour, et l’autre celui de ceux à qui la conduite de la Cour ne plaisait pas. Ces deux partis éclataient, en toutes occasions, l’un contre l’autre, et ils avaient tour à tour le dessus dans les Parlements. Ils s’aigrirent encore davantage sous le règne du roi Guillaume et de la reine Marie, mais ils vinrent à l’excès d’emportement les dernières années de la reine Anne, auxquelles le Ministère travailla, par toutes sortes d’artifices, à ruiner entièrement ceux qui étaient zélés pour la religion protestante et pour la liberté de leur patrie, que l’on nomme communément Whigs, comme l’on appelle Tories ceux qui leur sont opposés, qui ne se mettent guère en peine, à ce qu’on dit, de la sûreté de la religion protestante ni de la liberté de leur pays. On les voit encore aujourd’hui violemment échauffés les uns contre les autres, et il n’y a que le temps qui les puisse guérir, sous l’autorité d’un Prince calme et ennemi de toutes sortes d’excès, tel qu’est aujourd’hui le roi George ; qui pourrait sans peine, je l’ose dire sans crainte d’être démenti, faire du bien aux deux partis, sans distinction, pourvu que l’une de ces factions cessât de le traverser et de s’opposer au droit indubitable qu’il a à la Couronne. Mais pendant qu’elle demeure son ennemie, il est obligé, par toutes les règles de la prudence, de s’en garder et de la mettre hors d’état de lui nuire et de perdre en même temps sa patrie. Le naturel de la nation, qui n’est ordinairement pas assez tranquille, irrité d’ailleurs par mille artifices des mal-intentionnés, fait craindre aux honnêtes gens que l’on ne lui puisse pas rendre le calme, aussi tôt qu’il serait à souhaiter, en tenant la balance égale entre les deux partis. Mais on ne doit pas désespérer de voir cet heureux temps sous un gouvernement comme celui d’à présent, qui n’a point d’intérêt à entretenir les animosités mais au contraire à les apaiser, et qui a toute la sagesse et la patience qu’il faut pour les diminuer de jour en jour. La manière d’élever la jeunesse pourrait beaucoup contribuer à cela, si ceux qui auraient ce soin étaient des gens habiles, amis de la paix, et d’ailleurs soutenus de quelque réputation. On verrait sortir de leur école en peu d’années des sujets plus modérés en toute manière que ceux qui sortent des lieux établis pour cela, mais qui sont tout le contraire de ce à quoi ils ont été originairement destinés.
Pour revenir à notre auteur, il raconte dans le XXVe Discours, pour montrer la chaleur des partis, que du temps des querelles des parlementaires et des royalistes, un chevalier de ses amis étant fort jeune et devant aller dans la rue Ste Anne, demanda à un homme qu’il rencontra le chemin de la rue Ste Anne, et que cet homme, au lieu de lui répondre à ce qu’il demandait, lui répondit : Petit chien de papiste, qui a fait cette Anne sainte ? C’était un presbytérien. Pour éviter une semblable réponse, il demanda à un autre, qui se trouva un Épiscopal, où était la rue d’Anne. Il en fut traité de pourceau galeux, et on lui dit qu’elle était sainte avant qu’il fût né, et continuerait à l’être après qu’il ferait pendu. Ce sont là des douceurs de la populace irritée et aveuglée de l’esprit de parti. Il n’y a point de si grand malheur que celui-là ; il divise une seule nation en deux corps, et les rend aussi ennemis l’un de l’autre que s’ils étaient de deux nations, dont les intérêts fussent opposés. Ces discordes ruinent le pays et agrandissent l’ennemi commun des deux partis. Elles influent dans les mœurs et dans les opinions des hommes. Elles changent même les idées que l’on avais de la vertu, et détruisent encore le sens-commun. Tout ce qui peut servir le parti que l’on a épousé est bon, tout ce qui peut lui nuire est mauvais. Quand une opinion fausse semble le favoriser, cette opinion devient vraie ; et la vérité, nuisible à la faction, devient à son tour inévitablement fausse. Comme on n’a aucun principe, on varie sur tout, sans se mettre en peine de ce qu’on a soutenu auparavant, selon le besoin présent.
Pour déraciner des esprits cette étrange passion, l’auteur propose, dans le Discours XXVI de faire une ligue entre les honnêtes gens de tous les partis, où l’on s’oblige de signer que l’on croit que deux et deux sont quatre, que le blanc n’est pas noir et que le noir n’est pas blanc, de le dire toujours, et de regarder comme ennemis ceux qui diront le contraire ; c’est à dire, de ne plus juger, ni parler seulement par passion, et par intérêt. Il y fait voir fort agréablement les effets également ridicules et dangereux de l’esprit de parti. Ces endroits méritent d’être lus et relus de ceux qui s’en laissent entêter. Nous n’avons pas de place ici pour les rapporter tous entiers.
[...]
On peut encore appliquer ce qu’il dit de l’esprit des factions et de la chaleur avec laquelle on les défend, aux querelles de religion, et de théologie qui arment les sociétés chrétiennes l’une contre l’autre, et qui divisent les membres d’une même société avec une violence incroyable. Ainsi quoi qu’il y ait ici beaucoup de choses qui regardent directement les Anglais, les autres nations ne laissent pas d’en pouvoir profiter.
Au reste, on peut dire que les deux tomes du Spectateur sont traduits avec autant de fidélité et d’exactitude, que la différence des langues l’a pu souffrir. La langue anglaise est si abondante en termes et si hardie, qu’il est fort difficile qu’on l’égale en français, et les versions ne paraissent jamais si vives» que les originaux, à moins qu’on ne prenne trop de liberté ; ce qu’on ne doit jamais faire, et surtout en des livres de cette nature.
Jean Le Clerc : Bibliothèque ancienne et moderne (1716)