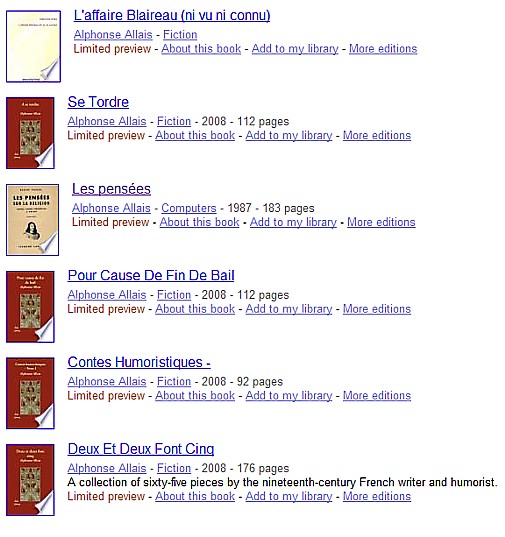La bibliothèque du futur numérique

De gauche à droite : Jean-Yves Mollier, Antoine Gallimard, Jack Ralite,
Jean-Noël Jeanneney, Philippe Colombet.
En 2440, la bibliothèque telle que nous la connaissons aura vécu. Fallait-il attendre Google Books pour le constater ? Que nenni : c’est en 1771 que Sébastien Mercier (1740-1814) publie son utopie L’An deux mille quatre cent quarante, rêve s’il en fut jamais (et une nouvelle édition en 1785), dans laquelle il visite – entre autres – la bibliothèque du Roi et est stupéfait de la voir réduite à une armoire avec quelques livres. L’explication qu’il en reçoit est la suivante : « Convaincus par les observations les plus exactes (…) nous avons découvert qu’une bibliothèque nombreuse était le rendez-vous des plus grandes extravagances et des plus folles chimères. De votre temps, à la honte de la raison, on écrivait, puis on pensait. (…) Rien n’égare plus l’entendement que des livres mal faits ; car les premières notions une fois adoptées sans assez d’attention, les secondes deviennent des conclusions précipitées, et les hommes marchent ainsi de préjugé en préjugé et d’erreur en erreur. » Voici ce que ces sages humains qui après nous vivront ont donc fait :
D’un consentement unanime, nous avons rassemblé dans une vaste plaine tous les livres que nous avons jugé ou frivoles ou inutiles ou dangereux ; nous en avons formé une pyramide qui ressemblait en hauteur et en grosseur à une tour énorme : c’était assurément une nouvelle tour de Babel. Les journaux couronnaient ce bizarre édifice, et il était flanqué de toutes parts de mandements d’évêques, de remontrances de parlements, de réquisitoires et d’oraisons funèbres. Il était composé de cinq ou six cents mille commentateurs, de huit cents mille volumes de jurisprudence, de cinquante mille dictionnaires, de cent mille poèmes, de seize cents mille voyages et d’un milliard de romans. Nous avons mis le feu à cette masse épouvantable, comme un sacrifice expiatoire offert à la vérité, au bon sens, au vrai goût. Les flammes ont dévoré par torrent les sottises des hommes, tant anciens que modernes. L’embrasement fut long. Quelques auteurs se font vus brûler tout vivants, mais leurs cris ne nous ont point arrêtés ; cependant nous avons trouvé au milieu des cendres quelques feuilles des œuvres de P***, de De la H***, de l’abbé A***, qui, vu leur extrême froideur, n’avaient jamais pu être consumées.
Ainsi nous avons renouvelé par un zèle éclairé ce qu’avait exécuté jadis le zèle aveugle des barbares. Cependant comme nous ne sommes ni injustes ni semblables aux Sarrasins qui chauffaient leurs bains avec des chef-d’œuvres, nous avons fait un choix : de bons esprits ont tiré la substance de mille volumes in-folio, qu’ils ont fait passer toute entière dans un petit in–douze ; à-peu-près comme ces habiles chimistes, qui expriment la vertu des plantes, la concentrent dans une fiole, et jettent le marc grossier (a).
Nous avons fait des abrégés de ce qu’il y avait de plus important ; on a réimprimé le meilleur : le tout a été corrigé d’après les vrais principes de la morale. Nos compilateurs sont des gens estimables et chers à la nation ; ils avaient du goût, et comme ils étaient en état de créer, ils ont su choisir l’excellent, et rejeter ce qui ne l’était pas. Nous avons remarqué (car il faut être juste) qu’il n’appartenait qu’à des siècles philosophiques de composer très peu d’ouvrages ; mais que dans le vôtre, où les connaissances réelles et solides n’étaient pas suffisamment établies, on ne pouvait trop entasser les matériaux. Les manœuvres doivent travailler avant les architectes.
____________________
(a) Tout est révolution sur ce globe : l’esprit des hommes varie à l’infini le caractère national, change les livres et les rend méconnaissables. Est-il un seul auteur, s’il fait penser, qui puisse se flatter raisonnablement de n’être point sifflé chez la génération suivante ? Ne nous moquons-nous pas de nos devanciers ? Savons-nous les progrès que feront nos enfants ? Avons-nous une idée des secrets qui tout à coup peuvent sortir du sein de la nature ? Connaissons-nous à fond la tête humaine ? Où est l’ouvrage fondé sur la connaissance réelle du cœur humain, sur la nature des choses, sur la droite raison ? Notre physique ne nous présente-t-elle pas un océan dont à peine nous côtoyons les bords ? Quel est donc ce risible orgueil qui s’imagine follement avoir posé les limites d’un art !

C’est justement du livre et de Google qu’ont débattu – ou plutôt discouru sans réel échange – aujourd’hui les quatre participants de la table ronde Le Livre et Google… Et maintenant ? au Salon du livre de Paris : Jean-Noël Jeanneney (ancien président de la Bibliothèque nationale de France), Philippe Colombet (directeur du programme Google Livres France), Jean-Yves Mollier (auteur et professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles) et l’éditeur Antoine Gallimard. Un cinquième invité, et pas des moindres, avait fait défaut : Emmanuel Hoog (président de l’Ina). L’animateur en était le sénateur Jack Ralite qui a donné le ton, en parlant de « l’efficacité insolente de Google ». Voulant démontrer que rien n’est inéluctable, il cite Pierre Boulez : « L’histoire n’est pas ce qu’on subit mais qu’on agit ».1 Ralite serait sans doute surpris de savoir que Boulez préconisait, à l’instar de René Char, de « mettre le feu à sa bibliothèque tous les jours »…
Dans son discours, Jeanneney a repris ses prises de position d’alors (2005) comme de maintenant et n’a pas manqué de souligner leur écho : son livre Quand Google défie l’Europe en est à sa troisième édition et est traduit en une douzaine de langues. En bref : il y a violation de copyright d’une part et péril de monopole d’autre part ; le « vrac » (on numérise n’importe quoi) et la non-hiérarchisation (des réponses aux interrogations, où Jeanneney a d’ailleurs confondu page ranking du moteur de recherche des pages Web et critères de pertinence des réponses aux interrogations de Google Books) sont pernicieux, et il déplore que la hiérarchisation mise en place en 2005 dans Gallica ait été supprimée ; la conservation à long terme du patrimoine culturel (numérique, en l’occurrence) et son accessibilité universelle ne peuvent être confiées à des entreprises privées dont la durée de vie est en général bien moins longue que celle des États et de leurs organismes publics ; et enfin : il n’est pas opposé à un accord avec Google, s’il se fait d’égal à égal et sans se soumettre à des conditions léonines qui aboutiraient à la privatisation monopolistique de ces contenus numériques. Il est donc favorable aux recommandations de la commission Tessier (sur la numérisation du patrimoine écrit), qui préconise entre autres un partenariat public-privé basé sur l’échange de fichiers, et, fin stratège, n’exclut pas l’accès (micro-)payant à des contenus sous droit. Il estime qu’un accord qui serait obtenu avec Google sur des bases équitables et ouvertes bénéficierait aussi à Europeana.
L’argument pour la numérisation sélective et contre ce «vrac » est curieux à plusieurs égards : il provient de l’ex président de l’organisme chargé, via le dépôt légal, de conserver toutes les traces de l’édition nationale sans distinction de valeur ; il ignore le fait que les numérisations qui se sont effectuées dans Google Books sont celles d’ouvrages provenant d’autres grandes et respectables bibliothèques – considère-t-il donc que leurs collections sont « un vrac », en d’autres termes qu’il ne faille pas numériser tous les contenus d’une bibliothèque, de façon exhaustive, pour en faciliter l’accès ? Si c’était le cas, pourquoi diable garder dans une bibliothèque des ouvrages auquel l’accès serait limité ? Quant à la hiérarchisation par sujet des contenus de Gallica, elle est bien disponible.
Colombet a déclaré de son côté que l’action de Google dans ce domaine couvrait trois domaines : les livres du domaine public, pour lesquels Google fournit l’accès à l’intégralité de leurs fichiers numérisés en modes image et textes, téléchargement y compris, dans le but de générer la circulation la plus grande de ces œuvres ; les livres épuisés mais encore sous droits, qui sont numérisés aux fins d’indexation, mais dont Google ne présente au mieux qu’un bref extrait ; et enfin, les livres contemporains et leur inscription dans la chaîne du livre : Google vise à trouver des accords avec des éditeurs afin de permettre une « indexation profonde » de ces ouvrages, et répondre aux requêtes des internautes par des références contextualisées (l’ouvrage, Wikipedia, etc.) sans pour autant fournir – pour le moment – l’accès au contenu, mais en indiquant que l’internaute devra le lire dans une bibliothèque ou l’acheter dans une librairie.
Tout usager régulier de Google Books aura constaté que nombre d’ouvrages du domaine public qui y sont référencés n’y sont pas accessibles. C’est le cas par exemple de l’ouvrage de Poullain de la Barre, De l’égalité des deux sexes (…) où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés, dont nous avons parlé ailleurs : publié en 1673, aucune de ses versions n’est lisible dans Google Books, tandis qu’elles le sont dans Gallica. Quant aux ouvrages dont le contenu est accessible, partiellement ou intégralement, aucun autre moteur de recherche ne peut les indexer, et les bibliothèques partenaires se voient enjointes par Google d’interdire l’indexation des exemplaires numériques que Google leur retourne ; ces faits contredisent l’argument que Google vise à leur donner « la plus grande circulation » – si ce n’est que par leurs propres outils, soutenant ainsi la thèse de monopole lancé par leurs détracteurs. En ce qui concerne la numérisation des ouvrages épuisés, leur numérisation aurait nécessité que Google en obtienne le droit de reproduction, ce qui n’a d’évidence pas été fait. Et enfin, pour les ouvrages contemporains, comme le relatera J-Y Mollier à propos d’un de ses ouvrages récents, ils s’y retrouvent parfois en accès libre du fait de leur présence dans le fonds d’une université américaine participant au programme Google Books en dépit du droit des auteurs (on sait les procès en cours, auquel fera allusion Antoine Gallimard). Google fournit parfois, pour ces livres, une liste de librairies en lignes permettant de les acheter, mais – contrairement à Libfly d’Archimed, par exemple – par d’adresses de bibliothèques où l’on pourrait les lire sans les acheter. Y a-t-il une raison commerciale à ce choix (en d’autres termes, les librairies payeraient-elles pour être ainsi référencées) ?
Enfin, on remarquera – comme on l’a fait lors de cette « table ronde » – qu’au moins sur un aspect important Google Books est plus pauvre, dans ses modes de recherche, que quasiment n’importe quelle bibliothèque réelle : on ne peut y effectuer des recherche par sujet : il y a bien une case permettant de le faire, mais la liste des sujets semble très réduite, monolingue (ce qu’Europeana vise à dépasser), et ne pas correspondre aux ouvrages auxquels ces termes sont accolés (ainsi, le sujet « musique », en français, ne renvoie à aucun des ouvrages de Boulez en français – mais à d’autres auteurs – tandis que le terme « music » les retourne bien).
Jean-Yves Mollier, dans une intervention vive et passionnée – bouleversé qu’il paraît par l’attitude scandaleuse de Google –, a tout d’abord relaté la mise en ligne indue dans Google Books d’un livre qu’il avait publié en 2008. Puis, en historien, il a rappelé que le projet initial de la Très Grande Bibliothèque, décidé par François Mitterrand (projet dans lequel il avait été partie prenante avec Pascal Ory) avait préconisé la numérisation d’un million de livres : si cela avait été fait, dit-il, il n’y aurait pas eu de Google Books ; or suite à « la carence, la lâcheté, la démission des pouvoirs publics », selon ses termes, cela n’a pu se faire. Il mentionne longuement Robert Darnton (directeur de la bibliothèque de Harvard), qui, dans une récente conférence consacrée à la numérisation du patrimoine des bibliothèques et moteurs de recherche, avait tout d’abord cité Mercier (voir ci-dessus) mais surtout proposé de racheter à Google tous les fonds qu’ils ont numérisés, afin de les déposer dans une bibliothèque numérique nationale. Millier préconise de confier la totalité à l’Unesco, et d’en faire une vraie bibliothèque publique universelle, celle de l’organisme étant pratiquement inexistante. Quant à la démarche de Google qui, dans les faits, s’atèle à numériser le patrimoine national profitant du défaut de l’État devant l’immensité de la tâche, il la compare à celle des Mormons qui avaient entrepris de microfilmer gratuitement tous les registres paroissiaux (pour leurs propres fins, celles de convertir rétrospectivement les morts à leur religion…). Il est clair pour Mollier que la transformation de Google de moteur en libraire, puis, dès mai prochain, de libraire en éditeur, était un processus inéluctable et inquiétant.
Dans une brève réponse, Colombet a affirmé qu’il était hors de question que son employeur devienne éditeur. Comme exemple d’un dépôt public de livres numérisés, il a mentionné le Hathi Trust2, dont l’accès aux contenus intégraux libres de droits est parfois, curieusement, plus restreint que celui que propose Google Books.
Alain Gallimard a exprimé son accord à la position de Mollier, et rajouté qu’il fallait être clair sur le fait que Google était une entreprise commerciale dont la façon de faire était choquante, et a laissé entendre que les poursuites à son encontre allaient continuer.
Pour finir, Jack Ralite s’est lancé dans un long développement, tandis que les autres participants, à l’exception de Philippe Colombet, calme, patient et tenace, s’étaient tous éclipsés pour d’impérieuses raisons.

À l’instar de Sébastien Mercier, on s’était déjà demandé, dix ans plus tôt quasiment jour pour jour, si la bibliothèque du futur, de ce futur numérique dans lequel nous entrons à marche forcée, se réduirait à une seule étagère, voire à un seul livre blanc, en papier électronique… Aujourd’hui, on peut se demander si, à l’avenir, le Salon du livre, pourtant très fréquenté aujourd’hui par une foule particulièrement intéressée par les livres « physiques » qu’elle feuilletait puis achetait, se transformera en un Salon du livre numérique, pour se ternir dans Second Life, sans aucune réelle présence, ni celle des autres lecteurs, ni celle du livre-objet, ni celle des éventuels médiateurs entre les uns et les autres que sont les éditeurs et les bibliothécaires. Brave new world…
_____________________
1 Plus exactement : L’histoire est ce qu’on y fait. Je suis très ancré dans ce principe. Quand on se dit entraîné par la fatalité de l’histoire, c’est qu’on n’est plus à même d’agir ; or, en un sens, l’histoire est une chose qu’on agit et non pas qu’on subit. (Pierre Boulez : Entretiens avec Célestin Deliège, 1975).
2 Il s’agit d’une bibliothèque numérique résultant de la collaboration d’une bonne vingtaine d’universités américaines et ouverte à tout organisme au monde qui souhaiterait devenir partenaire. Elle comprend à ce jour plus de cinq millions d’ouvrages. On y trouve des ouvrages numérisés par Google, mais on ne peut que les consulter en ligne gracieusement ; il est impossible de les télécharger, mais, pour certains, d’en acheter (via Amazon) un exemplaire papier imprimé à la demande… Cette bibliothèque numérique fournit pour chaque ouvrage un lien vers le service Worldcat, qui permet d’en localiser des exemplaires dans des bibliothèques participant au réseau OCLC.