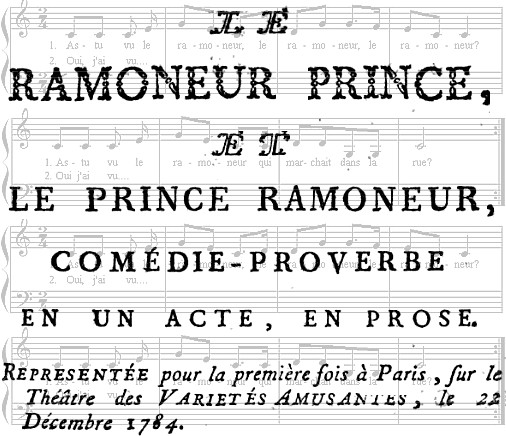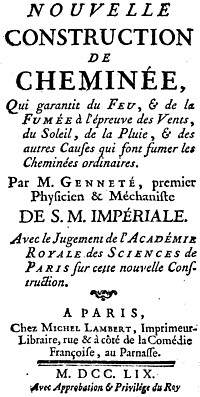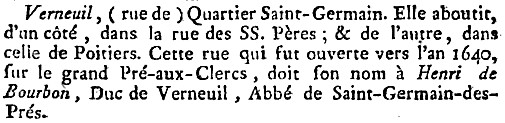Honoré Daumier : entracte à la Comédie-Française.
Bureau d’esprit. Se réunir à certaines heures, en certain lieu, avec l’intention arrêtée d’avoir ou de faire de l’esprit, dans un local et pour un temps donné, c’est ce qu’on appelle tenir un bureau d’esprit, comme de toute autre marchandise qu’on mettrait dans le commerce. L’expression est assurément aussi juste que pittoresque. Des gens qui, soit par une vanité excessive, soit au contraire par défiance de leurs forces, n’aimaient pas à avoir affaire au grand et véritable public qu’ils regardaient, les premiers comme un juge trop grossier, les autres comme un juge trop sévère, ont imaginé de se faire un petit public à leur usage, une coterie qui offre le double avantage, aux uns de pouvoir passer pour un esprit brillant et aux autres de promettre l’indulgence que garantit toute camaraderie (voy. ce mot). Mais pour se dédommager de cette contrainte imposée à l’envie en dedans du cercle convenu, on se montrait impitoyable envers les gens du dehors, et on jetait au rebut tout ce qui n’était pas marqué au timbre de la petite académie. Comme les membres de ces associations s’occupaient de leur affaire avec beaucoup de chaleur, et que les femmes, qui presque toujours en avaient la direction, exerçaient alors mille moyens d’influence, on finissait souvent par surprendre au vrai public la confirmation des arrêts rendus par le docte aréopage, et les réputations les plus importantes ont souvent été à la merci d’autorités fort peu compétentes. À l’époque dont nous parlons, les principaux théâtres de ces tripotages littéraires ont été l’hôtel Rambouillet où régnait Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet ; plus tard les hôtels de Marie-Anne de Mancini et de la duchesse du Maine, de Mme de Tencin, de Mmes Duchâtelet et du Bocage, du Deffant et Geoffrin, et enfin celui de Mmes Necker et Fanny de Beauharnais. Nous renvoyons à chacun des articles biographiques qui concernent ces femmes célèbres, l’indication du rôle que jouait chacune d’elles dans le bureau dont elle était présidente, et de la direction spéciale qu’elle y donnait aux esprits, afin d’avoir un cachet et de faire école.
Il n’y a plus de bureaux d’esprit aujourd’hui, par ces raisons, trop souvent déduites, qui font que nous n’avons plus de salons ; mais la funeste influence des coteries n’en subsiste pas moins en littérature, »et elle s’exerce peut-être plus fatalement que jamais dans la presse périodique où hommes et femmes se sont donné rendez-vous en disant adieu aux salons.
P. Lavergne, in Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1834.

Cabale (théâtre). On désigne également sous ce nom les moyens déployés par un auteur ou un acteur pour faire applaudir ses pièces ou son jeu, parfois aussi pour faire siffler ceux d’un confrère ou d’un camarade, et l’ignoble milice chargée de ce soin. L’origine de la cabale théâtrale est plus ancienne qu’honorable ; elle remonte à l’un des tyrans les plus odieux qui aient pesé sur le genre humain : Néron, le premier, organisa une troupe de cabaleurs qui devaient provoquer et même contraindre les applaudissements lorsqu’il venait se donner en spectacle aux Romains. Plaute et Térence n’avaient point eu besoin d’un tel appui ; ils sollicitaient franchement les témoignages de l’approbation publique (plaudite cives!), et laissaient à leurs ouvrages le soin de les obtenir.
Rien n’indique non plus que les célèbres poètes dramatiques du siècle de Louis XIV aient fait usage d’une pareille ressource ; on sait qu’une cabale de grands seigneurs fut alors formée en faveur de la Phèdre de Pradon contre celle de Racine. Sa tactique fut d’amener à ses frais à la première un grand nombre de spectateurs, et de louer beaucoup de loges à la seconde pour les laisser vides pendant plusieurs représentations. Ce genre de cabale n’est pas à la portée de tout le monde, et l’on n’en pourrait pas citer beaucoup d’exemples.
C’est vers le milieu du siècle dernier que la cabale applaudissante et sifflante prit pied dans nos spectacles. Un certain chevalier de La Morlière, auteur de quelques mauvais romans, en fut le chef au Théâtre-Français ; redouté des écrivains dramatiques, il leur imposa des tributs, auxquels Voltaire lui – même dut parfois se soumettre. Néanmoins comme le public n’avait pas encore perdu l’habitude d’exprimer lui-même sa satisfaction ou son mécontentement, la petite armée du chevalier pouvait rarement décider seule une chute ou un succès : il lui fallait se borner à rendre l’une plus prononcée ou l’antre plus éclatante.
Aujourd’hui la cabale a perfectionné ses moyens et accru outre mesure le nombre de ses troupes (voy. Claqueurs) : aussi marche-t-elle dans tous nos théâtres le front levé. Chaque directeur, chaque auteur, chaque acteur a la sienne ; ce que l’on qualifiait jadis de honteuse manœuvre n’est plus qu’une utile précaution. On rirait à présent de l’ingénuité de ce couplet d’une pièce jouée il y a une trentaine d’années:
Loin cette ressource banale !
Un auteur qui sait s’estimer
Peut bien souffrir d’une cabale,
Mais ne doit jamais en former.
Si le parterre l’encourage,
Son talent seul en a l’hommage ;
Et le mérite de l’ouvrage
Est la cabale de l’auteur.
L’honnêteté consiste maintenant à n’employer la cabale que pour s’assurer une réussite, en s’abstenant d’en faire une arme offensive contre ses émules ; et cette honnêteté-là n’est pas encore une vertu des plus vulgaires.
Quelques bonnes gens, qui ignorent que les cabaleurs amis forment toujours la majorité du parterre à une première représentation de quelque importance, font encore quelquefois entendre le cri de à bas la cabale ! à la porte la cabale ! Heureusement la cabale ne prend pas la chose au sérieux ; »car s’il y avait conflit, il lui serait facile de mettre elle-même à la porte le public, ou du moins le public payant. Il faut lui savoir gré de sa modération.
M. Ourry, in Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1834.

Camaraderie littéraire. Quand M. H. de Latouche s’avisa de lancer sous ce titre un manifeste auquel la Revue de Paris servit de héraut, une protestation privée contre l’abus et le ridicule d’un charlatanisme devenu trivial, l’à propos de sa critique suffit à consacrer une expression jusque là inusitée dans le sens qu’il y attacha. Mais cette alliance de mots, pour être un néologisme, ne s’appliquait pas moins à une chose aussi vieille que le monde. Lucien décoche quelque part une de ses vertes épigrammes à ces vendeurs de complaisances réciproques fort à la mode de son temps, et Martial n’épargne pas les Maevius et les Bavius, effleurés par Virgile et trop ménagés par la fine raillerie d’Horace.
Le proverbe thérapeutique Passe-moi la casse et je te passerai le séné[La casse et le séné sont deux purgatifs, mentionnés avec la rhubarbe (elle aussi agissant ainsi…) dans Le Médecin malgré lui. L’expression signifie « Donnant donnant ».], est applicable à presque toutes les conditions et à tous les états ; mais nous le voyons justifié d’une manière incroyable dans l’histoire de la république des lettres, surtout à certaines époques plus rapprochées de la nôtre. Il n’est personne qui n’ait ouï médire à juste titre de ces réunions soi-disant littéraires de l’hôtel Rambouillet, devenu si fameux par la morgue et le pédantisme de ses familiers, par leur esprit exclusif, leurs proscriptions, leur argot, et surtout par l’inconcevable exagération de leurs apologies et de leurs ovations. Combien d’astres sont restés sur l’horizon de cette pléiade de beaux esprits, organisée en cour suprême et qui prétendait de bonne foi imposer ses burlesques arrêts au goût à venir sur la foi des dupes contemporaines ?
De nos jours la camaraderie littéraire a reçu d’immenses développements ; mais il est digne de remarque que ces coalitions transitoires d’intérêts opposés, ces parades d’amitiés mielleuses et emphatiques entre des puissances rivales, ont presque toujours pour résultat infaillible quelque réaction violente et contradictoire. Fatigués de leurs encensements mutuels et ne pouvant plus se regarder sans rire, les acteurs de ces comédies, dès qu’ils ont touché le prix banal réservé à leur fraternité de coulisses, se dédommagent des secrets ennuis de leur rôle par l’aigreur des récriminations publiques et la franche manifestation de leurs antipathies ; une inimitié déclarée succède à ces flagorneries de commande et les choses se passent à peu près comme dans la scène de Molière entre Vadius et Trissotin. Oh ! les bons camarades ! Ce mot pourtant, qui peint à l’esprit de riantes et affectueuses idées, qui rappelle de touchants souvenirs de la jeunesse, »cadrerait si bien avec l’intimité noble et généreuse dont il serait consolant de voir les littérateurs donner l’exemple. Voy. Coteries.
V. de Moléon, in Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1834.

Claqueurs. Nous avons dit à l’article Cabale de théâtre (voy.) que Néron, auteur et acteur, s’assura le premier le honteux appui de ces machines applaudissantes. C’est sans doute ce qui leur a fait donner de nos jours, avec le sobriquet de chevaliers du lustre, celui de Romains. On a vu que ce nouveau genre d’industrie commença à s’exercer chez nous dans le dernier siècle ; aujourd’hui c’est une lèpre attachée à tous nos théâtres, et qui, si l’on n’y porte remède, finira par entraîner leur ruine. On sait, en effet, que le public véritable n’applaudit plus, afin de ne pas être confondu avec les gens chargés de cet emploi ; qu’il ne siffle guère davantage pour ne pas s’exposer à leurs fureurs stipendiées. Qu’en résulte-t-il ? Qu’aux premières représentations l’opinion publique ne peut se faire jour, que tout réussit en apparence, et que les spectateurs payants ne protestent que par leur absence contre ces prétendus succès.
Le métier de claqueurs, ou du moins de chef des claqueurs, est devenu aujourd’hui une ressource des plus productives. Dans une petite pièce jouée en 1783, La Harpe faisait dire à un M. Claque, représentant de cette honnête corporation :
Et je gagne en bravos mes vingt écus par mois.
Nos MM. Claque actuels souriraient de dédain à cet aveu ; il en est tel d’entre eux qui, avec la rétribution des directeurs, des auteurs, des acteurs et actrices, la vente d’une partie des billets gratis et autres profits de son commerce, s’est acquis une fortune en quelques années et en se retirant a vendu fort cher sa clientèle. Il est vrai que l’art a fait dans ce genre de grands progrès. Au principal corps d’année, toujours composé de bruyants claqueurs, un chef habile a soin d’adjoindre un détachement de pleureurs et un autre de rieurs. Ces dernières fonctions surtout exigent beaucoup de talent et de naturel.
Il est d’usage que, pour faciliter son travail du soir, le claqueur en chef ait assisté le matin à la répétition générale : il y prend note des passages qui devront faire éclater les applaudissements, les sanglots ou le rire. Des gestes convenus transmettront à ses troupes le signal de ces diverses manœuvres. Il est de règle aussi que, par une entrée particulière, les claqueurs soient introduits dans la salle avant les autres spectateurs, afin de choisir leurs positions et de préparer leur ordre de bataille. Ceci est le secret de la comédie, comme du vaudeville, du mélodrame, etc., etc.
Devant éprouver presque journellement cet accès d’enthousiasme qui lui fait demander l’auteur à grands cris, le claqueur doit être pourvu de poumons aussi robustes que ses mains ; cependant, en cas d’enrouement, un redoublement d’activité de ces derniers et un trépignement frénétique de pieds à la chute du rideau peuvent suppléer à son silence obligé.
Plusieurs fois des écrivains dramatiques, des directeurs de spectacle, ont témoigné l’intention de renoncer aux applaudissements achetés ; »mais les premiers ont vu le corps des claqueurs fortement constitués triompher de leurs efforts isolés ; et, il faut le dire, aucun des seconds n’a eu le courage difficile d’attacher franchement le grelot.
M. Ourry, in Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1834.

Coterie, mot français très ancien et qui signifiait société, compagnie. Quant à son étymologie, on le dérive du mot latin quot, combien.
Au XIIIe ou XIVe siècle, lorsque les petits marchands voulaient faire quelque entreprise commerciale, ils formaient une coterie, c’est-à-dire une association partielle, car de tous temps les associations furent la meilleure ressource des petits. Chacun apportait sa quote-part d’argent ou de marchandises, et chacun devait de même recueillir sa quote-part du succès ou du bénéfice.
Lorsqu’il y eut un certain nombre d’amateurs de la gaîté, c’est-à-dire dans les intervalles entre les guerres civiles (car il n’y a pas de joie là où parents sont contre parents et amis contre amis), il se forma des coteries de plaisir : celles-là se sont maintenues et multipliées. On y statua qu’on se verrait familièrement pour se livrer à des exercices bachiques ou gastronomiques, qu’il y aurait des jours d’assemblée, de grands festins si c’était entre personnes riches, et des pics-nics (voy.Expression empruntée de l’anglais où elle est formée de pick, choisir, et nick, instant précis, et signifie choix judicieux où tout se rencontre bien. On se sert aussi en français de cette locution pour désigner un repas où chacun paie son écot, ou bien auquel chacun contribue en fournissant un des plats.) si c’était entre personnes mixtes.
Enfin, lorsque l’on eut une littérature, il y eut des coteries littéraires ou plutôt de beaux-esprits, car les beaux-esprits ne sont pas toujours littéraires. Telle fut la société de l’hôtel de Rambouillet, qui fit la guerre à Racine, à Corneille, à Molière. Alors apparurent diverses associations d’envieux, d’esprits de travers qui se coalisèrent contre quelques hommes de génie isolés, pour les empêcher d’être connus ou d’avoir des succès [voy. Camaraderie et Cabale). De bonne heure il y eut des gens qui se dirent entre eux : « Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos amis. » La religion même fut dénaturée par des coteries d’hypocrites, de bigots, d’hommes à bénéfices, qui, exploitant les préjugés et les esprits crédules, abusaient du besoin de croire et faussaient les sublimes vérités du christianisme.
Les coteries, hélas ! c’est presque l’histoire du monde ; tous les partis n’ont-ils pas été des coteries dans leurs commencements? Mais, à proprement parler, il n’y a eu que ces trois espèces de coteries permanentes : celle ou chacun apporte sa quote-part de fonds ; la seconde, où chacun apporte sa quote-part de gaîté, et la dernière, où chacun apporte sa quote-part d’esprit vrai ou d’esprit prétendu, de bons ou de méchants mots de prose, de vers, et d’écrits qui ne sont ni l’un ni l’autre. Plus les temps se sont avancés, plus le terme de coterie est tombé en défaveur, parce que les coteries commerciales ont été réglées par les lois, que les coteries de plaisir ont ébranlé les mœurs, et que les coteries d’esprit ont produit la discorde et le ridicule ; et cependant toutes les coteries possibles sont encore fort innocentes, comparées aux coteries politiques. Mais tous les partis ont l’habitude de qualifier de ce nom les réunions de leurs adversaires, et ils se le sont constamment renvoyé les uns aux autres.
Les coteries qui se forment contre le talent ou le mérite, celles qui se forment entre les intérêts de quelques hommes contre les intérêts de tous, sont méprisables et odieuses. »Malheureusement elles n’en sont pas plus rares, et il ne faudrait pas aller bien loin pour en trouver des exemples.
Pierre-Marie-Michel Lepeintre-Desroches, in Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1834.

Public, un des mots les plus usités de notre langue, et l’un des plus difficiles à définir. Qu’est-ce que le public ? l’universalité des citoyens ? un choix parmi eux ? les lecteurs de tel journal ? les claqueurs de tel drame ? l’auditoire de tel orateur ? les prôneurs de tel médecin ? les détracteurs de tel artiste? Demanderons-nous avec un moderne combien faut-il de sots pour faire un public ? L’appellerons-nous avec un ancien : Vox Dei ? La voix de Dieu ! Le public ne fut-il pas personnifié par les anciens sous le nom de la Renommée, aussi empressée à tenir pour le mensonge et la calomnie qu’à répandre la vérité ? Tout yeux, tout oreilles, tout langues, que voit-il ? qu’entend-il ? que dit-il ? Si l’on écoute, mille bruits incohérents s’élèvent. Devant un fait quelconque, le public dit blanc, le public dit noir ; il nie, il affirme ; il blâme, il approuve. Demandez un avis au philosophe, il vous conseillera de mépriser le public, et vous le surprendrez bientôt après gueusant des voix et mendiant des admirateurs !
Si vous vous mêlez à la foule, si vous passez d’un groupe à l’autre, vous ne tarderez pas à reconnaître .que le public se fractionne en publics d’opinions diverses, et que ces publics n’en font pourtant qu’un. Grâce au jeu des passions humaines, le monde est le plus étrange des spectacles. Pêle-mêle de prétentions audacieuses et d’acquiescements faciles, il a des enthousiasmes ridicules et des mépris immérités ; théâtre d’une lutte éternelle entre les vanités, il est l’une des plus frappantes images du beau absolu, si le beau n’est, comme on l’a dit, que la variété dans l’unité. Quelle variété piquante, en effet, que ces publics de toute nature, de tout étage, de toute dimension ! public de l’antichambre et public de la rue ; public du parlement et public des tavernes ; public qui caresse et rampe ; public qui a sa cour et ses flatteurs ; public ingrat et trompé, défiant et crédule, despote et victime ; public qui a tout ce qui est dans son élément (l’homme), une raison qui commande et des passions qui la font obéir, raison souveraine, quelque peu ressemblante aux rois constitutionnels dont la volonté plie au gré des Chambres: elle aussi règne et ne gouverne pas.
Que si nous consultions l’histoire, nous verrions le public naître et grandir avec la civilisation, partout présenter un fonds semblable, partout recevoir des empreintes diverses dans les divers climats, partout avoir entre les traits qui le différencient un trait spécial, l’aptitude à être dupe. De là ses travers, son inconstance, ses caprices, sa faiblesse, ses antipathies, ses adorations ; de là ses croyances aveugles et ses émancipations réactionnaires, ses respects absurdes et ses émotions fécondes en ruines ; de là et son abjection dans le servilisme, et ses transports dans le triomphe, et les directions étranges qu’il subit ; de là enfin l’inconséquence de ses révolutions, qui tendent à le mettre en possession de la vérité et qui le montrent sans cesse dans de nouvelles phases de l’erreur. Curieuse comédie, que le spectacle incessant donné par le public ! car toujours il est en scène, et, s’il en faut croire Oxenstiern, « les hasards composent la pièce, la fortune distribue les rôles, les théologiens gouvernent les machines et les sages sont les spectateurs ; les riches occupent les loges, les puissants l’amphithéâtre, et le parterre est pour les malheureux ; les femmes portent les rafraîchissements à l’entour, et les disgraciés de la fortune mouchent les chandelles ; les folies composent le concert, et le temps tire le rideau ; la pièce a pour titre : Mundus vult decipi: decipiatur[« Le monde veut être trompé, qu’il le soit donc. » Attribué à Pétrone.] ! » En sera-t-il toujours ainsi? Nous ne le croyons point. Non, certains rôles ne seront pas toujours l’objet de la brigue-,des pygmées ne tiendront pas toujours la place de géants ; les coulisses ne recèleront pas toujours d’odieux secrets ; le public ne sera pas toujours ce docile automate dont le charlatanisme tire en tous sens les molles ficelles. Telle est l’espérance, telle est la foi des sages, qui, dès à présent, se rangent parmi le peuple de cette épigramme :
Ce monde-ci n’est qu’une œuvre comique
Où chacun fait ses rôles différents.
Là, sur la scène, en habit dramatique,
Brillant prélats, ministres, conquérants.
Pour nous, vil peuple, assis aux derniers rangs,
Troupe futile et des grands rebutée,
Par nous d’en-bas la pièce est écoutée ;
Mais nous payons, utiles spectateurs,
»Et, quand la farce est mal représentée,
Pour notre argent nous sifflons les acteurs.
(J.-B. Rousseau.)
J. Travers (à Caen), in Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1834.