Roi par la grâce du gâteau
Jan Steen : La fête des rois. 1662.
L’histoire de la fête des rois, de sa nonpareille galette et de la fève royale est fort ancienne, comme on peut le découvrir dans le texte qui suit. Avant que de devenir surtout l’objet d’un juteux (ou croustillant) commerce, la galette était, autrefois, une importante occasion de faire la charité aux plus démunis. Plus tard, elle a été récupérée par les classes supérieures, ce qui n’empêchait pas de faire montre de générosité et d’attention aux autres : l’anecdote concernant le cardinal de Fleury et son valet de cœur en est un exemple touchant.

«La fête des Rois se célébrait jadis avec infiniment plus d’appareil et de cérémonies joyeuses qu’aujourd’hui. Après les offices on représentait des mystères. Nous lisons dans les Mémoires de maître Jean de la Haye (ch. XX), que Hugues Capet avait une prédilection particulière pour la solennité des Rois, qu’il portait ce jour-là une étoile d’or à son chapeau, et en donnait de pareilles à ceux qui l’avaient le plus favorisé dans son élévation au trône. Ce fut le point de départ de l’ordre de Notre-Dame-de-l’Étoile, fondé par son fils Robert. Le continuateur de Guillaume de Nangis nous apprend que les rois de France offraient à l’autel, le jour de l’Épiphanie, de l’or, de l’encens et de la myrrhe, et il décrit l’une de ces cérémonies, qui se fit avec beaucoup de magnificence sous Charles V, en 1378.
Un ancien ordinaire de l’église de Sainte-Madeleine de Besançon, décrit ainsi la manière dont on célébrait l’Épiphanie.
Quelques jours avant la fête, les chanoines élisaient un d’entre eux auquel on donnait le nom de roi, parce qu’il devait tenir la place du Roi des rois. On lui dressait dans le chœur une espèce de trône ; une palme était son sceptre, et il officiait le jour de l’Épiphanie dès les premières vêpres.
À la messe, trois chanoines, revêtus de dalmatiques de trois couleurs différentes (blanche, rouge, noire), ayant couronne en tête, palme en main, suivis chacun d’un page portant leurs présents, sortaient de la sacristie et descendaient, en chantant l’évangile, dans l’église inférieure, qu’ils parcouraient, précédés d’une sorte de lustre figurant l’étoile. À cet endroit de l’évangile où il est dit que les mages entrèrent dans l’étable et y adorèrent notre Sauveur, ils remontaient au chœur, et venant à l’autel, ils se prosternaient devant le célébrant et lui offraient leurs présents, puis s’en retournaient du côté opposé à celui par lequel ils étaient venus. Le chanoine-roi, la veille et le jour de l’Épiphanie, l’office achevé, donnait à tous les confrères qui composaient sa cour une magnifique collation.
Les séculiers ne voulurent pas sur ce point céder en dévotion aux ecclésiastiques : ils résolurent de faire un roi dans chaque famille et choisirent le moment du repas, avec le sort pour arbitre. Un gâteau, partagé entre tous les convives, contenait une fève, afin que celui dans la part duquel elle se trouverait fût reconnu roi. Toute la famille se soumettait à ses ordres. Afin de lui marquer quelque distinction pendant le temps du repas, on criait : Le roi boit, vive le roi ! chaque fois qu’il buvait, et pour punir ceux qui manquaient à un devoir si important, on convint de les barbouiller de noir. Souvenir de l’opinion répandue parmi le peuple que l’un des trois rois mages était noir.1J. B. Bullet, Festin du Roi-boit.
Il est question du gâteau des Rois dès 1311, dans une charte de Robert, évêque d’Amiens, mais nous manquons de renseignements anecdotiques sur la façon dont se célébrait cette partie de la fête dans une époque aussi reculée. Un peu plus tard, Jean d’Orrouville rapporte ainsi la manière dont Louis III, duc de Bourbon, choisissait son roi. « Vint le jour des Rois, où le duc de Bourbon fit grande fête et lie chère, et fit son roi d’un enfant en l’âge de huit ans, le plus pauvre que l’on trouva en toute la ville, et le faisait vêtir en habit royal, en lui laissant tous ses officiers pour le gouverner, et faisait bonne chère à celui roi, pour révérence de Dieu, et le lendemain dînait celui roi à la table d’honneur. Après venait son maître d’hôtel, qui faisait la quête pour le pauvre roi, auquel le duc Louis de Bourbon donnait communément quarante livres pour le tenir à l’école, et tous les chevaliers de la cour chacun un franc, et les écuyers chacun demi-franc ; si montait la somme aucune fois près de cent francs, que l’on baillait au père ou à la mère pour les enfants qui étaient rois à leur tour, à enseigner à l’école sans autre œuvre, dont maint d’iceux vivaient à grand honneur; et cette belle coutume tint le vaillant duc de Bourbon tant qu’il vécut. »
Les écoliers de l’université de Paris passaient les jours des fêtes de la Saint-Martin, de Sainte-Catherine, de Saint-Nicolas, les fêtes des nations, des collèges et celles des Rois, en divertissements avec des farceurs et des comédiens qui dansaient et qui chantaient des airs tout à fait profanes.
Chaque fois que l’Épiphanie revenait, les Picards qui faisaient leurs études au collège du cardinal Lemoine choisissaient un des leurs pour représenter ce prélat. L’élu assistait aux premières vêpres en habit de pourpre, avec un aumônier chargé de porter son chapeau rouge, puis il régalait ses camarades de dragées et les réunissait dans un souper joyeux. La faculté des arts fit un statut en 1484 pour réprimer ces abus ; elle excepta néanmoins dans son décret la veille et la fête des Rois, jours auxquels elle permit aux écoliers de se réjouir honnêtement, après avoir assisté au service divin1Bullet, p. 249 et 250. Cette fête était tellement entrée dans les mœurs qu’on n’eût pu y toucher sans soulever des tempêtes.
C’est aussi la veille de l’Épiphanie que les corporations tiraient au sort de la fève un roi qui conservait son pouvoir toute l’année. Les clercs de la chambre des comptes organisaient un cortège à travers les rues, et allaient donner des aubades et distribuer des gâteaux à tous les membres de la chambre. Ce jour-là, le voyer prélevait une redevance d’un fromage sur les fromagers du marché aux PoiréesLa rue du Marché aux Poirées, supprimée en 1852, était en plein dans les Halles centrales : elle allait du Marché des Innocents au Carreau de la Halle et à la Halle aux Fruits, et elle occupait à peu près la partie de la rue Pierre Lescot qui s’étend de la rue Berger à la rue du la Cossonnerie. (Source : Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie, avril 1916), d’un gâteau à la fève sur chacun des pâtissiers des halles et une foule d’autres impôts en nature sur les petits artisans des rues et des places publiques2D. Carpentier, supplément à du Cange, III, col. 619. — De L’Hervillers, la Fête des rois, dans l’Ami de la religion des 6-8 janvier 1860..
G. Bouchet a écrit sa quatrième serée sur la fête des Rois. Il résulte de sa description que les masques, qui couraient alors les rues depuis le 1er janvier et même depuis Noël, comme nous le disons dans notre chapitre du carnaval, se présentaient dans les maisons où l’on avait tiré les Rois, pour y donner le momon. Ils portaient des défis au roi, et, comme les sujets de celui-ci se croyaient obligés de soutenir leur maître, parfois les convives perdaient tout leur argent dans une partie de dés avec ces mystérieux visiteurs. Les masques du momon jetaient souvent des dragées en entrant aux valets et aux chambrières, et ils jouaient des boîtes sèches de confitures, du cotignac et des sucreries de tout genre.
Les joueurs d’instruments couraient également la ville et se présentaient dans les maisons pour y faire danser. Il semble d’ailleurs, d’après quelques détails, que l’entrée fût à peu près libre en ces bacchanales du Roi-boit, car Bouchet parle, vers la fin du chapitre, d’un homme « assez d’apparence », qui s’était trouvé plusieurs fois dans ces assemblées, sans que personne le connût. On s’avisa de lui faire présenter le bouquet par une fort honnête damoiselle, au nom de toute la compagnie, pour l’inviter à rendre aux convives la politesse qu’il en avait reçue, mais il se trouva que c’était un adroit escroc. On voit aussi dans la même serée que les Rois se tiraient, comme aujourd’hui, la veille de l’Épiphanie, au moyen d’une fève, que beaucoup de gens s’efforçaient de cacher quand elle était dans leur part de gâteau, à cause des grands frais qu’entraînait la royauté. De là le dicton moqueur : « Vous diriez qu’il a trouvé la fève au gâteau. » On commençait par tirer la part de Dieu. Celui qui était désigné par le sort devait payer sa royauté quelques jours après. On criait : Vive le roi ! et : Le roi boit ! à tue-tête, comme on le fait encore; et ceux qui oubliaient de crier étaient à l’amende.
À ce propos, le roi de la serée, qui devait payer de sa personne en toutes les façons, dit quelques bons contes, suivant l’usage de nos pères. Le plus joli est celui d’un brave homme dont la femme braille comme une pie dès qu’il la touche du bout du doigt. À force de rêver au moyen de la battre tout son soûl sans danger, il s’avise que la meilleure époque est le jour des Rois, car elle aura beau crier, les voisins ne l’entendront pas, au milieu du tapage qu’ils font, ou, s’ils l’entendent, ils se figureront qu’on crie : le roi boit ! Là-dessus, un bon compagnon réplique qu’il comprend enfin la signification de ce qu’il a lu dans un almanach, à la vigile des rois : « Bon battre sa femme. »
Ailleurs, un roi de la fève raconte l’historiette suivante : « Vous savez tous que l’année passée nous fîmes les Rois en notre maison; vous savez qui fut roi, mais possible vous ne savez pas celui de mes gens qui le fut en leur table, ayant leur gâteau à part, et si pourtant leur royauté dura plus que la nôtre : car, après avoir crié et bu du meilleur, aussi bien que nous, en leur petite royauté, nous pensions qu’ils se fussent couchés et retirés comme nous; mais, ayant les poumons échauffés de crier et de boire, mes gens descendent en la cave, et après le bussard que j’avais percé ce jour-là. Le bon fut que leur roi commençant le premier à boire, comme il lui appartenait, sans penser en mal, ils vont crier à pleine tête : “Le roi boit, le roi boit.” Me réveillant en sursaut, et ma femme aussi, commençâmes à crier à notre force : “Le roi boit,” aussi bon qu’eux, de peur de l’amende, pensant être encore à table. Ma femme revenant à soi, se lève, et Dieu sait si elle ne cria pas plus fort que tous eux ensemble, trouvant tous nos gens à table, les pots et les verres tout pleins du vin nouvellement percé. »
Pasquier nous apprend que, pendant le repas des Rois, on mettait « un petit enfant sous la table, lequel le maître interroge sous le nom de Phébé, comme si ce fut un qui, en l’innocence de son âge, représentât une forme d’oracle d’Apollon. » À cet interrogatoire l’enfant répond d’un mot latin : Domine, puis, sur la demande du maître, il désigne la personne à laquelle doit être donné le morceau de gâteau1Recherches, 1. IV, ch. IX. .
On voit par une lettre de la princesse Palatine1Lettres nouv. et inédites, édit. Hetzel, p. 272. que les choses se pratiquaient encore de même à la fin du règne de Louis XIV : le premier morceau était pour le bon Dieu, et le deuxième pour la sainte Vierge. Si le bon Dieu avait la fève, c’est le maître de la maison qui était roi, et si c’était la sainte Vierge, elle cédait ses droits à la dame du plus haut rang qui se trouvait là. Le roi nommait des ministres et des chambellans ; il régnait sur la table comme dans un empire absolu.
Jean Deslyons, docteur de Sorbonne, doyen et théologal de l’église cathédrale de Senlis, fulmina en 1664 ses Discours ecclésiastiques contre le paganisme du roi-boit2Réédités en 1670 sous le titre de Traitez singuliers et nouveaux contre le paganisme du roi-boit, in-12. C’est cette édition que j’ai sous les yeux. où, au milieu de doctes dissertations qui, si je ne me trompe, se sentent un peu du jansénisme de l’auteur, il nous a laissé des détails extrêmement curieux sur les usages de cette fête. Pour Deslyons, le banquet des Rois et l’usage des étrennes sont, aussi bien que la fête des Fous, d’abominables restes du paganisme, et une continuation des saturnales cachée sous un voile chrétien.
Au moyen âge, du moins au treizième siècle, la veille de l’Épiphanie, comme celle de la Saint-Jean, était accompagnée de feux, auxquels le peuple attachait la même idée superstitieuse : « Il faut également rapporter à l’idolâtrie, écrit Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris, dans son livre des Lois, les feux qu’on a coutume de faire la veille de l’Épiphanie, et par le moyen desquels les insensés croient se garantir de la peste3Eodem modo et foci qui fieri consuerunt in vigilis Epiphaniae… per quos credunt insipientes se extinguere et exterminare pestium incendium. — Deslyons, en citant ce passage, rapproche de la même coutume celle de la bûche de Noël.. » L’habitude de ce feu, si toutefois Guillaume d’Auvergne veut parler d’un feu public, ne survécut pas au moyen âge ; mais l’Épiphanie n’en persista pas moins à être célébrée dans le peuple avec un entrain extraordinaire, même après que la fête des Fous, qui l’avait déshonorée si longtemps par ses bouffonneries sacrilèges, eût disparu. Les marchands de chapelsChapeau en forme de couronne. de fleurs remplissaient les rues, colportant et criant ces gracieux couvre-chefs dont les convives du festin se coiffaient et coiffaient les bouteilles ce jour là1Legrand d’Aussy, Vie privée des Français, t. II, p. 324-61. . Le bruit retentissant des rires, des acclamations, des verres heurtés les uns contre les autres, perçait les portes et les fenêtres; l’huis des pâtissiers resplendissait et faisait flamboyer au loin les figures bizarres de leurs lanternes vives ; les valets couraient par les rues, portant les gâteaux envoyés par le maître à ses amis ; les pauvres allaient de maison en maison chercher la part qu’on leur réservait, c’est-à-dire le premier morceau, le morceau du bon Dieu, choisi par le plus jeune des convives. Toute la nuit, la ville entière était sur pied et jusqu’au lendemain passait le temps en assemblées joyeuses, en jeux bruyants, danses, ballets, comédies et mascarades. Le roi et la reine d’un jour se présentaient à l’offrande, où l’on portait solennellement la fève trouvée dans le gâteau.
C’est à la suite de la fête des Rois de 1521 que François Ier, encore jeune et passablement fou, s’étant amusé, en tête d’une bande de joyeux compagnons, à aller faire à coups de pommes, d’œufs et de boules de neige, un siège en règle de l’hôtel du comte de Saint-Pol, qui était le roi de la fève, reçut sur la tête une bûche jetée par l’un des assiégés et qui le renversa sans connaissance. Revenu à lui, il ne voulut point qu’on recherchât le coupable, trouvant juste de payer la folie qu’il avait faite lui-même. L’homme à la bûche s’appelait Montgommery, et il était père de celui qui devait blesser mortellement Henri II dans un tournoi.
« Le lundi, sixième jour des Rois (1578), lit-on dans le Journal du règne de Henri III, la demoiselle de Pons de Bretagne, reine de la fève, par le roi désespérément brave, frisé et gauderonnéEnduit de goudron (on dirait de nos jours amidonné)., fut menée du château du Louvre à la messe en la chapelle de Bourbon, étant le roi suivi de ses jeunes mignons, autant ou plus braves que lui. Bussy d’Amboise s’y trouva à la suite de monsieur le duc, son maître, habillé tout simplement et modestement, mais suivi de six pages vêtus de drap d’or frisé. »
Ce n’est pas là un fait isolé; il se rattachait à une coutume générale de la cour d’Henri III, comme on le voit par un passage d’un autre historien, qui complète curieusement celui-là : « Du règne d’Henri III, on faisait à la cour, la veille de la fête des Rois, au souper, une reine de la fève. Et le jour des Rois, le roi la menait à la messe à son côté gauche; et si la reine y était, elle marchait au côté droit. Un peu au-dessous du roi, on préparait un oratoire et un drap de pied pour la reine de la fève, au côté gauche de celui du roi, avec son carreau à main droite. Le roi baillait à l’offrande avec l’écu trois boules de cire : l’une couverte de feuilles d’or, l’autre de feuilles d’argent, et la troisième couverte d’encens. Le roi, étant de retour en sa place sous le dais, la reine de la fève se levait, et ayant fait la révérence au roi et à la reine, allait à l’offrande. La reine n’y allait pas, et, après la messe, Leurs Majestés et la reine de la fève, somptueusement vêtues et parées, retournoient en grande pompe au Louvre, les trompettes et tambours sonnants. Cette cérémonie de la reine de la fève n’a point depuis été observée.1Du Pirat, Recherche des antiq. de la chapelle et oratoire du roy, cité par Deslyons, p. 208. V. aussi le Mercure de janvier 1684. La reine de la fève, jusqu’au règne de Louis XIII inclusivement, jouit à la Cour de grands privilèges : elle disposait des charges, quelles qu’elles fussent, qui venaient à vaquer dans les vingt-quatre heures, et s’il n’y en avait pas de vacantes, elle demandait au roi des grâces qu’il devait lui accorder. (Lettres inédites de la Princesse Palatine.) Tout cela était parfaitement dans les usages de l’époque. »
Le roi et quelquefois les grands seigneurs rendaient le pain bénit au son des tambours, des fifres et des clairons. Les nouvelles accouchées, lors de leurs relevailles, offraient solennellement des gâteaux à l’église. On peut voir, dans la Muse historique de Loret1L. XIV, 29 décembre 1663., la manière dont le duc de Mecklembourg, récemment converti au catholicisme, offrit le pain bénit à la chapelle de Saint-Michel, en le faisant escorter par une troupe de pages et de valets de pied, marchant deux à deux, et de tambours et trompettes en casaques de velours. Saint Michel était, d’ailleurs, le patron des pâtissiers, et c’est dans cette chapelle, située près du Palais de justice, que leur confrérie avait son centre de réunion. Une ordonnance prohibitive de l’archevêque de Paris, du 10 octobre 1636, montre qu’à cette date les confrères de Saint-Michel avaient l’habitude de promener dans les rues de la ville une procession composée de cavaliers vêtus en anges et de diables qui battaient de la caisse devant les prêtres porteurs de pains bénits2Lebeuf, Histoire de la ville et du diocèse de Paris, édit. Cocheris, t. II, p. 266-7..
Il est temps de fermer cette parenthèse et de revenir aux Rois.
La cour de Louis XIV resta fidèle à la coutume de tirer la fève. Madame de Motteville raconte, à la date de 1648, qu’elle sépara un gâteau des rois, en compagnie de sa sœur, de madame de Brégy et d’Anne d’Autriche, et qu’elles burent à la santé de celle-ci avec de l’hypocras qu’elle avait fait apporter à leur table. L’année suivante, le petit roi fut de la réunion. Anne d’Autriche fut proclamée reine, parce que la fève s’était trouvée dans la part de la Vierge. On célébra encore cette fête en buvant une bouteille d’hypocras, — liqueur fort à la mode au dix-septième siècle, faite avec du vin mêlé de sucre, de cannelle, de girofle, de gingembre, — et tandis qu’Anne d’Autriche buvait, tout le monde cria à tue-tête : « La reine boit ! la reine boit ! »
En 1684, les Rois furent célébrés en grande cérémonie. On avait dressé dans la même salle cinq tables, dont quatre étaient réservées aux dames. On y tira la fève à toutes les cinq ; puis le roi et les reines se choisirent des ministres et des ambassadeurs, pour aller complimenter les puissances voisines et leur proposer des traités d’alliance. Ce jeu donna naissance à une foule de discours et de plaisanteries agréables, où quelques courtisans montrèrent beaucoup d’esprit. Il plut tellement à Louis XIV qu’il voulut recommencer la semaine suivante ; on s’arrangea cette fois pour lui faire échoir la fève, qui était d’abord tombée au grand-écuyer, et il s’acquitta de sa charge en homme qui en avait l’habitude1Mercure galant, à la date..
Dans son Journal, Dangeau, comme avait fait avant lui Héroard, mentionne à peu près chaque année la célébration des Rois, presque toujours avec cinq tables, auxquelles s’asseyaient les principaux seigneurs de la cour. En 1691, il tira la fève à Versailles avec le roi et la reine d’Angleterre. Louis XIV ne manqua pas d’être favorisé par le sort à sa table. « Dans les deux tribunes, dit Dangeau, il y avait toute la musique du roi, avec des orgues, des trompettes et des timbales, et l’on criait : Vive le roi ! en musique. » Il est question plusieurs fois aussi de cette fête dans Saint-Simon.
On raconte que Louis XV ayant tiré la fève avec ses trois petits-fils, celle-ci se trouva coupée en trois morceaux, ce qui fut considéré comme l’annonce prophétique du règne successif des trois frères : « La partie supérieure, séparée des premières, prédit le martyre du jeune duc de Berry, Louis XVI ; l’inférieure, brisée, fut le symbole de la monarchie rompue au règne du dernier des trois, le comte d’Artois, depuis Charles X1Essai sur les fêtes religieuses, par Eug. Cortel, p. 47.. » Tout ceci semble infiniment trop subtil pour être autre chose qu’une anecdote apocryphe arrangée après coup.
Vers cette époque, ou un peu plus tôt, l’usage était de tirer les Rois avant le repas. Un jour Fontenelle avait eu la fève. On se mit à dîner : c’était au roi à présider la table et à veiller au bien-être des convives. On remarqua qu’il négligeait d’offrir à ceux-ci d’un excellent plat qu’il avait devant lui :
— Le roi oublie ses sujets, lui dit-on.
— Voilà comme nous sommes, nous autres, répondit Fontenelle avec son fin sourire.
Une autre fois encore, la fève lui était échue en partage :
— Vous êtes roi! fit un des convives. Serez-vous despote?
— Belle demande! répondit-il.
Nous avons dit plus haut qu’on faisait tirer le gâteau par un enfant ; à défaut d’un enfant, le plus jeune de la réunion en était chargé. À cette coutume se rattache une jolie anecdote, qui peut passer pour un trait de flatterie des plus ingénieux.
Le cardinal de Fleury avait 90 ans et se montrait frappé de l’idée de sa mort prochaine. Pour le guérir de ces sombres pensées, son valet de chambre, Barjac, fit prier à dîner chez Son Éminence, pour le jour des Rois, les onze personnes suivantes : le comte de Beaupré, l’abbé d’Enneville, le comte de Gensac, le marquis de Nogaret, la princesse de Montbarey, la marquise de Flavacourt, le marquis de la Faye, la comtesse de Combreux, le comte de Saint-Mesme, la marquise du Coudray et la marquise d’Anglure.
Au moment de tirer le gâteau :
— C’est au plus jeune que revient ce droit, fit mélancoliquement le cardinal de Fleury. Avec mes quatre-vingt-dix ans, je ne puis prétendre qu’aux honneurs du patriarcat.
— Mais, pardonnez, monseigneur, dit sa voisine de droite, la princesse de Montbarey, je suis née le 15 janvier 1651, et j’ai par conséquent deux ans de plus que Votre Éminence.
— Que dites-vous là, princesse ?
— La pure vérité, monseigneur.
— Moi, dit à son tour l’autre voisin du cardinal, je n’y mets plus de coquetterie, et j’avoue tout simplement mes quatre-vingt-onze ans.
— Vous avez dit quatre-vingt-onze ! s’écria le cardinal stupéfait.
— Oui, monseigneur : 3 mai 1652, répondit la marquise de Flavacourt.
— Je suis votre aîné d’un mois, marquise, dit le comte de Beaupré : 3 avril 1652.
— Et moi d’un an, dit le bon abbé d’Enneville : 27 juin 1651.
— Et moi, dit en chevrotant une petite vieille toute ridée, il y a soixante-deux ans que je suis veuve, et, quand j’eus le malheur de perdre M. le marquis d’Anglure, il y en avait trente-quatre que j’étais de ce monde.
— Soixante-deux et trente-quatre font quatre-vingt-seize ! dit le cardinal ébahi. Quoi ! marquise, quatre-vingt-seize ans ?
— Hélas!….. répondit simplement madame d’Anglure.
Le comte de Gensac avait quatre-vingt-quatorze ans ; le marquis de Nogaret quatre-vingt-quinze; le marquis de La Faye, quatre-vingt-seize; le comte de Saint-Mesme et la comtesse de Combreux, quatre-vingt-dix-sept !
— Comment ! s’écria l’Éminence au comble de la stupéfaction, c’est moi qui dois tirer le gâteau comme étant le plus jeune ! Est-ce hasard ou gageure ?
Mais à ce moment il aperçut en face de lui le visage rayonnant de son valet de chambre. Le cardinal comprit, tira le gâteau comme un petit enfant de quatre-vingt-dix ans qu’il était, et fut si enchanté de cette flatterie délicate qu’il s’en souvint dans son testament.
On tirait aussi la fève chez les encyclopédistes, particulièrement aux fameux soupers du baron d’Holbach, que Galiani avait surnommé le Maître d’hôtel de la philosophie. Par un hasard qui avait sans doute des complices, Diderot, il l’a raconté lui-même, y fut roi trois années de suite. « La première année, dit-il, je publiai mes lois sous le nom de Code Denis. »
Au frontispice de mon Code,
Il est écrit : « Sois heureux à ta mode,
Car tel est notre bon plaisir. »
Fait l’an septante et mil sept cent
Au petit Carrousel, en la cour de Marsan,
Assis près d’une femme aimable,
Le cœur nu sur la main, les coudes sur la table,
Signé Denis, sans terre ni château.
Roi par la grâce du gâteau.
« La seconde, je me déchaînai contre l’injustice du destin qui déposait encore la couronne sur la tête la moins digne de la porter. La troisième, j’abdiquai et j’en dis les raisons dans ce dithyrambe. » Le dithyrambe en question, intitulé les Eleuthéromanes ou les Furieux de la liberté, contient les deux fameux vers si souvent cités d’une façon plus ou moins inexacte :
Et ses mains ourdiraient les entraxes du prêtre,
Au défaut d’un cordon, pour étrangler les rois.
On a fait observer, à la décharge de Diderot, que ces vers se trouvent dans un badinage poétique composé pour une réunion frivole. Il faut avouer du moins qu’ils badinent d’une façon singulièrement féroce et que, si la circonstance pour laquelle ils furent composés est puérile, la virulence du passage dont ils sont extraits était bien propre à les faire prendre au sérieux.
L’année 1741 fut une époque néfaste dans les annales du gâteau des rois. Une de ces disettes que ramenait si fréquemment, au dix-huitième siècle, l’organisation mal entendue de l’administration publique, avait régné toute l’année précédente, si bien que le Parlement n’imagina rien de mieux pour y remédier que de prendre, dans le courant du mois de décembre, un arrêt qui interdisait la fabrication de la galette des rois.
Le gâteau de l’Épiphanie a survécu à la ruine de bien des vieilles coutumes populaires. La Révolution, pourtant, avait voulu naturellement abolir cette inoffensive solennité, aussi bien que les étrennes, et elle avait poursuivi les rois jusqu’autour de la table de famille, comme jusque dans les tragédies et les jeux de cartes. Les Révolutions de Paris (n° 131) se lamentaient de voir que, malgré la révolution, cet usage aristocratique persistât encore en 1792, surtout dans les collèges et les maisons particulières d’éducation. Dans la séance de la Convention du 30 décembre 92, Manuel monta à la tribune, et proposa « un décret et très court qui ne peut pas souffrir de difficulté. Je demande que la Convention décrète qu’aucun ministre, de quelque culte que ce soit, ne pourra célébrer des fêtes sous le nom de fête des Rois. Ces fêtes sont anti-civiques et contre-révolutionnaires ». Sur l’observation d’un membre, qu’il ne s’agissait pas là de rois de France, et malgré l’insistance de Manuel, la Convention eut le bon sens de passer à l’ordre du jour1Réimpression de l’Ancien Moniteur, t. XV, p. 4.. Mais la Commune, qui s’appliquait à n’être dépassée par personne dans son zèle républicain, se montra plus farouche envers la fête des rois :
« Nos législateurs, écrivait Prudhomme l’année suivante, dans le n° 182 des Révolutions de Paris, passèrent à l’ordre du jour, et firent bien. Ceci n’est pas de leur ressort : c’est notre affaire à nous autres citoyens. Si nous sommes aussi bons républicains que nous nous le disons, nous laisserons les prêtres morfondus psalmodier tout seuls sur leurs tréteaux sacrés, des hymnes en l’honneur des trois rois. Nous bannirons à jamais ce mot et les idées qu’il rappelle de nos repas de famille. Nous abolirons la royauté de la fève, comme nous avons fait de l’autre, et nous lui substituerons le gâteau de l’égalité, en remplaçant la solennité de l’Épiphanie par une fête du bon voisinage ; la fève servirait à marquer celui des voisins chez lequel se ferait le banquet fraternel où chacun apporterait son plat, à l’exemple de nos bons aïeux.
« Un arrêté de la Commune change le jour des rois en fête des sans-culottes. À la bonne heure ! mais cela ne suffit pas. Cette innovation est trop vague. Il faut, quand on veut détruire un vieil usage, le remplacer par un autre bien circonstancié, afin que l’attrait de la nouveauté serve de recommandation à la sagesse du motif. »
Ainsi s’exprime le philosophe Prudhomme. Bref, on ne vint pas à bout de détruire une vieille et charmante fête qui ressuscita d’elle-même après la Terreur. Mais aujourd’hui »elle se passe tout entière dans l’intérieur de la famille, et les rues de Paris n’en ont gardé aucun vestige.
Victor Fournel, Les Rues du Vieux Paris. Galerie Populaire et Pittoresque. Paris, 1879.
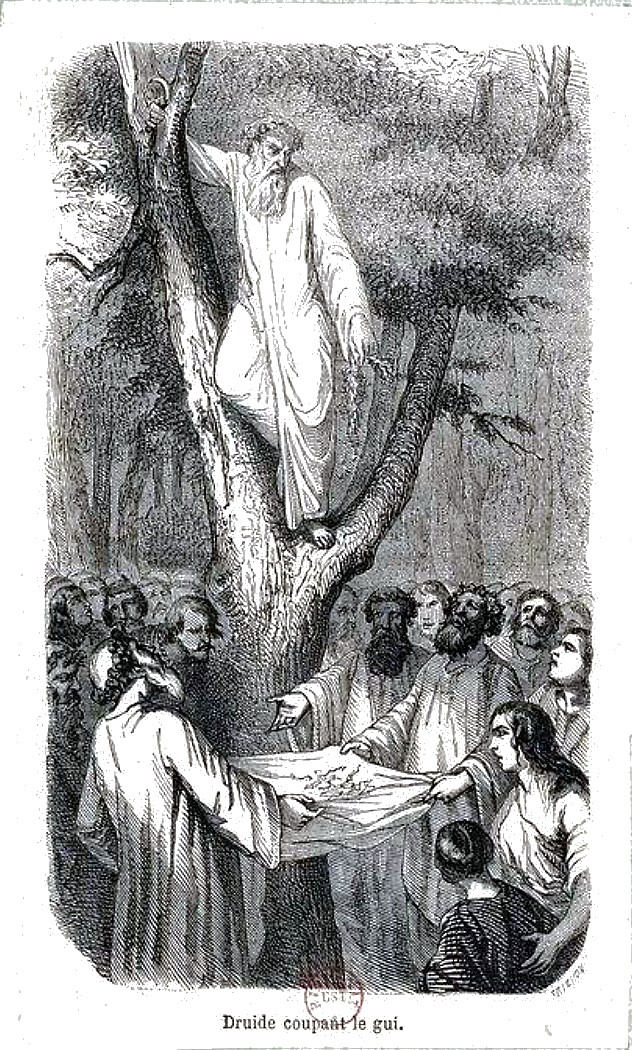

 Lors du colloque «
Lors du colloque « 

