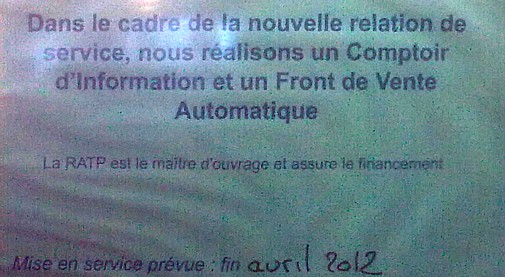Argument
Lors d’un discours prononcé en 2007 à SévilleRégis Debray : Un mythe contemporain : le dialogue des civilisations. CNRS Éditions, 2007. dans le cadre du deuxième Atelier culturel, Régis Debray s’était ainsi exprimé :
1/ Une technique ancienne ou nouvelle est universalisable, non une culture. La norme standard unifie selon le plus petit commun dénominateur. […]
2/ La technique est le lieu du progrès, avec des cliquets d’irréversibilité (de non retour en arrière), mais qui n’ont pas cours dans le temps culturel. (…) L’histoire culturelle n’est pas fléchée vers l’avant.
En d’autres termes, nous habitons une culture, non une technique. Nous habitons une langue, mais nous nous servons d’un Mac. Internet structure le monde comme un réseau, c’est un fait. Mais structurer le réseau comme un monde, c’est une tout autre affaire. Un monde, je veux dire une mémoire partagée, un territoire, une langue commune.
On est alors en droit de se demander si le titre de cette table ronde n’est pas paradoxal : la bibliothèque n’est-elle pas le lieu où se conserve depuis des siècles et se transmet au quotidien la culture et le savoir, tandis que ce fameux (ou fumeux ?) « nuage » celui ou se transmettent des messages et des informations instantanés et où se conservent avec bien peu d’assurances réelles sur leur pérennité un succédané des artefacts culturels ?
Et, culturellement parlant, est-ce que ces succédanés peuvent se substituer à l’original ? Cela semblerait être le cas pour le livre – si l’on fait abstraction de sa matérialité, pourtant si importante – mais est-ce que la visite d’un musée virtuel se substitue à celle du musée réel, la visualisation à l’écran de l’Hercule Farnèse ou du Songe de sainte Ursule de Carpaccio à sa contemplation in situ ? Qu’augure donc la formule selon laquelle « ce qui n’existe pas dans l’Internet n’existe pas » ?
Ce qui pose immédiatement une autre question, celle du lieu. Ce mot dénote une « portion déterminée de l’espace » (selon le TLFi) physique, et en l’espèce celle où des gens viennent pour y passer un temps plus ou moins long à effectuer, en silence ou dans le dialogue, une certaine activité, individuellement ou en groupe ; pour reprendre la formulation d’un des panneaux de l’exposition Architecture des bibliothèques ailleurs dans le Salon : « La bibliothèque est conçue de façon à ce que chacun puisse trouver sa place au sein d’un équipement qui tend à la fois à favoriser l’intimité, le recueillement, le partage des savoirs et l’expérience de la culture », ce qui rejoint, en partie du moins, l’idée de la bibliothèque comme « troisième lieu ». L’Internet en tant que technique n’est pas, en ce sens, un lieu, mais certains des termes utilisés pour en décrire des fonctionnalités et donc des usages visent à le suggérer métaphoriquement : site, nuage… Que signifie alors l’oxymore « lieu dématérialisé », et donc « culture numérique » ? Et si, toujours selon Régis Debray, la culture, « forge de l’identité », émerge de, et nécessite, une mémoire partagée, un territoire, une langue commune, « culture numérique » serait-il un autre oxymore ?
Une troisième question est celle de ce que dénote le terme bibliothèque. Un lieu physique où l’on trouve des objets matériels, des livres – mais aussi et de façon croissante d’autres objets pour certains autrefois disponibles dans d’autres types de lieux (musées, archives, phonothèques…) – ou un espace totalement virtualisé, celui qu’on appelait encore récemment bibliothèque numérique et qui, à l’instar d’Europeana, tend à se débarrasser du mot bibliothèque ? Un lieu de « lecture publique » dans l’acception plus générale du terme, ou celui où l’on doit effectuer une transaction commerciale pour accéder aux objets qui s’y trouvent, ce qu’on appelle encore librairie (en passant, on notera que ce mot désignait autrefois une bibliothèque) ?
En d’autres termes, c’est d’abord la problématique des recouvrements croissants des rôles traditionnellement distincts de ces organismes – archives, bibliothèques, musées, librairies, maisons d’édition – qui se pose : la bibliothèque numérique (souvent émanation d’une ou de plusieurs bibliothèques physiques, à l’instar de Gallica ou de Hathi Trust) propose l’achat de livres imprimés à la demande ou l’accès payant à des ouvrages sous droit voire à sa production muséographique et éditoriale propre, tandis que les éditeurs mettent en ligne des bibliothèques numériques et certaines grandes librairies sont utilisées comme des bibliothèques par un public qui ne peut ou ne veut en acheter les livres ; la bibliothèque physique conserve, matériellement depuis longtemps et numériquement maintenant, des fonds d’archives, voire même l’archive (numérique) du numérique (le Web) – et l’on rappellera la fusion au Canada, en 2004, des archives nationales et de la bibliothèque nationale.
Ensuite, c’est celle de la propriété de ces objets numériques – et donc du contrôle à leur accès – qui est en jeu : est-ce que la personne ou l’organisme qui a numérisé un ouvrage tombé dans le domaine public ou photographié un tableau ancien ou une statue classique a le droit d’en limiter ou d’en commercialiser la lecture ou la vision (ce qu’on appelle le droit de représentation, en terme de propriété intellectuelle) ? On pense bien évidemment à ces accords, secrets ou non, signés entre des bibliothèques publiques et des opérateurs de l’internet concernant la numérisation et la mise en ligne restrictive de leur patrimoine.
Ce qui nous amène finalement aux acteurs de cette comédie humaine (on notera en passant que le mot acteur dénotait au XIIIe siècle l’auteur d’un livre). Celui qu’on a en général tendance à oublier est justement cet « opérateur de l’internet », d’abord les telcos puis les grands moteurs de recherche : là aussi le recouvrement croissant des rôles est significatif, dans cette course au contrôle de l’utilisation des « tuyaux », puis des contenus et maintenant des services, et donc des usagers, producteurs et consommateurs de ces contenus, dans une vision purement économique, par une combinaison d’innovation et d’obsolescence destinée à capter l’utilisateur et à le fidéliser (ou le lier dans une technique particulière et totalisante).
Qui sont ces acteurs ? En l’espèce et schématiquement, l’auteur et le lecteur, le compositeur et l’auditeur, le metteur en scène et le spectateur, aux deux bouts, et les médiateurs – l’éditeur, le libraire, le bibliothécaire, le conservateur, l’acteur, l’interprète ou le chef d’orchestre, le journaliste et le critique littéraire et artistique – entre les deux. Cette chaîne est bouleversée de façon significative par le numérique et les réseaux ; l’autopublication, qu’elle soit de textes, d’images fixes ou animées, ou de musique écrite ou enregistrée – court-circuite le processus éditorial, et l’écriture directement numérique permet à l’auteur ou au compositeur de modifier en permanence son œuvre, à tout lecteur ou auditeur de s’approprier des bribes de contenus et, à l’instar des collages du début du siècle passé ou des disc jockeys plus récents, de produire une nouvelle œuvre plus ou moins originale ; les bibliothèques numériques des éditeurs font l’impasse sur les bibliothèques et les librairies ; les blogs et les réseaux sociaux instaurent des espaces (virtuels) de discussion et de recommandation qui produisent par exemple bien plus de critiques, pour certaines excellentes et très suivies, qu’un magazine spécialisé. Toutes ces mutations suscitent l’émergence de nouveaux modes d’écriture – et donc de lecture – voire de nouvelles langues, et donc de ce qui est indéniablement de la culture.
Ces « circuits d’évitements » posent spécifiquement la question de l’« amateur et du savant », et plus généralement celle de l’accès direct de personne à contenu ou de personne à personne, sans médiateurs, que suscitent, voire qu’imposent, ces technologies. Comme l’écrivait Michel Guérin dans un très bel article« Après la modernité. Hommage à Giorgio Agamben et Gianni Vattimo », La Bibliothèque de Midi n° 3. Actes Sud, 2000. consacré à Giorgio Agamben et Gianni Vattimo :
La postmodernité montre deux visages : la menace et la bonace. Par un aspect, elle défait, délocalise, déracine, sape les liens traditionnels ; par un autre, elle comble le désir, au-delà même de ce qu’il aurait pu souhaiter. Ce qu’elle n’autorise plus, c’est l’intermédiaire, qui est à la fois l’essence de l’Eros platonicien et celle de l’autorité protectrice, tutélaire, de la loi qui, jusqu’ici, défendait dans la double acception du mot.
Du culturel on en arrive donc au politique et au sens de la liberté : on imagine mal le fonctionnement une société humaine dans la cité sans intermédiaires et sans lois autres que celles imposées par les moyens techniques régissant les échanges virtuels. L’Internet espace de liberté et moteur de la libération des opprimés ? On a vu ce que ces révolutions peuvent donner in fine et in real life (mais ce n’est pas forcément spécifique au numérique : il est rare que les révolutions sombrent dans la paix civile…).

Pour tenter d’effleurer ce questionnement sans prétendre à une « redéfinition de la cultureSous-titre de Dans le Château de Barbe Bleue de George Steiner. », je propose d’aborder cette table ronde sous quatre angles et quelques questions :
- les lieux : qu’est-ce qu’un lieu numérique, et comment peut-il s’articuler avec l’espace physique de la bibliothèque ? qu’est-ce que le lecteur y trouvera pour ne pas déserter l’un au profit unique de l’autre ?
- les documents : que devient la politique d’acquisition de la bibliothèque, autant pour ses fonds physiques que numériques, avec une disponibilité et une ubiquité croissantes des livres numériques ? quid de la notion de classement par spécialistes et de la subjectivité face aux technologies de taggage social, d’indexation sémantique automatique et de techniques statistiques ? à qui ces documents appartiennent-ils ?
- les lecteurs : que deviennent la lecture publique et l’accès gratuit au livre dans le nuage ? quel rôle pour la bibliothèque et ses médiateurs dans les réseaux sociaux de lecteur-lecteur ? comment se construit une pensée commune, une culture ?
- les institutions : comment éviter que leurs rôles se réduisent à celui d’un prestataire technologique chargé de numériser, de conserver et de mettre en ligne, librement ou commercialement ? y a-t-il des rapprochements (de moyens, de méthodes, de structures) à effectuer ?
La tête dans les nuages donc. Mais aussi les pieds sur terre ?
Participants
Alban Cerisier, chartiste et archiviste-paléographe, est secrétaire général des Éditions Gallimard, où il est chargé entre autres du développement numérique du groupe. Gallimard s’est engagé dans la numérisation rétrospective de son fonds patrimonial, et sur la consultation en ligne payante d’une partie de ce patrimoine et des nouveautés. Il est président de la commission numérique du SNE (syndicat national de l’édition). Il est récemment intervenu dans les travaux de la commission du sénat Liberté de l’Internet et rémunération des créateurs.
Milad Doueihi est professeur, historien des religions et titulaire de la Chaire de recherche sur les cultures numériques à l’Université Laval de Québec. Il est l’auteur d’ouvrages en français et en anglais consacrés à ce thème (La grande conversion numérique en 2009, Digital Cultures et Pour un humanisme numérique en 2011).
Bruno Racine est président de la bibliothèque nationale de France, engagée depuis plus de quinze ans dans le développement de sa bibliothèque numérique Gallica, et, plus récemment, de services numériques tels que des ouvrages mixtes (papier avec FlashCodes), le site Data.bnf.fr (sur les auteurs et leurs œuvres), des applications pour smart phones (tels les miniatures flamandes), et bientôt sur iTunes U. Bruno Racine préside aussi la CENL (conférence des bibliothèques nationales européennes) et la fondation Europeana.
Michel Fingerhut, animateur de la table ronde, est consultant dans les domaines de la conservation et la valorisation numériques de patrimoine culturel. Il a conçu et dirige le développement du Portail de la musique contemporaine, aggrégateur de plus d’une trentaine de partenaires et fournisseur de contenus à Europeana, projet auquel il participe également dans le cadre de la conception du modèle de métadonnées sous-jacent. Il a dirigé la médiathèque de l’Ircam, qu’il avait créée en 1996, jusqu’en 2011.