 Dans un récent article lumineux, Nicholas G. Carr1 analyse les valeurs New Age que le Web nouvelle génération – celui de l’« intelligence collective » symbolisée par Wikipedia et les blogs – représente : « participation, collectivisme, communautés virtuelles, amateurisme », avec, comme corrélats, « superficialité, préférence des humeurs aux faits, écholalie, encouragement à l’extrémisme idéologique et au communautarisme ». Prenant comme cas d’espèce le manque de qualité et de fiabilité de la Wikipedia2 (qu’il analyse avec exemples à l’appui), il en conclut que l’Internet bouscule l’économie de la culture d’une façon qui en réduira les options plutôt que les élargira : le choix est clair, entre (par exemple) l’Encyclopédie Britannica et la Wikipedia, on choisira ce qui est gratuit, et ce qui s’y trouve sera répliqué à l’infini sur le Web, quel que soit sa qualité. En réponse à Kevin Kelly, qui affirme qu’« à cause de la facilité de création et de diffusion, la culture en ligne est la culture », il dit : « J’espère qu’il a tort, mais je crains qu’il ait raison ».
Dans un récent article lumineux, Nicholas G. Carr1 analyse les valeurs New Age que le Web nouvelle génération – celui de l’« intelligence collective » symbolisée par Wikipedia et les blogs – représente : « participation, collectivisme, communautés virtuelles, amateurisme », avec, comme corrélats, « superficialité, préférence des humeurs aux faits, écholalie, encouragement à l’extrémisme idéologique et au communautarisme ». Prenant comme cas d’espèce le manque de qualité et de fiabilité de la Wikipedia2 (qu’il analyse avec exemples à l’appui), il en conclut que l’Internet bouscule l’économie de la culture d’une façon qui en réduira les options plutôt que les élargira : le choix est clair, entre (par exemple) l’Encyclopédie Britannica et la Wikipedia, on choisira ce qui est gratuit, et ce qui s’y trouve sera répliqué à l’infini sur le Web, quel que soit sa qualité. En réponse à Kevin Kelly, qui affirme qu’« à cause de la facilité de création et de diffusion, la culture en ligne est la culture », il dit : « J’espère qu’il a tort, mais je crains qu’il ait raison ».
Il semblerait que même au sein de la Wikipedia on commence à avoir des doutes. Dans un autre article, Andrew Orlowski rapporte que Jimmy Wales, l’un des co-fondateurs, reconnaît finalement l’existence de problèmes réels de qualité. Orlowski soulève d’autres problèmes au-delà de la fiabilité, ceux, par exemple, de grammaire et de syntaxe de nombreux articles. La solution à ce problème particulier ? Des experts – de l’édition, des contenus – ce qui la ferait converger vers les « vraies » encyclopédies actuelles. Mais l’idéologie des contributeurs (en sus du problème économique) pourrait être un frein insurmontable.
Sous-jacent à ces articles est le constat que le Web est passé de l’utopie à la « vraie vie », et elle n’est pas si rose que cela. Philippe Breton l’avait déjà clairement décrit3 pour d’autres médias. C’est aussi ce qu’a affirmé Claude Perdriel, PDF du Groupe Nouvel Observateur, dans la leçon inaugurale qu’il a donnée mardi 18 aux élèves du Centre de formation des journalistes (CFJ) : « Internet est le plus grand danger pour l’éthique et la défense de ce à quoi nous croyons. [... N]’importe qui peut créer des sites, diffuser des rumeurs. Quand les gens de Google disent « Nous sommes le premier média au monde », personne n’a parlé des règles professionnelles de Google. ».4 Ni de celles de la Wikipedia, d’ailleurs.
Dans un très bel article consacré à Giorgio Agamben et Gianni Vattimo5, Michel Guérin s’interroge sur la « mondialisation » (ses guillemets) :
La postmodernité montre deux visages : la menace et la bonace. Par un aspect, elle défait, délocalise, déracine, sape les liens traditionnels ; par un autre, elle comble le désir, au-delà même de ce qu’il aurait pu souhaiter. Ce qu’elle n’autorise plus, c’est l’intermédiaire, qui est à la fois l’essence de l’Eros platonicien et celle de l’autorité protectrice, tutélaire, de la loi qui, jusqu’ici, défendait dans la double acception du mot.
Ce texte s’achève sur un questionnement, destiné à éviter, d’une part, « la vitupération d’une époque mal bâtie, la nôtre » en sombrant dans « passéisme et nostalgie ennemis d’une pensée dont la tâche est toujours le présent », et, d’autre part, « l’anti-humanisme et le cynisme déclarés ». Sans le repère de la croyance au progrès, « Comment trouver notre voie propre entre un sens qui nous fuit en nous faisant courir le risque de l’irréalité et le virtuel qui nous cerne en menaçant d’occuper le lieu de la réalité ? »
1 Auteur, entre autres, de Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business School Press, 2004. ISBN: 1591394449.
2 Cette critique n’est pas récente (voir, par exemple, l’article de Hiawatha Bray de juillet 2004 [dont j’avais parlé il y a un an]). Ce qui est frappant, c’est, qu’avec le temps — la Wikipedia existe depuis plusieurs années — ces problèmes s’aggravent au lieu de se résoudre. Une preuve de plus s’il en fallait que la technologie ne fait que fournir des cadres à l’activité humaine et ne peut garantir une quelconque qualité des résultats.
3 Voir, par exemple, cet entretien dans lequel il décrivait il y a une dizaine d’années déjà l’homo communicans comme prototype du manipulateur, la recherche du plus petit commun dénominateur, l’enfermement dans le « village planétaire » qu’est l’Internet, etc.
4 Cité dans Le Monde du 20 octobre 2005.
5 « Après la modernité. Hommage à Giorgio Agamben et Gianni Vattimo », La Bibliothèque de Midi.

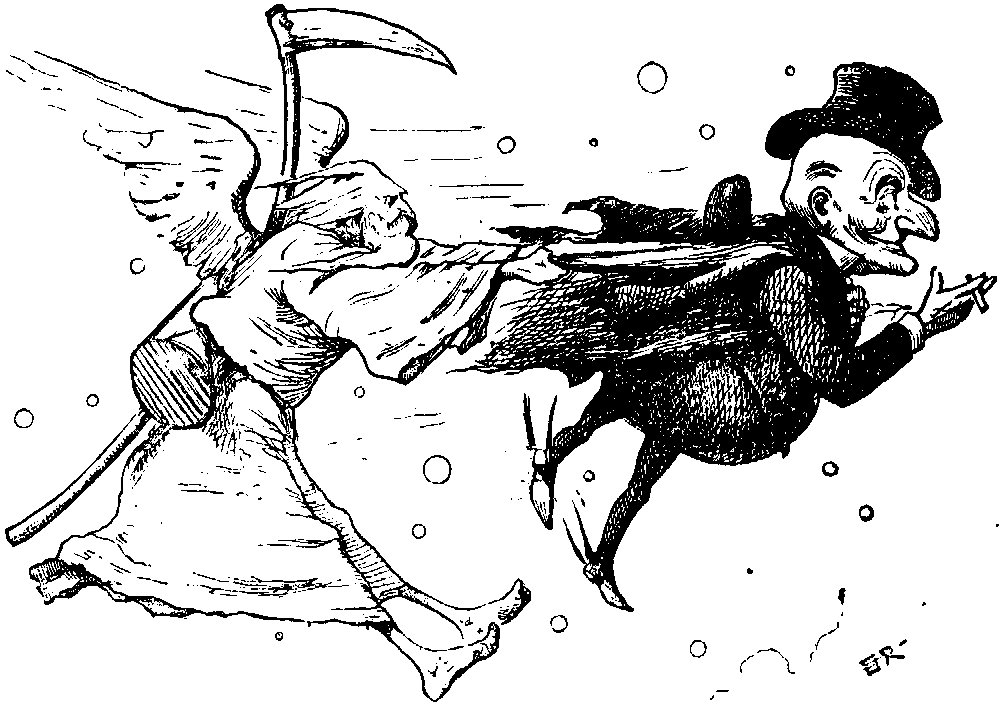
 Dans un récent
Dans un récent 