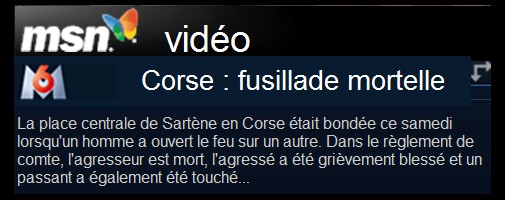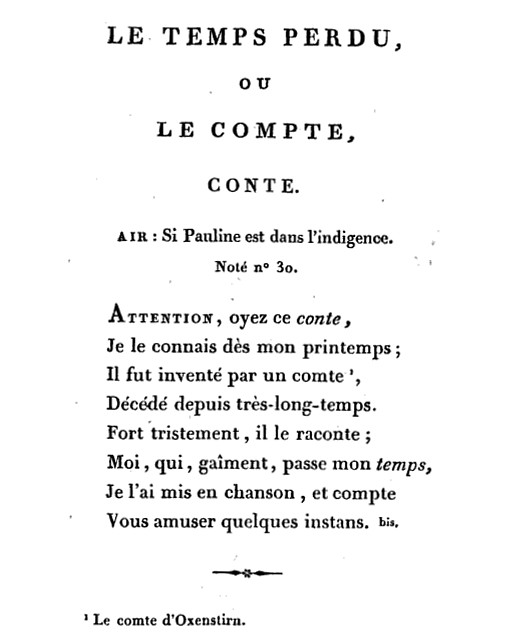« Pendant la guerre de 1939-1972, il y avait à Montmartre, à la porte d’une épicerie de la rue Caulaincourt, une queue de quatorze personnes. » — Marcel Aymé, « En attendant », in Le Passe-muraille.
Akbar se prépare à partir à Moscou. Ce n’est pas la première fois : Jeff et lui avaient rendu visite (malgré eux) aux cendres de Lénine, mais cette fois-ci il y va pour parler musique devant un parterre international. Il ne suffit pas de se préparer la gorge (un bon Гоголь-моголь – lait de poule alcoolisé, pour ceux qui n’auraient lu Guerre et Paix dans le texte – au lever ou au coucher, voire aux deux, dans le mois qui précède le voyage, peut y contribuer), il lui faut amasser une quantité imposante de documents afin de se faire délivrer un visa :
• le formulaire de demande, qu’il télécharge du site du consulat en question, et qu’il doit remplir sans coup férir et au bic noir (avant, c’était le rouge) ;
• une photo récente, où il est impératif de ne pas sourire (difficile : c’est contraire à la nature d’Akbar) ni d’ouvrir la bouche, de regarder le photographe droit dans les yeux après avoir ôté ses lunettes de soleil (Jaruzelski faisait comment ?) et toute autre prothèse faciale (et, par prudence, ailleurs dans le corps), la photo devant être collée (et non agrafée ou scotchée) dans le cadre précis réservé à cette intention dans le formulaire de demande ;
• une photocopie de son passeport, certifiée par un tribunal de grande instance ou, à défaut, par un notaire russe blanc, et accompagnée de l’original ;
• une attestation d’une compagnie d’assurance ayant un contrat de réassurance avec un partenaire russe, qui mentionne un numéro de contrat (au minimum de dix-huit chiffres et lettres, comme chez Julien Lepers) et qui certifie qu’elle rapatriera à ses propres frais le corps du détenteur de la police, au cas où il tomberait dans une embuscade tchétchène ou bas-karabaghoise ;
• une lettre d’invitation en bonne et due forme d’un Ministère ou d’un orrrrrrganisme rrrrrrusse, qui indique, entre autres, le nom d’Akbar (Akbar), sa date de naissance (il ne fait pas son âge), son sexe (avec un tel nom, la question ne devrait pas se poser), sa nationalité (il ne s’en cache pas), son poids (pour l’avion), la liste de ses diplômes depuis l’école maternelle (les bons points ne comptent pas), son salaire (pour être sûr qu’il pourra se débrouiller seul), le nom et l’adresse de sa salle de sport (il ne pourra pas y aller pendant son voyage, alors pourquoi ?), et d’autres petits détails destinés à permettre aux autorités de le profiler.
S’armant de courage, de patience et des papiers en question (à l’exception de la lettre d’invitation, envoyée directement au consulat), Akbar arrive à 8h15 devant l’officine de la Loubianka à Paris, et se place dans la file d’attente qui compte déjà 30 personnes. À 9h, les grilles s’entrouvrent et laissent entrer, au compte-gouttes, 60 personnes qui se trouvent maintenant devant Akbar : les 30 arrivées en ordre, et 30 autres munies d’un coupe-file vert. Maigre consolation : derrière lui, il y a bien 60 personnes aussi.
C’est vers 9h45 qu’il franchira le seuil, mais pas avant qu’un préposé, grand blond genre espion soviétique dans un film de 007 ne connaissant qu’un mot de français (« marge ») ait enjoint à tous ceux qui avait rempli le formulaire de demande de visa fourni par le site de le refaire, parce que la marge (c’est le mot en question) n’est pas bonne. Les habitués du fait sont équipés d’un stylo (noir) et d’un tube de colle (pour la photo).
À l’intérieur, ce n’est pas une seule file d’attente, mais trois, dont une se subdivise en trois sous-queues, qui se présentent au regard. Il faut choisir la bonne. À 10h15, Akbar atteint un guichet. Ludmila (appelons-la ainsi), une jeune et blonde préposée, suit les préconisations pour la prise de photos d’identité : elle ne sourit pas, fixe Akbar d’un regard perçant, et laisse filtrer d’entre ses lèvres le minimum de mots suffisant à rejeter sa demande : la photo d’Akbar ne lui plaît pas, bien qu’il ait veillé à garder ses lèvres scellées à l’horizontale et à fixer l’objectif sans ciller : la longueur actuelle de ses cheveux n’est pas identique à celle sur l’instantané. Il s’excuse de n’avoir pu synchroniser coiffeur, photographe et consulat, mais cela n’amadoue pas Ludmila ; pire, elle ne trouve pas l’invitation dans son ordinateur, ne voulant la chercher que par la date de naissance d’Akbar, et surtout pas par son nom. Rrrrrrrrevenez avec invitation, susurre-t-elle, puis fixe son regard froid sur la personne suivante.
Akbar s’en retourne chez lui. Il écrit à l’orrrrrrganisme qui lui envoie le lendemain une copie de l’invitation. Il la rajoute à la pile, met son réveil aux aurores, et se pointe à 7h15, le jour suivant, devant les grilles. Il n’y a que six personnes qui l’y ont précédé. Une pluie fine ne cesse de tomber et de s’infiltrer dans les os malgré les parapluies déployés. On se serre les coudes devant l’adversité et l’on partage son expérience, à l’instar des quatorze personnages de la belle et triste nouvelle de Marcel Aymé. Akbar n’est pas le seul à revenir : sa voisine, habituée du lieu – elle a son chéri à Moscou – doit, tous les deux mois, se soumettre à ce rituel sans être assurée d’un résultat positif du premier coup. Elle les hait et préconise la révolution.
Est-ce cet arrosage qui fait croître rapidement la file d’attente ? quoi qu’il en soit, elle ne cesse de doubler de longueur et compte bien plus d’une centaine de personnes à l’ouverture. Il n’y a que quatorze coupes-file qui se présentent avant Akbar, et il arrive à franchir le rideau de fer à 9h15, et à atteindre un guichet – il évite celui de Ludmila – à 9h30. Le préposé, un jeune homme blond (ils le sont tous) et souriant (il n’a pas dû lire les instructions) l’accueille poliment, et examine la pile. Il scrute longuement l’invitation, puis lance : « c’est lettrrrre de grrrrand-mère de la campagne ». Interloqué, Akbar dit « Pardon ? » et Ivan (appelons-le Ivan) lui explique en souriant que lettrrrre pas d’entête, pas d’adrrrresse, pas numérrrro fax, pas de tampon, pas date naissance Akbarrrr. Ivan va devoir demander à son supérieur. Il pose le dossier de côté et Akbar attend.
À 10h, Ivan lui fait signe en souriant. Akbar revient, et s’entend expliquer que lettrrrre pas valable, et que, d’ailleurs, dans le formulaire de demande de visa, l’objet du voyage qu’il faut préciser n’est pas « conférence » mais « liens culturels », et qu’en conséquence le motif de demande de visa qui doit être mentionné est « humanitaire » (allo ? Kouchner ?), parce que c’est de la musique (si Ivan savait de laquelle il s’agit, il réviserait peut-être son opinion…) ; qu’il ne faut pas mettre le nom de l’organisme qui invite, parce qu’on ne sait pas qui sera le signataire de l’invitation. Et qu’en clair, conclut-il en souriant – Akbar comprend maintenant ce que « sourire maléfique » veut dire, et que sa regrettée mère avait raison quand elle lui disait, enfant, qu’il ne faut pas faire confiance à un monsieur qui sourit – il lui faudra rrrrevenir.
Akbar décide sur le champ qu’il ne reviendrrrra pas. Heaven can wait.
Jeff et Akbar sont les personnages d’une série de bandes dessinées de Matt Groening, qui est aussi le père de la fameuse – et infâme – famille Simpson.