Odessa, Odessa

Nommé en 1803 gouverneur d’Odessa par le tsar Alexandre I, Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, qui s’était réfugié en Russie après la Révolution française, transforma ce qui était alors un misérable village de pêcheurs en une ville fière, jusqu’à son retour en France en 1814.
Ma mère me parlait avec nostalgie de la maison où elle était née et avait grandie, située sur la Richelievskaya (au centre de laquelle se trouve le célèbre Opéra), de l’odeur des lilas, le printemps, dans la grande cour…
Grande ville portuaire créée par un français, elle y voit arriver, au fil du temps, des armateurs grecs, des marchands juifs et arméniens, des vignerons tatars, des propriétaires polonais qui en font une capitale cosmopolite haute en couleur… Pouchkine y sera exilé par le Tsar : c’est là qu’il écrit son chef-d’œuvre, le poème Eugène Oneguine et devient l’amant de la femme du Comte Vorontsov, gouveneur de Nouvelle-Russie. Plus tard, la ville accueillera de nombreux Juifs venus s’y réfugier pour tenter d’échapper à leur misère terrible dans la « zone d’établissement » au nord-est d’Odessa, où ils étaient contraints de résider depuis 1791.
Isaac Babel, né à Odessa en en 1894 (et disparu dans les geôles russes en 1939 sur une injuste dénonciation), décrit dans ses contes1 (très bien traduits en français dans la collection de poche Folio) le petit monde juif d’Odessa : ouvriers, marchands, jeunes et vieux, riches et pauvres, avec un regard lucide et attendri, teinté d’humour et parfois d’ironie, avec un sens de la description qu’on compare souvent à celui de Maupassant. Écoutons-le :
Cette ville réunit, avant tout, les conditions purement matérielles nécessaires à l’éclosion d’un talent comme celui de Maupassant. L’été, on y voit briller au soleil, dans les bains de mer, les formes de bronze musclées des jeunes sportifs, les corps vigoureux des pêcheurs qui ne font pas de sport, les corpulences grasses, ventripotentes et débonnaires des négociants, et, boutonneux et maigres, les rêveurs, inventeurs et courtiers. Et non loin de la vaste mer, les fabriques fument et Karl Marx fait sa besogne habituelle.
À Odessa, il y a ghetto juif très pauvre, très populeux et très malheureux, une bourgeoisie très imbue d’elle-même, et un conseil municipal ultra-réactionnaire.
À Odessa, il y a des soirs de printemps doux et alanguissants, la senteur épicée des acacias et la lune qui répand au-dessus de la mer sa lumière égale et irresistible.
À Odessa, le soir, dans leurs villas ridicules et vulgaires, des bourgeois gros et ridicules sont couchés en chaussettes blanches sur des canapés sous le ciel de velours sombre, et digèrent leur copieux dîner, tandis que, derrière les buissons, leurs épouses poudrées, empâtées par l’oisiveté et naïvement sanglées dans leur corset, sont ardemment enlacées par de fougueux étudiants en médecine et en droit.
À Odessa, les bons à rien qu’on appelle en yiddish des Luftmenschen, des « hommes de vent », rôdent autour des cafés pour essayer de gagner un rouble et nourrir leur famille, mais ils n’ont pas l’occasion de se faire un rouble, et d’ailleurs à quoi bon laisser un « homme de vent » gagner un peu d’argent ?
À Odessa, il y a un port, et dans ce port des bateaux venus de Newcastle, de Cardiff, de Marseille et de Port-Saïd, il y a des Nègres, des Anglais, des Français et des Américains. Odessa a connu une ère de prospérité, elle connaît une période de déclin, un déclin poétique, un tantinet insouciant et très désemparé.
« Odessa, dira en fin de compte le lecteur, Odessa est une ville comme les autres, et vous êtres d’une partialité excessive. »
C’est vrai, je suis en effet partial, et peut-être le suis-je sciemment, mais parole d’honneur, cette ville a quelque chose. Et ce quelque chose, tout homme digne de ce nom le percevra et il dira que la vie est triste, monotone, – ce qui est exact, mais que néanmoins, quand même et malgré tout, elle est extraordinairement, vraiment extraordinairement intéressante.
C’est de ce quelque chose dont parle le très beau film documentaire Odessa, Odessa2 – ou plutôt de souvenirs de ce quelque chose qui n’existe plus, qui s’est transformé en mythe d’un paradis dont on a été expulsé – , c’est d’une nostalgie dans le cœur de ceux qui l’ont connu, qui auraient aimé y revenir, mais on ne remonte pas le temps. C’est un film sur la génération de l’exil, celle qui aura quitté un lieu ou un temps et ne sera jamais arrivée ailleurs, arpentant le Boulevard of broken dreams, celle que la Bible appellait « génération du désert », ceux qui sont sorti d’égypte mais qui ne devront pas entrer en Terre promise.
Il y a tout d’abord les souvenirs couleur sépia de la poignée de Juifs très âgés qui vivent encore dans ce quartier d’Odessa maintenant déserté, aux rues vides et silencieuses, aux bâtiments lézardés ou en partie effondrés, aux cours remplies de cadavres de voitures, aux appartements bourrés de vieilleries ne laissant parfois que peu de place pour se déplacer et pourtant donnant le sentiment d’un nid rassurant, au centre duquel trône tout de même un samovar. Entre le yiddish et le russe, ils se chantent d’une voix chevrotante des airs d’antan, entament une danse avec un pas chancelant, se demandent s’ils vont partir, et se souviennent.
Puis il y a Little Odessa de brique, le quartier autrefois élégant de Brighton Beach à Brooklyn où ont abouti tant d’immigrés russes croyant arriver dans un pays paradisiaque où l’argent pousse sur les arbres et se ramasse au sol mais ont rapidement déchanté. Ils parlent russe, mangent russe, chantent russe, même si certains se disent américains. Et ils se souviennent.
Enfin, il y a Ashdod, ville portuaire d’Israël en plein sables du désert et sous un soleil aussi éblouissant que celui dont parlait Camus dans L’étranger, une chaleur à laquelle on ne s’habitue pas quand on vient d’ailleurs, et où se retrouvent les Odessites qui auront immigré en Terre promise, sans pour autant y avoir trouvé ce dont ils rêvaient. Ici aussi ils se sont recréés leur Odessa : ils lisent le journal russe publié localement, écoutent la radio ou la télévision en russe, tapissent leurs murs de photos d’Odessa, et se souviennent : « ah, la nostalgie c’est la nostalgie », et boivent un verre de vodka cul sec.
Après ce tour des trois villes portuaires où vivent les épaves humaines d’une Odessa disparue échouées au bord de trois mers (Noire, Atlantique, Méditerranée), le film revient, pour un dernier regard triste, à son point de départ : les rues vides d’Odessa, les voix chevrotantes qui entonnaient des chansons à la mémoire de l’odeur de l’acacia en fleur dont parlait Babel…
Il y a quelque chose à Odessa. Ma mère me l’avait bien dit.
1 Fort bien traduits en français et disponibles en poche chez Folio dans un excellent recueil, Mes Premiers honoraires.
2 De la réalisatrice Michale Boganim, sorti aujourd’hui en salle, qui invoque explicitement la lecture des contes de Babel comme source d’inspiration.. à lire : cette très belle page consacrée au film.


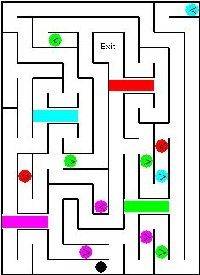 Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “
Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “

 C’est Turbulent, l’installation vidéo de la grande photographe iranienne
C’est Turbulent, l’installation vidéo de la grande photographe iranienne 


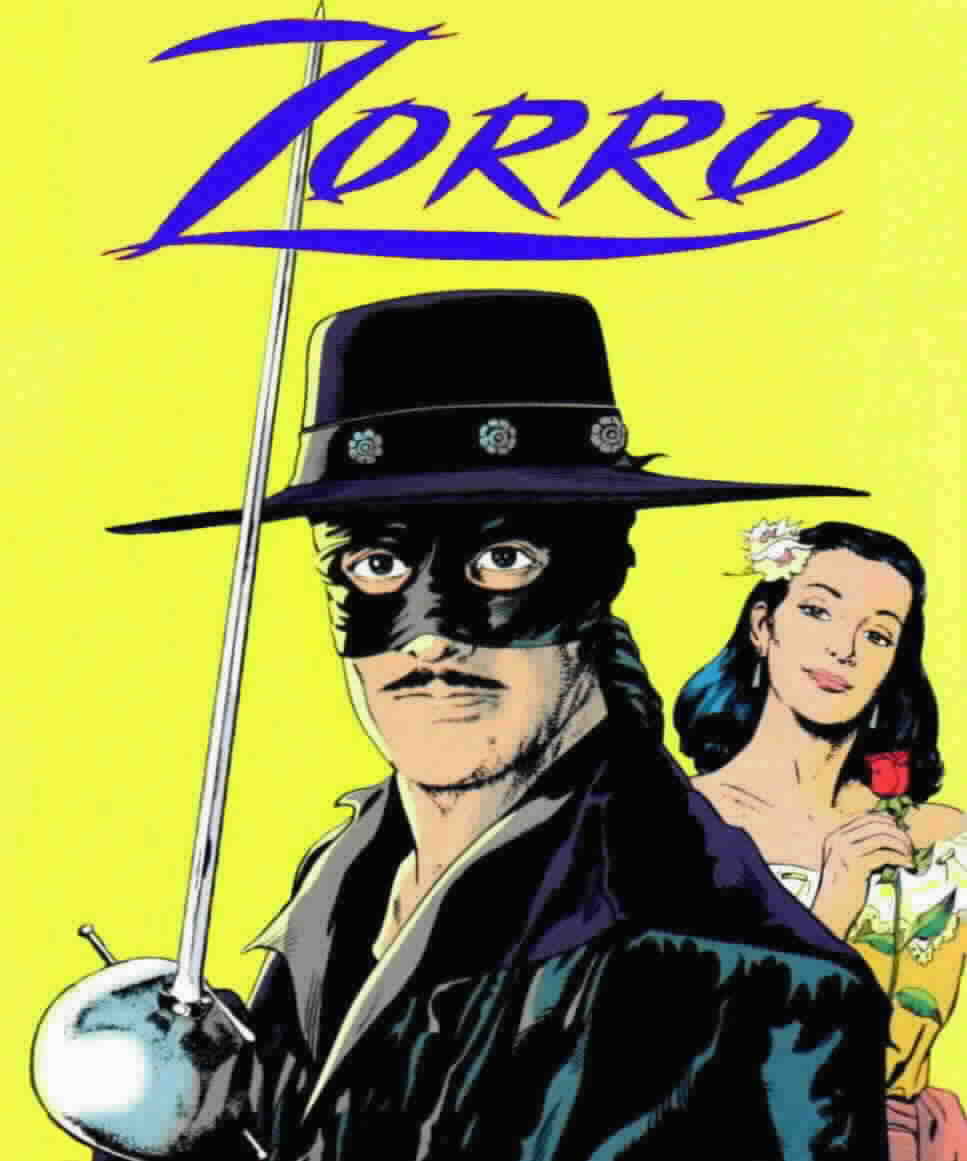 Le pseudonyme a quelques synonymes : en littérature, il s’appelle nom de plume, en résistance ou guerilla nom de guerre, dans le spectacle nom de scène. Ce n’est pas un changement de nom définitif, procédure légale par laquelle une personne remplace son nom d’origine par un autre nom, pour tous les domaines d’activité de sa vie (à ce propos, Nicole Lapierre en a fait une étude passionnante dans le très beau livre
Le pseudonyme a quelques synonymes : en littérature, il s’appelle nom de plume, en résistance ou guerilla nom de guerre, dans le spectacle nom de scène. Ce n’est pas un changement de nom définitif, procédure légale par laquelle une personne remplace son nom d’origine par un autre nom, pour tous les domaines d’activité de sa vie (à ce propos, Nicole Lapierre en a fait une étude passionnante dans le très beau livre  L’adoption d’un pseudonyme peut viser à dissimuler l’identité de la personne qui le porte, afin de préserver sa vie privée (et celle de ses proches, comme dans le cas de noms de guerre ou d’activités socialement ou légalement répréhensibles) ou professionnelle (lorsqu’elle est distincte de l’activité pour laquelle on prend le pseudonyme). Ainsi, l’écrivain
L’adoption d’un pseudonyme peut viser à dissimuler l’identité de la personne qui le porte, afin de préserver sa vie privée (et celle de ses proches, comme dans le cas de noms de guerre ou d’activités socialement ou légalement répréhensibles) ou professionnelle (lorsqu’elle est distincte de l’activité pour laquelle on prend le pseudonyme). Ainsi, l’écrivain  Ce choix peut être motivé par le désir de se créer une personnalité identifiée avec l’œuvre ou avec une partie de l’œuvre,
Ce choix peut être motivé par le désir de se créer une personnalité identifiée avec l’œuvre ou avec une partie de l’œuvre,  Des raisons plus psychologiques que littéraires peuvent amener à ce choix. « [L]a littérature nous fournit quelques exemples d’écrivains célèbres qui, après avoir atteint l’objectif qu’ils convoitaient depuis tant d’années, traversent soudain une crise paradoxale : encore qu’auréolés de ce halo rassurant qu’est la reconnaissance, ils se sentent emprisonnés par l’angoisse, angoisse née de cette certitude, de cette fatalité : se savoir reconnaissable parmi tous, devoir être toujours le même. » (Guadalupe Nettel). C’est le cas de Romain Gary qui a réalisé le tour de force de gagner deux prix Goncourt, sous deux noms : le sien pour Les Racines du ciel, et celui d’Émile Ajar pour
Des raisons plus psychologiques que littéraires peuvent amener à ce choix. « [L]a littérature nous fournit quelques exemples d’écrivains célèbres qui, après avoir atteint l’objectif qu’ils convoitaient depuis tant d’années, traversent soudain une crise paradoxale : encore qu’auréolés de ce halo rassurant qu’est la reconnaissance, ils se sentent emprisonnés par l’angoisse, angoisse née de cette certitude, de cette fatalité : se savoir reconnaissable parmi tous, devoir être toujours le même. » (Guadalupe Nettel). C’est le cas de Romain Gary qui a réalisé le tour de force de gagner deux prix Goncourt, sous deux noms : le sien pour Les Racines du ciel, et celui d’Émile Ajar pour 