Coïncidence, ou, Mais où sont les pizzas d’antan ?
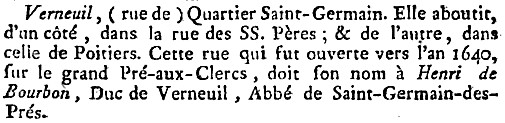
Hurtaut et Magny, Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs. Paris, 1779.
Henri de Bourbon, duc de Verneuil, évêque de Metz et abbé de Saint Germain-des-Prés, jouissait, en cette dernière qualité, d’une juridiction, comme épiscopale, dans toute l’étendue de ce faubourg.
J’avais découvert ce petit restaurant italien de quartier par hasard. Enfin, d’italien, c’était surtout sa carte ; le patron, lui, était un Juif pied noir qui, auparavant, avait enseigné la philosophie et avait de la conversation et un sacré caractère. Le plus souvent campé derrière le comptoir à l’entrée ou parfois assis à une table pour tenir compagnie à un habitué – le service étant assuré par sa femme ou du personnel, selon l’heure (il ne mettait la main à la pâte que lorsqu’il y avait un problème, et on l’entendait alors râler) –, il aimait surtout bavarder avec bagout et débattre de tout rien que pour le plaisir d’argumenter.
La salle était étroite et profonde, séparée du bar à l’entrée par un mur à colombages vidé de son hourdage et bordée de murs à gros moellons décorés de vieilles gravures. Les tables recouvertes d’une nappe propre et d’une serviette en tissu soigneusement disposée étaient suffisamment espacées pour permettre d’y manger au calme, seul ou en compagnie.
Diabolo, le chat du patron qui le traitait parfois aussi brutalement qu’un chien, se promenait mélancolique entre les tables, du moins quand il lui arrivait de sortir de la cave où il était enfermé pendant le service. Bel indifférent, il ne se laissait que rarement caresser. Il arriva tout de même un jour qu’il grimpe, je ne sais trop comment, sur mes genoux sans que je ne l’y encourage pour se mettre à lécher mon t-shirt sur lequel se trouvait dessiné un chat de Kliban…
Je commençai à y venir avec des collègues, puis avec des amis. J’y appréciais l’atmosphère, et quant à la carte, c’étaient les pizzas que je préférais, surtout du fait de leur pâte élastique, ni trop épaisse ni trop fine. Il y avait aussi de la mozzarella panée au coulis de tomates qui, après un premier abord croustillant, fondait délicieusement sur la langue. Le fondant au chocolat était l’un de mes desserts préférés, mais c’était avant que je découvre celui de Dame Tartine.
J’étais devenu un habitué, toutefois pas aussi habitué que Guy O. qui avait dû voir l’ouverture du restaurant quelque trente ans plus tôt. Il y venait chaque soir souvent seul, avait sa table, sa bouteille de vin et semblait faire partie du décor. Quand le hasard m’a fait engager la conversation avec lui – il était le seul autre client ce soir-là et j’étais allé saluer le patron assis à sa table –, je me suis aperçu que, sous un côté discret voire effacé c’était un homme d’opinions et de culture fort intéressant.
Le temps passant, je connaissais les serveurs qui s’y succédaient et échangeais quelques mots avec eux. Certains suscitaient ma curiosité plus que d’autres, et c’est ainsi que j’appris que Sylvian faisait en parallèle à son travail des études de théâtre au Centre de danse du Marais situé à proximité. Je connaissais bien la grande cour de l’ancienne auberge de l’aigle d’or sur laquelle donnaient les grandes fenêtres par lesquelles on apercevait les silhouettes des élèves s’échauffant seuls à la barre ou dansant en groupe valses, tangos ou pasodobles, leurs musiques se mélangeant toutes à mes oreilles : j’y fréquentais un restaurant tex-mex qui en occupait une autre aile et dont j’appréciais beaucoup les plats et surtout l’atmosphère. C’était avant qu’il ne change de gérant et perde pour moi de son intérêt.
Mais je ne savais pas qu’on y pouvait y apprendre le théâtre. Par pure curiosité, je demande donc à Sylvian qui l’enseigne, et voilà qu’il me répond : « Jacqueline Duc ». Si je savais que c’était une actrice (à ne pas confondre avec Hélène Duc, autre actrice…), je ne connaissais pas suffisamment bien le monde du théâtre dont je fréquentais les salles en amateur pour en savoir plus : mais c’était pour toute autre raison que son nom m’était familier : j’avais connu ses parents.

Ils habitaient au 20 rue de Verneuil dans le même immeuble où ma mère avait vécu, depuis son arrivée à Paris adolescente et jusqu’à son mariage avec mon père, chez les Delacour auxquels son oncle l’avait confiée. J’ai parlé ailleurs de cet appartement hors du temps que j’ai tant aimé ; j’y avais habité avec ma mère quand j’étais enfant à notre retour en France en attente de l’appartement rue Vineuse, et l’ai fréquenté ensuite très régulièrement jusqu’au décès du dernier de ses occupants en 1966. Les Duc habitaient deux ou trois étages plus bas, et il me semble voir encore la moustache très british de Monsieur Duc. Jacqueline, elle, je ne l’y avais jamais vue, elle avait quitté la maison de ses parents depuis longtemps, elle était alors dans la force de l’âge.
Maman m’avait raconté comment il lui arrivait de se cacher chez les Duc lorsqu’on craignait une descente de la police pendant l’Occupation, avant qu’elle ne passe en zone libre. Elle portait alors l’étoile jaune, et « on » devait savoir qu’elle habitait chez les Delacour. D’ailleurs, lors d’une de ces descentes, un des policiers aurait intimé à Madame Delacour de lui révéler où se trouvait ma mère faute de quoi elle risquait sa propre vie, à quoi elle aurait répondu « On ne meurt qu’une fois. ». Maman passait alors la nuit chez les Duc. Le soir, avant de se coucher, elle devait caresser leur chat, faute de quoi il la griffait lorsqu’elle se levait le lendemain matin.
Bien des années après, lorsque j’ai voulu faire réaccorder mon piano – un Érard 1864 que je tenais des Delacour et qui avait donc « vécu » rue de Verneuil – , mes collègues de l’Ircam m’en recommandent un. Son adresse ? 20 rue de Verneuil. Il s’avère – je viens de le découvrir – qu’Adrien Proust, père de Marcel, « habite en compagnie de sa mère, “madame veuve Proust”, 20 rue de Verneuil » (sourceDaniel Panzac, Le docteur Adrien Proust, père méconnu, précurseur oublié. L’Harmattan, 2003.) un siècle avant que je n’y arrive pour la première fois. Mais ce sont des hasards plutôt que des coïncidences.

Un soir que je dîne dans ce restaurant, Sylvian y arrive en compagnie d’autres élèves de son cours et d’une dame à laquelle il me présente : c’est Jacqueline Duc. Je l’avais déjà vue ici auparavant avec ses élèves, mais ne savais évidemment pas de qui il s’agissait. L’émotion est vive des deux côtés ; si j’avais connu ses parents et entendu parler de son chat, elle avait connu ma mère.
Le groupe s’assied à une grande table au fond, et j’aperçois Jacqueline qui leur parle à voix basse en lançant des regards vers ma table : elle devait leur raconter cette curieuse histoire.
Les fois suivantes où nous nous sommes croisés ici, nous nous saluions avec grand plaisir. Jacqueline Duc a disparu en 2001 si discrètement que Wikipedia n’en sait toujours rien. Sylvian enseigne le théâtre dans un conservatoire d’art dramatique. Le restaurant, que j’avais cessé de fréquenter, a fermé avec le départ à la retraite de son patron ; lui a brièvement succédé un restaurant brésilien, et maintenant on y trouve un « lounge à l’esprit différent dont le petit patio chic et les tapas françaises qu’il fallait oser en séduiront plus d’un(e) ». Je doute que ce soit mon cas. Guy O. se fournit dorénavant chez un traiteur.

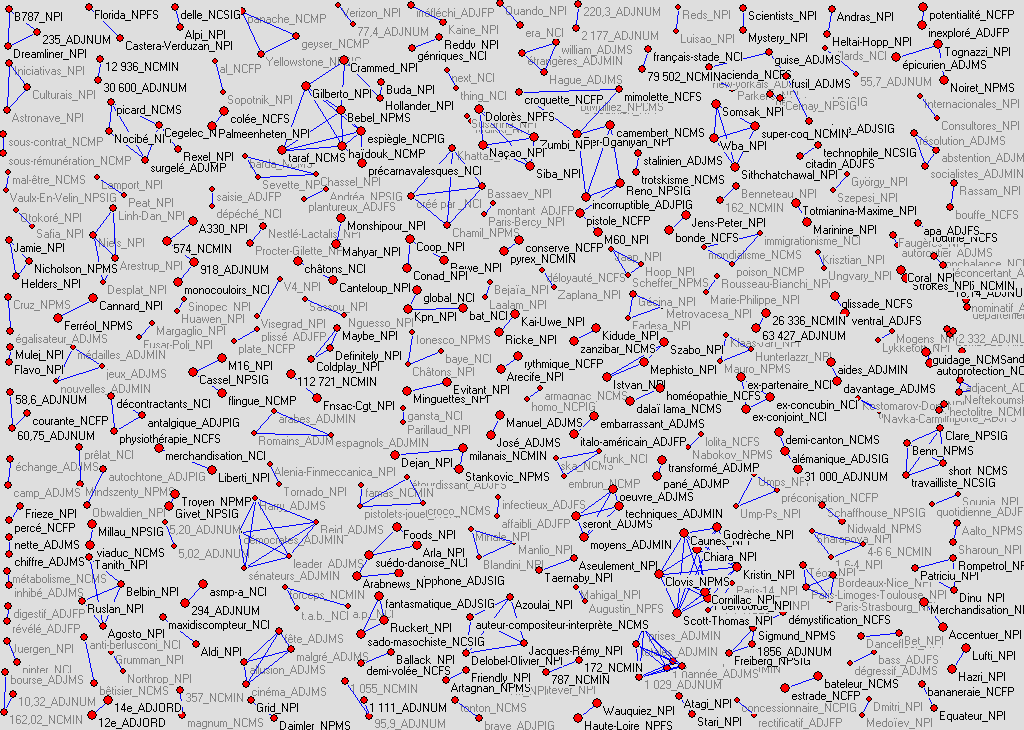
 J’avais découvert Trisha Brown – et la danse postmoderne en général – en voyant, dans les années 1980, le film documentaire
J’avais découvert Trisha Brown – et la danse postmoderne en général – en voyant, dans les années 1980, le film documentaire 


