Une version étendue et plus récente de ce texte est disponible ici.
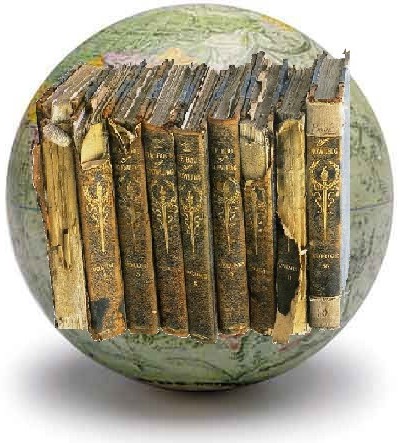 L’évolution des techniques de fixation, de production, de stockage et de diffusion de la production de l’esprit humain amène les bibliothèques à remettre en question périodiquement leurs périmètres d’action – et ceci bien avant l’arrivée de l’informatique, des technologies du numérique et de leurs capacités de production, de traitement et de diffusion –, sans pour autant renier leurs missions de base classiques : créer et organiser des collections et y fournir l’accès au public.
L’évolution des techniques de fixation, de production, de stockage et de diffusion de la production de l’esprit humain amène les bibliothèques à remettre en question périodiquement leurs périmètres d’action – et ceci bien avant l’arrivée de l’informatique, des technologies du numérique et de leurs capacités de production, de traitement et de diffusion –, sans pour autant renier leurs missions de base classiques : créer et organiser des collections et y fournir l’accès au public.
Ce sont tous ces périmètres qui sont transformés actuellement avec l’arrivée de nouveaux outils disponibles sur le Web et ailleurs pour tous, partout. C’est en les analysant que l’on peut faire le constat des nouveaux usages, souvent bien mieux que par l’entremise d’études de besoins qui s’effectuent dans des conditions de laboratoire stérile :
• Les lieux physiques : depuis l’apparition des catalogues informatisés sur le web, le public peut les consulter à distance. Avec la numérisation de certains documents (sonores, textuels, visuels), il peut aussi accéder à distance à des contenus. Les collections elles-mêmes ne sont plus uniquement localisées dans la bibliothèque, avec la réalisation de catalogues communs à des organismes distincts ou le rajout de « ressources externes » (par exemple : bases de données de périodiques numérisés, sites Web…) au catalogue. Quant aux services de médiation, si certains se faisaient déjà par téléphone, le courrier électronique se banalise et certaines bibliothèques offrent dorénavant un service à distance 24h/24.
• La nature des collections et leur disponibilité : la numérisation a élargi (tout en la rendant plus floue) la notion de document édité (tout document en ligne est « édité », en quelque sorte), et, de ce fait, gommé des frontières autrefois immuables entre bibliothèques et archives. De toute façon, le public ignore ces frontières, et va chercher les contenus concernant le domaine qui l’intéresse là où ils se trouvent, que ce soit dans une bibliothèque ou dans des archives les Canadiens ne s’y sont pas trompés, lorsqu’ils ont fusionné leur bibliothèque nationale et leurs archives nationales en 2004. D’autre part, entre la disponibilité physique et numérique d’un même ouvrage, il choisira cette dernière, et s’il ne le trouve pas en ligne, il tentera souvent d’en trouver l’équivalent ou un substitut, ce qui risque de faire tomber en désuétude des pans entiers de collections, ceux qui n’auront pas été numérisés, pour quelque raison que ce soit, et d’encourager la désaffectation des bibliothèques. Quant à la nature même des documents constituant la collection, elle continue à se diversifier pour inclure aussi bien l’éphémère que le durable, sans pour autant que les outils aient intégré la capacité à gérer cette temporalité différente. Enfin, si le prêt de documents (pour les bibliothèques qui l’effectuent) est une fonctionnalité intégrée aux systèmes actuels, ce n’est pas encore le cas pour celui des documents électroniques.
• L’organisation de la connaissance : traditionnellement, c’est le bibliothécaire (ou le documentaliste) qui organise les contenus présents dans son rayon d’action, par le moyen de l’indexation qu’il fournit dans les notices du catalogue, que ce soit à l’aide d’un thésaurus standard ou particulier au fonds. Or deux évolutions ont vu le jour depuis : d’une part, les capacités informatiques à analyser automatiquement les contenus numériques (et pas uniquement textuels) pour fournir des typologies et des cartographies pertinentes ; d’autre part, le phénomène des blogs, qui permettent à tout un chacun de devenir auteur et de s’autopublier, mais aussi de se créer sa propre taxonomie (phénomène appelé si efficacement en anglais folksonomies) pour classer sa production qui reflète finalement sa construction individuelle et collective du sens1. Ce lecteur-auteur-éditeur ne se satisfait plus d’une représentation hiérarchique par disciplines distinctes qui fragmente notre vision du monde ; les réseaux sont passés par là, risquant à l’inverse de mêler irrémédiablement tous les genres.
• L’appropriation : traditionnellement, le lecteur pouvait prendre des notes manuscrites (ou sur son portable), recopier des extraits des contenus des ouvrages auxquels il avait accès sur place ; puis il a pu en photocopier certains. L’informatique y a rajouté la capacité numériser, puis à accéder rapidement et à naviguer non seulement dans des collections, mais aussi dans des documents individuels complexes (par exemple : de longs enregistrements sonores), selon des structurations diverses et des aides (documentaires ou dérivées automatiquement des contenus – index, résumés…). Elle lui permet de copier des documents ou des parties de document d’un clic, et, ce qui est bien plus important, finalement, de les annoter2, de les transformer, de les citer et de les utiliser pour ses propres productions, à l’instar d’un DJ.
• Les réseaux sociaux : si le bouche-à-oreille a toujours été un moyen de diffusion de la « connaissance de la connaissance » (par les pairs, par les médias…), la technique a permis de mettre en œuvre des outils pratiques de diffusion de « l’information sociale » à propos de contenus : lorsque l’on consulte la référence d’un ouvrage chez Amazon, on voit quels autres ouvrages ont « intéressé » (la mesure de l’intérêt étant réelle : l’achat) ceux qui ont acheté l’ouvrage en question (on peut y voir aussi quels ouvrages sont cités dans le corps de l’ouvrage en question, autre réseau à ne pas ignorer). Des techniques comme le RSS (syndication informatique) permettent, à l’instar de la DSI du « passé » (diffusion sélective de l’information), de se maintenir au courant, de façon informelle, de ce qui se publie dans des sources choisies intéressantes et pertinentes.
Dans les pages qui suivent, je me demanderai comment passer de l’uni-versité telle qu’elle existe, une uni-versité centrée exclusivement sur les théories, catégories et méthodes développées par les penseurs occidentaux, à la multi-versité telle qu’elle devrait exister dans un monde globalisé, c’est à dire à une multi-versité dans laquelle la tradition intellectuelle de l’Occident est mise en dialogue avec les autres traditions de pensée et de savoir, qu’elles soient d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique ou d’ailleurs. Je reconnais qu’il est extrêmement difficile, exigeant et complexe pour des philosophes, des politologues, des économistes, des historiens, des psychologues et des spécialistes des sciences sociales de maîtriser l’ensemble des traditions intellectuelles au moment justement où les connaissances explosent dans chacune des disciplines en même temps qu’elles se sur-spécialisent.
Gilles Bibeau, Séminaire sur l’interdisciplinarité et l’application, in Programme de doctorat en sciences humaines, Université de Montréal, année académique 2005-2005.Pour ma part, je pressens l’évolution nécessaire du système d’information de la bibliothèque comme plus proche de ce qu’Amazon met en place que Google (et peut-être pour ce que fera Microsoft avec les fonds de la British Library qu’ils numériseront en 2006) : un dispositif intégré3, polymorphe, extensible, recomposable et personnalisable, prenant acte de ces évolutions, pour le référencement, la gestion, l’organisation, la circulation et la diffusion de documents de nature différente (pour certains numérisés pour d’autres non) et de ressources numériques choisies4 ; contenant des métadonnées de bonne qualité5 ; proposant des moyens de recherche multiples (par index, par texte intégral, par langage naturel, par réseaux sémantiques et sociaux…), intuitifs ou avancés ; permettant à chaque utilisateur de s’en faire « son » catalogue, qu’il pourra renseigner sur la pertinence des réponses fournies, et ainsi l’orienter vers ses propres critères plutôt que ceux du dispositif sous-jacent ; lui offrant les moyens de s’approprier les contenus, de les organiser et de les enrichir ; de communiquer à propos de ces contenus avec d’autres usagers, sur place ou à distance.
Quant à la bibliothèque, elle maintiendra ses missions, mais c’est son fonctionnement qui continuera à évoluer, pour une meilleure collaboration dans la production, la validation, l’organisation et l’utilisation de la connaissance entre le bibliothécaire et l’usager, avec l’assistance de la technique, pour assurer le difficile mais passionnant rôle de médiation, de pôle de référence et d’équilibre entre le local et le global, le privé et le public, le physique et le virtuel, l’instantané et le durable, dans un réseau transdisciplinaire et transculturel en perpétuelle mutation.
Dans un entretien accordé récemment au Magazine littéraire, le poète et essayiste Nimrod disait :
La perspective, inventée au xvie s. dans le domaine de la peinture, viendra hiérarchiser les plans. Mais la perspective n’est pas une vision naturelle, elle est reconstruction. Il faut revenir à Platon pour retrouver toutes ces implications (…), le Platon du Sophiste qui serait du côté de l’art byzantin où tous les plans se chevauchent, bouleversent la perspective et nous avec.
La modernité nous fait paradoxalement changer de perspective et regarder bien loin en arrière pour mieux avancer, et il faut en prendre acte.
1 La seule fonctionnalité qu’offrent certains catalogues en ligne est le panier de notices, sorte de taxonomie à deux éléments (rarement plus, et pas hiérarchiques) : dedans ou dehors.
2 Et d’annoter aussi les métadonnées (les notices descriptives des ouvrages dans les catalogues en ligne).
3 Et non pas une juxtaposition de catalogues, de bases de données, d’annuaires… distincts.
4 Incluant, par exemple, l’équivalent automatique du récolement des ressources électroniques externes.
5 Je ne crois pas à la disparition des métadonnées professionnelles, bien au contraire (de même que ce n’est pas parce que la conduite d’une voiture se simplifie que le moteur disparaît). Mais il est d’autant plus nécessaire d’adapter leur format pour permettre une description plus aisée des « nouveaux documents » et de leur gestion, d’y inclure de nouvelles fonctionnalités (la gestion numérique des droits, par exemple) et d’automatiser, autant que faire se peut, leur mise à disposition (pour éviter d’avoir à cataloguer).
 Il suffit parfois de nommer les choses pour leur donner un sens. C’est ce que l’ouvrage de Dominique Frétard, consacré à la danse contemporaine, a fait pour moi avant même que je n’en commence la lecture à propos d’un
Il suffit parfois de nommer les choses pour leur donner un sens. C’est ce que l’ouvrage de Dominique Frétard, consacré à la danse contemporaine, a fait pour moi avant même que je n’en commence la lecture à propos d’un 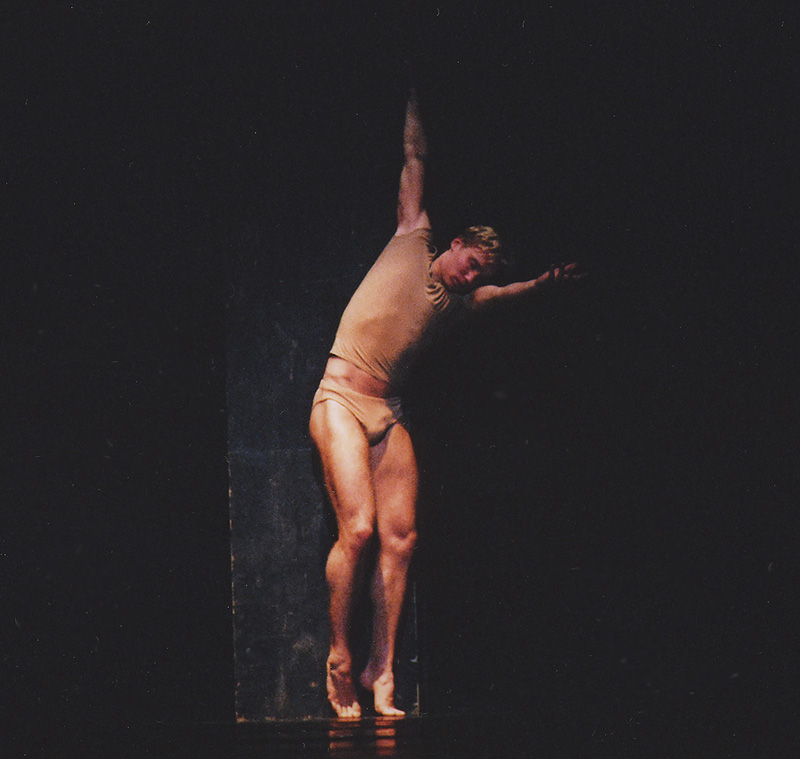


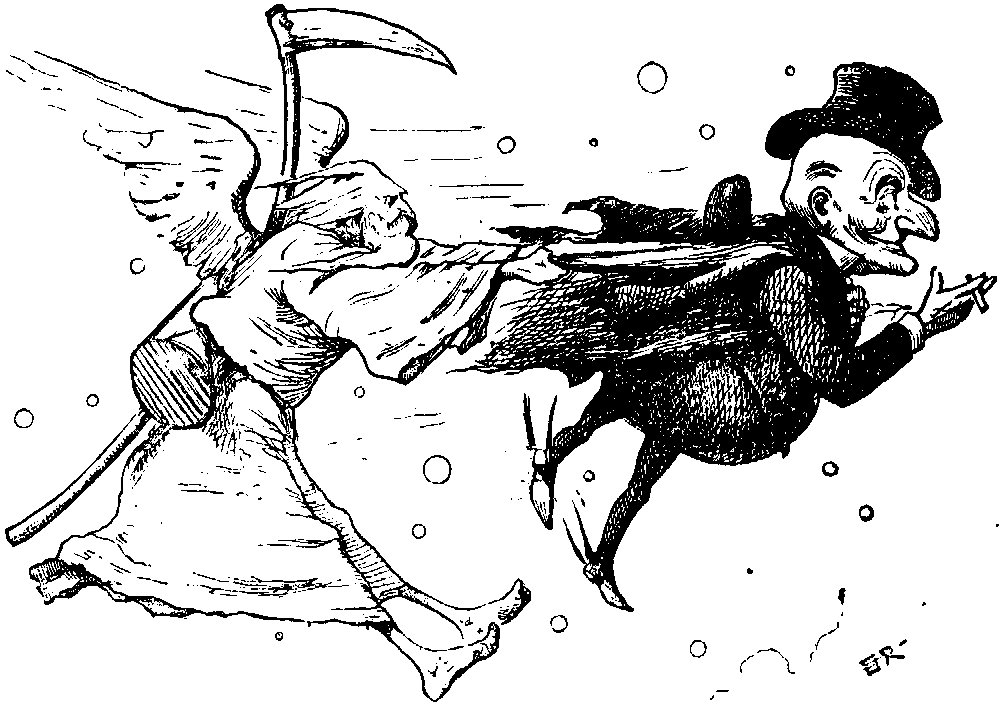
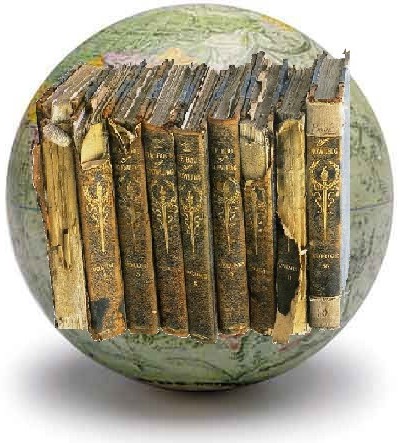 L’évolution des techniques de fixation, de production, de stockage et de diffusion de la production de l’esprit humain amène les bibliothèques à remettre en question périodiquement leurs périmètres d’action – et ceci bien avant l’arrivée de l’informatique, des technologies du numérique et de leurs capacités de production, de traitement et de diffusion –, sans pour autant renier leurs missions de base classiques : créer et organiser des collections et y fournir l’accès au public.
L’évolution des techniques de fixation, de production, de stockage et de diffusion de la production de l’esprit humain amène les bibliothèques à remettre en question périodiquement leurs périmètres d’action – et ceci bien avant l’arrivée de l’informatique, des technologies du numérique et de leurs capacités de production, de traitement et de diffusion –, sans pour autant renier leurs missions de base classiques : créer et organiser des collections et y fournir l’accès au public.