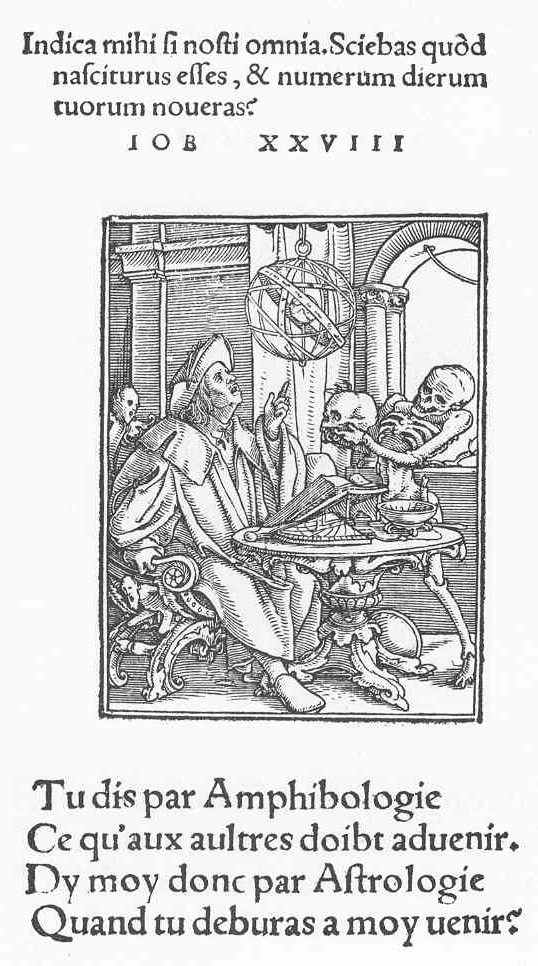Le bâtisseur de mondes
« … la grande métaphore de l’avenir, cette alliance incroyable entre la poésie et les mathématiques. » — George Steiner, Toute théorie n’est qu’une intuition impatiente, entretien avec Pierre Boncenne.
« Un art, dans ses conditions matérielles, est toujours, plus ou moins, (…) une obligation étroite de s’assujettir à certaines règles, d’employer exclusivement certaines formes(…). C’est un casse-tête chinois, si vous voulez : ce casse-tête est l’essence de tous les arts ; ils ne sont arts qu’à cette condition. » — Bernard Jullien, Lettre sur l’art dramatique, 1857.
« Que le lecteur se figure un casse-tête chinois, d’une superficie de six mille hectares, d’un périmètre de huit lieues, dont les morceaux irréguliers doivent remplir exactement un rectangle, telle est cette mystérieuse Kambalu, dont Marco Polo rapportait une si curieuse description vers la fin du treizième siècle, telle est la capitale du Céleste Empire. » — Jules Verne, Les Tribulations d’un Chinois en Chine. 1879.
La musique, les mathématiques et les échecs ont une « connivence singulière », pour reprendre l’heureuse expression du musicien pensif1 François Nicolas à propos des deux premiers de ces domaines. Tous trois permettent à l’homme d’élaborer dans son esprit une infinité d’univers abstraits et cohérents. Construits à partir de briques toutes simples (la note, le nombre, la position), ils obéissent à des lois qui en déterminent les combinaisons, les mouvements et les chemins possibles (accords, progressions harmoniques, démonstrations, déplacement des pièces). Inventions de l’homme, il s’y mesure : les appliquant académiquement, il en tire des navets ; s’en servant avec génie, il produit des chefs d’œuvre. Car il n’y en a pas qu’en musique : il y a des théories et des démonstrations mathématiques d’une beauté saisissante et souvent ineffable, et il en va de même pour des parties d’échec de très grands maîtres. La simplicité des éléments de base et des règles qui en cadrent le foisonnement illimité et infiniment complexe permet de reconnaître dans l’œuvre achevée ce qui a permis d’y arriver. Le mystère est ce qui en fait, le cas échéant, un chef d’œuvre.

C’est ce que Les Sept planches de la ruse, création d’Aurélien Bory présentée au Théâtre de la Ville, a matérialisé avec l’intelligence, l’imagination, l’humour et la simplicité évidente qu’on avait découvert dans Plus ou moins l’infini. Sur la scène plongée dans la pénombre, on distingue un grand carré noir placé au sol, à la tranche épaisse. De quel matériau est-il fait ? Il fait en tout cas penser à cette dalle noire qui apparaît mystérieusement à la fin de 2001 Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, et c’est une sorte de space opera enchanté auquel nous convie Bory.

A l’horizon du carré, on voit émerger et disparaître des formes ovoïdes noires. Des têtes ? Non, elles sont un peu trop volumineuses pour en être. Soudain s’y dressent des jambes, apparition inattendue, suivies plus tard par le reste du corps des douze artistes chinois. Ils se disposeront de façons diverses sur et autour du carré, évoluant en synchronie parfaite entre eux, avec une perfection quasi inhumaine dans tous leurs gestes. Puis ils se mettront à déplacer le carré qui, sous leur pression, se décomposera. On se rendra alors compte qu’il est constitué de sept pièces toutes simples : cinq triangles rectangles, un carré, un parallélogramme : il s’agit du tangram, casse-tête chinois que l’on peut disposer d’une myriade de façons distinctes les unes par rapport aux autres et créer ainsi des formes – animaux, êtres, objets réels ou imaginaires – et laisser ainsi libre court à sa créativité2, tout en respectant les contraintes imposées par leurs dimensions.

La créativité de Bory consiste à ne pas utiliser ces éléments uniquement à plat et à broder non seulement sur leurs dispositions respectives, mais sur leurs mouvements. Ils seront dressés à la verticale, posés au sol sur leur tranche ou en équilibre les uns par rapport aux autres érigeant des temples fugaces à l’adoration des hommes, dessinant des voiliers glissant sur un lac impassible, formes déplacées rapidement ou imperceptiblement sans même que l’on veuille savoir comment : l’esprit, entrant dans le jeu qu’on lui propose, les perçoit comme des êtres doués d’autonomie, qui élaborent à nos yeux un ballet tout aussi complexe que les artistes qui y évoluent comme mus par des moteurs invisibles. Qui manipule qui, l’homme la forme, ou la forme l’homme ? Deux espèces sont en présence l’une de l’autre, elles tournent l’une autour de l’autre, tentent de comprendre leur fonctionnement mutuel, essaient de cohabiter, se fondent et se confondent. Comment ne pas penser encore une fois comme alors à ces mystérieux Xipéhuz de Rosny aîné ?

Ces paysages sont ceux d’un autre univers que le nôtre : les lois de la gravitation sont abolies, les formes tiennent en équilibre comme par miracle, les hommes s’élèvent et descendent avec une grâce aérienne. Dressé à nos yeux, c’est un monde qui semble plat à l’instar de celui que décrit E. A. Abbott dans Flatland. Des silhouettes y évoluent sous un éclairage monochrome froid et une musique désincarnée ; de temps en temps, une tache de couleur : c’est l’habit clair d’un artiste ; parfois, une musicienne joue une mélopée chinoise ; des moments incongrus font soudain éclater le rire dans la salle – surtout celui des enfants : les adultes semblent avoir oublié de laisser leur raison au vestiaire.

« Nous aimons, non pas être au cœur des disciplines, mais tout au bord, sur la tranche, à un endroit qui n’est ni du jonglage ou de l’acrobatie, du théâtre ou de la danse, mais qui tente d’être un événement, une action, capable de générer un trouble, avec les moyens qui sont ceux de la scène… » — Aurélien BoryC’est un monde étrange, d’une sidérante poésie. Est-ce du cirque ? Est-ce de la danse ? Qu’importe : c’est l’œuvre d’un magicien. S’il y a quelques longueurs dans ce spectacle, elles sont vite oubliées. On en ressort comme après ce voyage qu’on a fait dans des pays du grand nord à l’infinie variété des paysages monochromes rutilants de glace brûlante, et où les gens, plus proches de l’essentiel, sont pudiques et réservés. Si vous n’avez pas eu la chance de voir ce spectacle à Paris, vous devez l’y rattraper :
• du 8 au 10 février à Elbeuf,
• du 12 au 14 février à Brest,
• du 21 au 23 février à Bordeaux,
• du 29 février au 2 mars à Châteauroux,
• les 7 et 8 mars à Douai,
• les 11 et 12 mars à Reims,
• les 14 et 15 mars au Havre,
• du 18 au 22 mars à Grenoble,
• du 26 au 30 mars à Lisbonne,
• les 1er et 2 avril à Annecy,
• les 4 et 5 avril à Chambéry, et
• les 11 et 12 avril à La Roche-sur-Yon.
Toutes les photos sont d’Aglaé Bory et reproduites avec l’autorisation de la Cie 111 que nous remercions vivement non seulement de nous les avoir fournies, mais aussi pour le réenchantement du monde qu’ils nous proposent. Qui peut affirmer ne pas en avoir besoin ?
1 Terme que ce polytechnicien, musicien, compositeur et philosophe s’applique à lui-même.
2 Jusqu’à en proposer des meubles recomposables à l’infini.