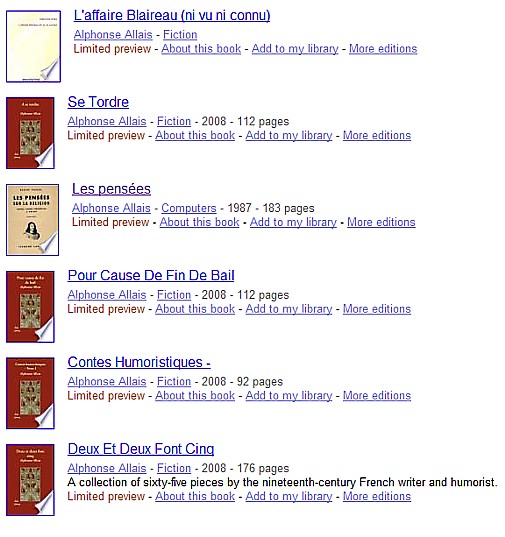Carmen, un documentaire indéterminé de Bizet
« On préparait Carmen à l’Opéra-Comique, et les inquiétudes, qui précèdent toujours une grande bataille à livrer, devenaient chaque jour de plus en plus vives pour Bizet. Enfin Carmen parut. Le succès fut évident pour les artistes ; mais auprès du public il n’en fut pas de même ; et, comme l’on dit dans le langage du théâtre, la pièce ne fit pas d’argent. » — Henri Maréchal, « Souvenirs d’un musicien », in Albert Lavignac, Les Gaietés du Conservatoire (1899).
« Bizet’ “Carmen” . . . which is now well known to the public, possesses a certain fascination which may be called popularity, and with its light and pleasing characteristics, may be relied upon to attract a full house without reference to its musical merit. Its musical merit is, indeed, of a low order. . . » — The New York Times, 1/3/1879.
France 3 diffuse ce soir « le chef-d’œuvre » de Georges Bizet, selon les termes de la chaîne (auquel nous préférons de loin Les Pêcheurs de perles), qui se contente d’indiquer sur son site que c’est un « docu. indéterminé » (document ? documentaire ? docudrame ?) réalisé par François Roussillon et de fournir un bref synopsis. Nulle indication sur les interprètes – chef, solistes, orchestre.
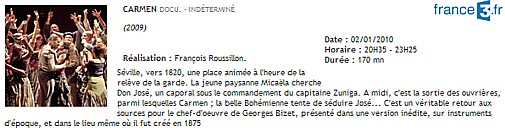
Le site L’Internaute Télévision, quant à lui, est quelque plus précis (Carmen est bien un opéra comique) et plus prolixe, puisqu’il fournit les noms du compositeur et de trois des « interprete ». Le sommaire de l’émission dans ce programme est curieux : « L’Orchestre Révolutionnaire et Romantique et le Monteverdi Choir ». Ici aussi, nulle mention d’un chef.
Il aura fallu se rendre sur le site de l’orchestre en question pour y trouver qu’il s’agit d’une pointure : John Eliot Gardiner, et de l’enregistrement d’une performance à l’Opéra Comique. Pour la distribution, c’est Télérama qui la détaille (ainsi, bien évidemment, que le site de la salle Favart). Sa critique est élogieuse, mais on ne la partage pas : le vibrato d’Anna Caterina Antonacci (dans le rôle titre, vers le haut de son registre) est parfois trop ample, son intonation et celle de Nicolas Cavallier (Don José, vers le bas du sien) approximatives, et le sous-titrage est, lui, nécessaire pour certains des solistes (nonobstant l’avis de Télérama sur le « français intelligible » des interprètes étrangers et la fiche de L’Internaute qui indique que le spectacle n’est pas sous-titré…). On apprécie tout de même l’humour discrètement coquin du magazine lorsqu’il écrit : « Charnue, pulpeuse, modulée avec une gourmandise sensuelle, la prononciation d’Anna Caterina Antonacci, comme son jeu, est un pur régal » : Antonacci est indéniablement pulpeuse, charnue et sensuelle, tout est question de la fonction des virgules dans cette phrase-là. C’est ainsi que Mérimée décrit Carmen dans sa nouvelle éponyme, de laquelle s’est inspiré l’opéra :
Je doute fort que mademoiselle Carmen fût de race pure, du moins elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j’aie jamais rencontrées. Pour qu’une femme soit belle, il faut, disent les Espagnols, qu’elle réunisse trente si, ou, si l’on veut, qu’on puisse la définir au moyen de dix adjectifs applicables chacun à trois parties de sa personne. Par exemple, elle doit avoir trois choses noires : les yeux, les paupières et les sourcils; trois fines, les doigts, les lèvres, les cheveux, etc. Voyez Brantôme pour le reste. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfections. Sa peau, d’ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus; ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus blanches que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l’aile d’un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d’une description trop prolixe, je vous dirai en somme qu’à chaque défaut elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C’était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d’abord, mais qu’on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c’est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n’avez pas le temps d’aller au Jardin des Plantes pour étudier le regard d’un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau.
Une beauté voluptueuse, certainement… L’orchestre, lui, est parfait (Télérama ne s’y trompe pas, sur ce point) : rien à redire sur l’ensemble, son intonation et son interprétation (le chœur aussi est très bon) – avec un tel chef, ce n’est pas étonnant.
Nous retrouvons ici les talentueux librettistes Meilhac et Halévy, qu’on avait entendus pas plus tard qu’hier dans La Vie parisienne d’Offenbach. Finalement, heureusement que cette opérette n’est pas rediffusée aussi souvent que Carmen qui a acquis le statut assuré d’opéra-passe-partout-indigestion-assurée pour un certain nombre d’auditeurs. D’ailleurs, on se demande comment, avec les récentes lois européennes contre le tabagisme public, il est encore permis de diffuser un opéra dans lequel on peut entendre : « Voyez les regards impudents, mine coquette ! Fumant toutes, du bout des dents, la cigarette. Dans l’air nous suivons des yeux la fumée qui vers les cieux monote parfumée…» Interdisez-moi ça une fois pour toutes et revenons aux Pêcheurs de perles, il est grand temps, car « Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix tendre et sonore comme un chant de ramiers. Oh nuit enchanteresse, divin ravissement ! ».