Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous désirez quelque chose que vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir…
«Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées, et qui se conclut, dans des espaces neutres, indéfinis, et non prévus à cet usage, entre pourvoyeurs et quémandeurs, par entente tacite, signes conventionnels ou conversation à double sens — dans le but de contourner les risques de trahison et d’escroquerie qu’une telle opération implique —, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d’ouverture réglementaires des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. »
Préambule à Dans la solitude des champs de coton.

«Il y a dix ans, quand Bernard-Marie Koltès me parlait de la pièce qu’il écrivait et qui allait devenir « Dans la solitude des champs de coton », il me racontait ceci : deux hommes s’abordent qui ne se connaissent pas : dites-moi ce que vous voulez et je vous le vends, dit le premier, et l’autre répond : dites-moi ce que vous avez et je vous dirai ce que je veux. C’est le deal sous toutes ses formes, c’est toutes les formes de deal que la vie propose, c’est la vérité des relations entre les hommes. Ici, deux hommes orgueilleux et tricheurs ; le dealer ne dira jamais ce qu’il propose — mais peut-être parce que c’est lui qui est en manque — ; le client exigera toujours qu’on devine ce qu’il réclame — mais peut-être parce qu’il ne sait plus comment on fait pour demander — ; de part et d’autre un égal amour-propre, bientôt un malentendu douloureux, puis meurtrier. Il y a ce qu’on ne peut pas dire et ce qu’on ne veut pas faire, car il ne faut jamais faire cadeau de sa faiblesse à l’autre, il y a une attente folle et tenace, la découverte qu’on est pauvre, pauvre de désirs, il y a toutes les blessures qu’on peut faire au désir de l’autre et la souffrance qu’on découvre et qu’on refuse en même temps. »
Patrice Chéreau, 1995.

Je ne me lasse pas de revenir à ce chef-d’œuvre qui ne s’épuise jamais, à l’instar des grands classiques de la tragédie grecque qui dépassent la situation qu’elles décrivent pour parler au for intérieur de leurs auditeurs, au-delà de leur âge, de leur genre ou de leur position sociale. J’en ai d’ailleurs parlé ici à plusieurs reprises (et notamment le 20/12), en des termes qui s’accordent avec cette citation de Chéreau que je viens de trouver, sauf sur sa chute pessimiste : les toutes dernières répliques de la pièce, faut-il les lire littéralement, auquel cas c’est effectivement une fin désespérée et un combat à mort, ou alors métaphoriquement, ce qui laisserait espérer une ouverture et une sortie de cette nuit de la solitude et de l’indifférence, en se débattant peut-être, mais ensemble ?
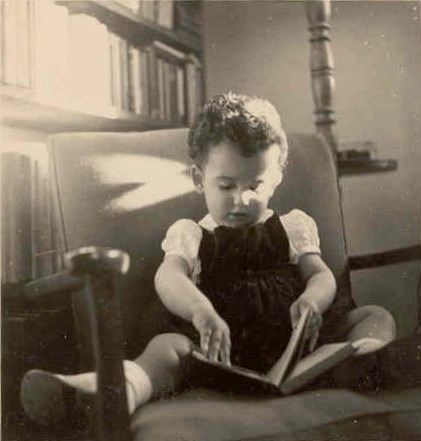
Trés intéressant le propos de Chéreau.. je n’aurais jamais à cette relation en aveugle.. à méditer
Commentaire par zopiros59 — 6 mars 2005 @ 11:04
Pas compris ton commentaire, il ne manquerait pas un ou plusieurs mots?
Commentaire par miklos — 6 mars 2005 @ 11:05
Le deal. Un deal … comme tu le ressens bien toi-même, en l’écrivant dans ton commentaire, cette appréhension des rapports humains renvoie bien à la dimension tragique de Koltès et de son oeuvre. La fin, dès lors, ne nous étonne pas.
Commentaire par griffin — 6 mars 2005 @ 11:33
La fin ? Mais quelle est la fin et y a-t-il même une fin ici (si ce n’est techniquement la fin de la pièce) ? Ce que j’ai essayé de dire c’est que justement je perçois ici un espoir, après tout ce qui s’est dit, dans cette danse d’approche méfiante et pourtant si désirante de l’un vers l’autre : l’espoir qu’ils se rencontreront enfin et dépasseront ce combat qui n’est qu’une protection contre la peur et le fantasme, celui de la souffrance que l’on pourrait subir de l’autre quand on aura laissé tomber ses défenses, mais qui est cause d’un enfermement dans la souffrance de la solitude.
Je pense que c’est une pièce, non pas sur l’incommunicabilité mais sur les difficultés de la communicabilité et qui a une issue qui n’est pas forcément tragique. On est toujours seul, finalement, mais on peut l’être moins que ce qu’on se l’impose.
Commentaire par miklos — 6 mars 2005 @ 11:43
C’est bien en quoi il y a une dimension tragique chez Koltès
Commentaire par griffin — 6 mars 2005 @ 12:33
dans l
Commentaire par hub — 17 mars 2005 @ 0:02
dans la tragédie, le héros est tragique parce qu’il est dépassé, et jeté dans le monde sans pouvoir intervenir ; dans la solitude des champs de coton, il me semble qu’il y a au contraire, constamment, un espoir qui revient plusieurs fois malgré une situation très noire, en focntion de la volonté qu’on a ou pas de créer un lien avec l’autre personnage, je n’y vois pas de tragédie. je me plante ou pas ?
Commentaire par hub — 17 mars 2005 @ 0:08
Il me semble que c’est bien une tragédie, en ce sens où elle met en scène deux personnages qui sont des archétypes (du couple, de tous les couples), et représente les passions et les conflits de façon emblématique, passions et conflits inéluctables (à ce couple, à tous les couples).
La fin elle-même est ambigüe : la toute dernière réplique de la pièce, dans laquelle le client propose "Alors, quelle arme ? " pourrait indiquer un conflit à mort, mais elle montre qu’il ne va pas reprendre le chemin qu’il poursuivait solitaire au début de la pièce, mais qu’il s’engage à poursuivre avec le dealer le combat commencé au moment où ils se sont croisés, combat non pas fait pour éliminer l’autre mais reflet du combat avec soi-même quand on rencontre l’autre, essentiellement semblable et essentiellement différent, combat qui se mène au cours du face-à-face du couple.
C’est d’ailleurs ce que la Genèse affirme, à propos du tout premier couple : après qu’Adam eut été créé, Dieu constate qu’il n’est pas bon qu’il reste seul, et décide de faire, dans une expression extraordinairement économique – deux mots qui ne peuvent se traduire que par une périphrase -, "une aide face à lui", où ce "face" indique un face-à-face qui est autant accompagnement que potentiellement opposition conflictuelle.
C’est donc en ce sens que cette pièce possède bien une dimension tragique comme l’a dit Griffin, tout autant que la scène primordiale de l’apparition "du" couple.
Commentaire par miklos — 17 mars 2005 @ 8:20