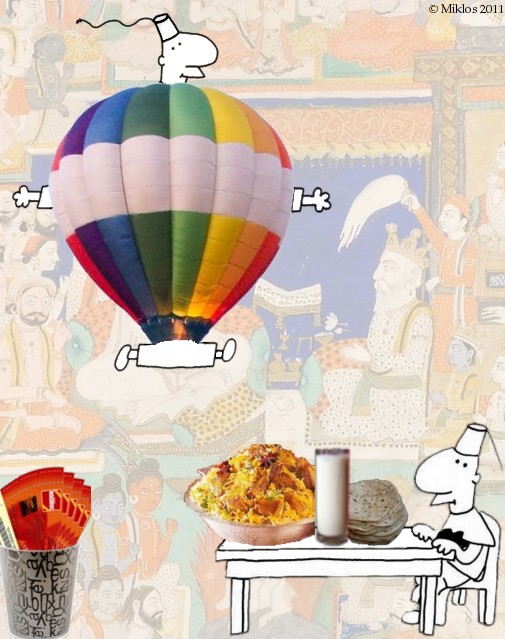Appeler un chat un chat, ou, rendre à César ce qui est à César
 En cette période mouvementée de l’entre-deux-tours où, tel chien et chat (on ne dira pas qui est qui), s’affrontent deux candidats, et après avoir avoir rapporté l’histoire d’un chat si attentionné à l’égard de ses maîtres jusqu’à surmonter, que dis-je, transcender, ses instincts les plus sauvages, il n’est que justice de citer cet extraordinaire texte de Pierre Larousse. Extraordinaire à plus d’un égard : on le trouve au cœur de son Encyclopédie, genre de texte scientifique et donc objectif et dépersonnalisé, tandis qu’ici on découvre une description de cet animal faite avec un rare humour léger et fin et qui ne manque ni de considérations historiques et littéraires ni sociologiques et politiques – et, ne les manquez pas, musicales –, texte qui va jusqu’à aborder la place que l’objet de l’article a prise dans la famille de l’auteur, personnage qu’on (se) représente toujours fort sérieux, voire mélancolique ou triste. Larousse lui-même le qualifie ainsi, ce qui est d’une certaine actualité : « Cela fera trêve un moment à ces longues excursions que l’ordre alphabétique nous contraint d’entreprendre dans le domaine de l’économie politique et sociale, politique surtout, chemin difficile et raboteux, semé de casse-cou et de chausse-trapes, par ce temps béni de liberté de la presse, où, si l’on en croit Beaumarchais, il est permis de tout dire, à la condition expresse de ne parler de rien ni de personne. »
En cette période mouvementée de l’entre-deux-tours où, tel chien et chat (on ne dira pas qui est qui), s’affrontent deux candidats, et après avoir avoir rapporté l’histoire d’un chat si attentionné à l’égard de ses maîtres jusqu’à surmonter, que dis-je, transcender, ses instincts les plus sauvages, il n’est que justice de citer cet extraordinaire texte de Pierre Larousse. Extraordinaire à plus d’un égard : on le trouve au cœur de son Encyclopédie, genre de texte scientifique et donc objectif et dépersonnalisé, tandis qu’ici on découvre une description de cet animal faite avec un rare humour léger et fin et qui ne manque ni de considérations historiques et littéraires ni sociologiques et politiques – et, ne les manquez pas, musicales –, texte qui va jusqu’à aborder la place que l’objet de l’article a prise dans la famille de l’auteur, personnage qu’on (se) représente toujours fort sérieux, voire mélancolique ou triste. Larousse lui-même le qualifie ainsi, ce qui est d’une certaine actualité : « Cela fera trêve un moment à ces longues excursions que l’ordre alphabétique nous contraint d’entreprendre dans le domaine de l’économie politique et sociale, politique surtout, chemin difficile et raboteux, semé de casse-cou et de chausse-trapes, par ce temps béni de liberté de la presse, où, si l’on en croit Beaumarchais, il est permis de tout dire, à la condition expresse de ne parler de rien ni de personne. »

« Depuis que les chiens ont presque un état civil, un sort fatal menace la gent féline : un impôt, la cote personnelle, c’est-à-dire une Terreur, un massacre des Innocents, attend les chats. Bientôt peut-être les rivières charrieront leurs cadavres ; bientôt leurs membres palpitants rissoleront à foison dans les casseroles des gibelottiers de nos barrières. Éloignons ces funèbres idées, et, quel que soit le sort réservé à cette intéressante espèce de quadrupèdes, ayons le courage de prendre leur défense en portant à la connaissance de tous des faits qui, depuis la plus haute antiquité, n’ont cessé de témoigner de l’estime dans laquelle ils ont toujours été tenus par les humains.
 D’abord, et pour être fixé sur la valeur intrinsèque, tant morale que physique, d’une race d’animaux, consultons les proverbes, cette sagesse des nations. Que disent les proverbes ? Fripon comme une chouette ; Triste comme un hibou ; Cruel comme un tigre ; Sale comme un pourceau ; Sauvage et misanthrope comme un ours ; Rusé comme un renard ; Vorace comme un loup ; Myope comme une taupe ; Têtu comme un mulet : Colère, vindicatif comme une vipère ; Inconstant comme un papillon, etc. Le chien, cet ami de l’homme, voyez comme l’homme le comprend : un mauvais souper, c’est un souper de chien ; il pleut à verse, la neige tombe en flocons serrés, il vente à décorner les bœufs, il grêle à briser les vitres, c’est un temps de chien. Comment s’ennuie-t-on ? On s’ennuie comme un chien. Achille, en colère contre Agamemnon, traite le roi des rois de face de chien. Mais le chat !… le chat, au contraire… Jugez-en, toujours d’après la sagesse des nations : Chat échaudé craint l’eau froide. Ici, le chat symbolise la prudence : un chat ne peut être dupe qu’une seule fois en sa vie ; l’eau chaude lui a joué un tour pendable, il redoute l’eau, même froide. Être debout avant que les chats soient chaussés. Ce proverbe indique clairement l’opposé de la paresse. On est du naturel des chats lorsqu’un retombe toujours .sur ses jambes, ce qui est le comble de l’habileté, et le mot chat a eu l’honneur d’être pris comme terme de comparaison, quand on a voulu peindre la dextérité avec laquelle le plus fin politique du siècle passait sain et sauf d’un gouvernement à un autre. Nous pourrions continuer ces honorables citations, mais une étude ne se composant pas que d’apophthegmes, rompons le courant et passons à d’autres détails.
D’abord, et pour être fixé sur la valeur intrinsèque, tant morale que physique, d’une race d’animaux, consultons les proverbes, cette sagesse des nations. Que disent les proverbes ? Fripon comme une chouette ; Triste comme un hibou ; Cruel comme un tigre ; Sale comme un pourceau ; Sauvage et misanthrope comme un ours ; Rusé comme un renard ; Vorace comme un loup ; Myope comme une taupe ; Têtu comme un mulet : Colère, vindicatif comme une vipère ; Inconstant comme un papillon, etc. Le chien, cet ami de l’homme, voyez comme l’homme le comprend : un mauvais souper, c’est un souper de chien ; il pleut à verse, la neige tombe en flocons serrés, il vente à décorner les bœufs, il grêle à briser les vitres, c’est un temps de chien. Comment s’ennuie-t-on ? On s’ennuie comme un chien. Achille, en colère contre Agamemnon, traite le roi des rois de face de chien. Mais le chat !… le chat, au contraire… Jugez-en, toujours d’après la sagesse des nations : Chat échaudé craint l’eau froide. Ici, le chat symbolise la prudence : un chat ne peut être dupe qu’une seule fois en sa vie ; l’eau chaude lui a joué un tour pendable, il redoute l’eau, même froide. Être debout avant que les chats soient chaussés. Ce proverbe indique clairement l’opposé de la paresse. On est du naturel des chats lorsqu’un retombe toujours .sur ses jambes, ce qui est le comble de l’habileté, et le mot chat a eu l’honneur d’être pris comme terme de comparaison, quand on a voulu peindre la dextérité avec laquelle le plus fin politique du siècle passait sain et sauf d’un gouvernement à un autre. Nous pourrions continuer ces honorables citations, mais une étude ne se composant pas que d’apophthegmes, rompons le courant et passons à d’autres détails.
Si les bêtes étaient susceptibles d’amour-propre, quels animaux devraient en avoir autant que les chats ? Ils ont, non pas une figure, mais une véritable physionomie. Et puis, ils portent la moustache… et fièrement ! L’élasticité de leur corps, leurs mouvements agiles, leurs bonds sans retentissement semblent faire d’eux des êtres mystérieux qui paraissent vouloir garder un secret.
 Les Arabes adoraient un chat d’or, d’après Pline. Les Alains, les Suèves, les Vandales, pour représenter la Liberté, avaient adopte le chat, qui peut être dompté, jamais soumis. En Égypte, dès la plus haute antiquité, le chat fut divinisé. Le dieu chat (le dieu de la musique) était représenté avec sa tête naturelle sur un corps d’homme et tenant un cystre. La déesse chatte était la déesse des amours. À Memphis, la beauté des femmes était d’autant plus appréciée qu’elle se rapprochait davantage du type chat. Il n’y avait pas un temple qui n’eût une famille de chats. Alors on vouait les enfants au chat, d’après Diodore, comme aujourd’hui on les voue à la Vierge, ou au bleu, ou au blanc. Les enfants ainsi consacrés portaient au cou un petit médaillon sur lequel était figurée la tête du chat du temple où le vœu avait été prononcé. Chaque temple en élevait une espèce différente. La vente de ces médailles produisait de gros bénéfices aux prêtres de ce culte, dont les mystères furent plus tard révélés aux pontifes grecs par Orphée. On voit bien que rien n’est nouveau sous le soleil. Au temps d’Hérodote, lorsqu’il mourait un chat dans une maison égyptienne, tous les habitants se rasaient les sourcils en signe de deuil. Si quelqu’un en tuait un, même accidentellement, le peuple se jetait sur le meurtrier et le faisait expirer dans les plus cruels tourments. On sait que la ville de Corinthe possédait une statue colossale de bronze représentant un chat accroupi.
Les Arabes adoraient un chat d’or, d’après Pline. Les Alains, les Suèves, les Vandales, pour représenter la Liberté, avaient adopte le chat, qui peut être dompté, jamais soumis. En Égypte, dès la plus haute antiquité, le chat fut divinisé. Le dieu chat (le dieu de la musique) était représenté avec sa tête naturelle sur un corps d’homme et tenant un cystre. La déesse chatte était la déesse des amours. À Memphis, la beauté des femmes était d’autant plus appréciée qu’elle se rapprochait davantage du type chat. Il n’y avait pas un temple qui n’eût une famille de chats. Alors on vouait les enfants au chat, d’après Diodore, comme aujourd’hui on les voue à la Vierge, ou au bleu, ou au blanc. Les enfants ainsi consacrés portaient au cou un petit médaillon sur lequel était figurée la tête du chat du temple où le vœu avait été prononcé. Chaque temple en élevait une espèce différente. La vente de ces médailles produisait de gros bénéfices aux prêtres de ce culte, dont les mystères furent plus tard révélés aux pontifes grecs par Orphée. On voit bien que rien n’est nouveau sous le soleil. Au temps d’Hérodote, lorsqu’il mourait un chat dans une maison égyptienne, tous les habitants se rasaient les sourcils en signe de deuil. Si quelqu’un en tuait un, même accidentellement, le peuple se jetait sur le meurtrier et le faisait expirer dans les plus cruels tourments. On sait que la ville de Corinthe possédait une statue colossale de bronze représentant un chat accroupi.
Les Turcs considèrent le chat comme un animal pur ; ils l’admettent et le choient dans leurs maisons, tandis qu’ils en proscrivent le chien, animal impur. Chez tous les musulmans, d’ailleurs, les chats sont encore en grand honneur ; Mahomet avait pour eux beaucoup d’égards, comme le prouve le conte suivant : Le chat du Prophète s’était un jour couché sur la manche de son habit et semblait y méditer si profondément, que Mahomet, pressé de se rendre à la prière, mais n’osant le tirer de son extase, coupa, pour ne pas le déranger, cette partie de son vêtement. À son retour, le chat, qui était revenu de son assoupissement, vint lui faire la révérence pour le remercier d’une attention si marquée. Mahomet comprit ce que cela signifiait, et assura au chat, qui faisait le gros dos, une place dans son paradis. Ensuite, passant trois fois la main sur l’animal, il lui imprima par cet attouchement la vertu de ne jamais tomber que sur ses pattes.
Il existe au Caire, près de la porte de la Victoire ou Babel Nazz, un hôpital créé spécialement pour les chats. Dans cet établissement, on recueille tous les chats malades et sans asile. Un voyageur raconte avoir vu plus d’une fois les fenêtres encombrées d’hommes et de femmes qui leur donnaient à manger a travers les barreaux. « Je me suis souvent arrêté, dit-il, devant ce curieux spectacle ; ces-chats avaient sur leurs bonnes faces une véritable expression de béatitude. »
Homère, dans la Batrachomyomachie, ne parle des chats qu’avec les plus grands égards, et Platon, le divin Platon, leur donne la plus belle place dans sa description de cet âge d’or, où, dit Montaigne :
Où l’épouse tendre et chérie
Ne connaissait de sort plus doux
Que de passer toute sa vie
Entre son chat et son époux.
Pour l’homme, en effet, le chat est un ami avec lequel il s’entretient et converse tout a l’aise. Il est aussi un comédien pantomime qui l’égaye, le distrait et l’amuse. C’est un astronome météorologiste, qui lui prédit les changements de temps beaucoup mieux que ne pourra jamais le faire le directeur actuel de Observatoire impérial. De plus, le chat est musicien. Musicien ? — Oui ; ne vous récriez pas, nous allons vous le démontrer.
Deux savants éminents, Grew et Le Clerc, ont dit : « Les chats sont très-avantageusement organisés pour la musique : ils sont capables de donner diverses modulations à leur voix, et, dans l’expression des différentes passions qui les occupent, ils se servent de différents tons. » En effet, aucune nuance ne leur est inconnue, depuis le ronron en pédale jusqu’au fortissimo le plus aigu, en passant par toutes les transitions notées sur la musique des maîtres. Il est probable, presque certain, que ces dissonances qui nous agacent sont de réelles beautés, qui, faute d’une intelligence musicale suffisamment développée, nous échappent. Peut-être est-ce la musique de l’avenir, peut-être celle du passé, dans les temps antéhistoriques, alors que probablement la délicatesse des organes humains était développée sur une échelle différente. Les arts ne sont-ils pas sujets à de grandes révolutions ? Voyez d ailleurs les Asiatiques : notre musique leur semble ridicule, et, par contre, nous trouvons que la leur n’a pas le sens commun. L’organisation musicale du chat persiste jusqu’après sa mort ; après le rôle actif, le rôle passif. N’est-ce pas avec les boyaux de chats que l’on fabrique les meilleures chanterelles, ces cordes à violon sonores entre toutes ?
Astronomes et météorologistes, voyez-les : la patte qu’ils contournent et promènent avec tant de grâce sur leur tête est un signe certain d’un prochain changement dans l’état de l’atmosphère : s’il fait beau, attendez-vous au mauvais temps ; s’il pleut, espérez le soleil et le ciel pur. Le froid s’apprête à sévir, le vent doit bientôt souffler avec violence : le chat couche son poil aussi près que possible de la peau ; résultats : concentration de la chaleur, défaut de prise pour le vent. La chaleur promet de devenir intense : le chat dresse et hérisse son poil ; résultats : rayonnement de sa chaleur, déperdition de vapeur, équilibration de sa température animale. Le chat est l’être logique par excellence.
Quant au savoir-vivre, quel autre animal peut lui être comparé ? L’heure des repas lui est indifférente ; chaumière ou palais, il n’est aucun endroit d une maison qui ne lui soit lieu de plaisance ; sur l’appui d’une fenêtre, sur le bras d’un fauteuil,il dort en équilibre ; étendu ou pelotonné sur un fagot de broussailles, il s’y trouve plus à l’aise qu’un sybarite sur un lit de feuilles de roses. Sa propreté est traditionnelle. Pline l’a signalée, et Dubellay l’a célébrée dans l’épitaphe qu’il composa pour la tombe de son chat Bélaud :
Il avait cette honnêteté
De cacher dessous de la cendre
Ce qu’il était contraint de rendre.
Ajoutons que le chat ne devient jamais enragé spontanément.
Étudions maintenant notre sujet au point de vue de la sociabilité. Richelieu raffolait des chats. Montaigne avoue que les actions et les jeux de son chat étaient pour lui une récréation autant qu’une véritable étude. Colbert avait toujours, dans son cabinet ministériel, un troupeau de jeunes et folâtres chatons. Fontenelle, dès son enfance, adorait les chats ; un entre autres, qu’il plaçait dans un fauteuil, et à qui il débitait des discours pour s’exercer à parler en public. Un beau jour, ennuyé du rôle d’auditeur que son maître le forçait à jouer, ce chat, à bout de patience, se sauva et ne revint jamais.
Les philosophes du siècle dernier affirmaient, avec connaissance de cause sans doute, que le goût prononcé de certaines personnes pour les chats était l’indice d’un mérite supérieur. Témoin nos contemporains, dont l’affection pour les chats est de notoriété publique : Théophile Gautier, Albéric Second, Léon Gozlan, Champfleury, Théodore Barrière, Paul de Kock et quelques autres. Mme de la Sablière, qui avait passé une partie de sa vie au milieu des chiens, s’en défit un jour et les remplaça par autant de chats, tous noirs. Mme la duchesse du Maine composa un rondeau sur les mérites de son chat Marlamain. Mme de Lesdiguières fit élever un mausolée en marbre blanc à sa chatte morte vierge, et y fit graver ce quatrain :
Ci-git une chatte jolie :
Sa maîtresse, qui n’aima rien,
L’aima jusques à la folie.
Pourquoi le dire ?… on le voit bien.
Mme Deshoulières aussi a dit en l’honneur de sa chatte : « Quand mon mari s’absente Grisette me suffit. » Ronsard détesta d’abord les chats :
Homme ne vit qui tant haïsse au monde
Les chats que moi, d’une haine profonde.
Je hais leurs yeux, leur front et leur regard ;
En les voyant, je m’enfuis d’autre part.
Mais il revint bientôt à de meilleurs sentiments :
Mais parsus tout l’animal domestique,
Le chat a l’esprit prophétique ;
Et faisoient bien ces vieux Egyptiens
De l’honorer…
Est-ce assez d’exemples pour prouver la haute estime et l’amitié dont les chats ont été honorés ? Ajoutons cependant que la Bibliothèque impériale possède une médaille frappée en l’honneur d’un chat. L’exergue, autour de la tête, porte
chat noir ier, né en 1725
Sur le revers on lit :
sachant à qui je plais, connais ce que je vaux.
Si l’on envisage leur utilité et les services qu’ils rendent au genre humain, les chats ne peuvent être trop vantés. Le plus grand reproche qu’on puisse leur adresser, c’est de croquer quelques inoffensifs pierrots ; mais, en revanche, ils détruisent les immondes animaux qui rongent et empestent nos habitations.
L’Ile de Chypre, jadis, était infestée de serpents. Près de Bafa (Paphos), au cap des Chattes, s’élevait un monastère dont les religieux entretenaient autrefois une véritable armée de chats, élevés à faire la guerre aux reptiles qui pullulaient. Dès matines, les portes du couvent s’ouvraient, et les légions félines se répandaient dans la campagne. Le soir, aux premiers coups de l’angelus, qui annonçait le souper, les chats accouraient comme une fourmilière et rentraient dans le couvent, pour recommencer le lendemain. Les Turcs, en s’emparant de l’île, détruisirent le monastère.
 Richard Whittington, le fondateur de la Bourse actuelle de Londres, dut à un simple et modeste chat d’avoir la vie sauve, d’immenses richesses et les honneurs de l’édilité. Orphelin, sans fortune, il s’embarque comme mousse pour les Indes. Pour toute pacotille, il possédait un chat qu’il avait sauvé des flots de la Tamise. D’abord navigation heureuse, puis tempête, puis naufrage et perte du navire sur les côtes d’une île peuplée de cannibales, mais ravagée par les rats de la plus pitoyable façon. Sitôt que les naufragés sont amenés à terre, le premier mouvement du chat, en apercevant ses ennemis naturels, est de s’élancer sur eux, à la grande joie des indigènes, qui n’avaient jamais pu se débarrasser de ces animaux, aussi incommodes que sans gène. À la suite de cette première hécatombe de rats, qui fut bientôt suivie de beaucoup d’autres, et en reconnaissance de cet éminent service, les sauvages font grâce de la broche à tout l’équipage ; Richard est nommé premier ministre, et son chat généralissime des armées du roi. Quelques années après, Richard, prodigieusement enrichi parles libéralités de la nation, revint a Londres, où il fut bientôt nommé lord-maire. Son aventure connue, on ne l’appela plus que mylord Cat (mylord Chat), nom qu’il conserva et qui devint patronymique.
Richard Whittington, le fondateur de la Bourse actuelle de Londres, dut à un simple et modeste chat d’avoir la vie sauve, d’immenses richesses et les honneurs de l’édilité. Orphelin, sans fortune, il s’embarque comme mousse pour les Indes. Pour toute pacotille, il possédait un chat qu’il avait sauvé des flots de la Tamise. D’abord navigation heureuse, puis tempête, puis naufrage et perte du navire sur les côtes d’une île peuplée de cannibales, mais ravagée par les rats de la plus pitoyable façon. Sitôt que les naufragés sont amenés à terre, le premier mouvement du chat, en apercevant ses ennemis naturels, est de s’élancer sur eux, à la grande joie des indigènes, qui n’avaient jamais pu se débarrasser de ces animaux, aussi incommodes que sans gène. À la suite de cette première hécatombe de rats, qui fut bientôt suivie de beaucoup d’autres, et en reconnaissance de cet éminent service, les sauvages font grâce de la broche à tout l’équipage ; Richard est nommé premier ministre, et son chat généralissime des armées du roi. Quelques années après, Richard, prodigieusement enrichi parles libéralités de la nation, revint a Londres, où il fut bientôt nommé lord-maire. Son aventure connue, on ne l’appela plus que mylord Cat (mylord Chat), nom qu’il conserva et qui devint patronymique.
Les chats ayant de tout temps rendu service à l’espèce humaine, il devait nécessairement arriver un moment où celle-ci se montrerait ingrate. Aussi ont-ils été souvent victimes, ou de l’ignorance, ou des préjugés, ou de la mauvaise foi. Nous en citerons un exemple, dans lequel ces trois vices se trouvent réunis. Pendant une interminable suite d’années, et presque jusqu’à, la fin du xviiie siècle, à Metz, on célébrait annuellement sur la place publique une atroce cérémonie, dont les chats étaient les héros et les victimes. Les magistrats, assistés du clergé en habits de fête, apportaient une cage de fer remplie de chats. Ils la plaçaient au sommet d’un bûcher élevé par la populace, puis mettaient le feu aux fagots. Alors cette populace se gaudissait et se tordait de rire aux cris affreux et aux horribles convulsions des pauvres bêtes grillées vives. Qui avait inventé ces réjouissances publiques ? La légende lorraine dit que c’est en mémoire d’une sorcière qui, autrefois condamnée par les prêtres a périr dans les flammes expiatoires, s’était métamorphosée en chatte et sauvée au moment où on allait la tirer de prison pour la conduire au bûcher. La vérité est que la prétendue sorcière était jeune et jolie, qu’elle avait fait une vive impression sur le cœur du prélat en chef, et qu’elle préféra l’alcôve épiscopale aux fagots de l’intolérance. On sait que, jusqu’à la fin du viie siècle, les prêtres ne faisaient pas vœu de continence, et qu’ils pouvaient se marier. Pour donner satisfaction à l’opinion publique hébétée de cette époque et des époques qui suivirent, on immolait à chaque anniversaire une certaine quantité de chats pris au hasard ou offerts par la plèbe elle-même.
Cet usage, du reste, n’était pas particulier au pays messin. À Paris, le feu de la Saint-Jean s’allumait autour d’un mât élevé sur la place de Grève ; des chats, retenus dans un panier, étaient lâchés lorsque le feu flamboyait tout autour d’eux. Ils n’avaient de retraite possible que le mât au haut duquel ils grimpaient ; mais là, bientôt étouffés par la fumée, ils retombaient dans les flammes et y périssaient. Frédéric Soulié raconte une scène de ce genre dans un de ses romans. « Cependant, dit-il, le roi Charles IX était arrivé ; on lui avait remis une torche de cire blanche de deux livres, garnie de deux poignées de velours rouge. Sa Majesté, s’étant approchée de l’arbre de la Saint-Jean, en avait allumé les premiers fagots, puis était remontée à l’Hôtel de ville. Peu à peu le feu gagna les bourrées-cotrets et les tonneaux vides accumulés à une grande hauteur autour de l’arbre ; et alors, tandis que Michel Noiret, trompette juré du roi, et six compagnons trompettes jouaient des fanfares, on vit un spectacle réjouissant. Les chats, amarrés et retenus jusque-là au pied de l’arbre, se prirent à s’élancer dr toutes les façons, les uns grimpant jusqu’au plus haut de l’arbre pour retomber dans la fournaise allumée au pied, d’autres s’y précipitant de rage et s’y débattant avec des hurlements qui dominaient le bruit des trompettes. Tout à coup, du milieu des flammes, on vit s’élancer un maître chat qui gravit jusqu’à la plus fine pointe du mât, et qui, de cette hauteur, tournait autour de lui des yeux aussi flamboyants que le feu lui-même ; en même temps, on entendit par-dessus les rires de la multitude la voix d’une vieille femme qui criait de toutes ses forces : « Le voilà, Martial ! mon chat Martial, Martial ! Martial ! » La vieille avait reconnu son chat. L’animal reconnut aussi la voix de sa maîtresse, car, au moment où il était près de disparaître dans les tourbillons de flammes, il s’élança d’un bond prodigieux et tomba au delà du cercle de feu qui entourait l’arbre. Les sergents qui veillaient autour pour l’attiser voulurent frapper le chat, mais il s’enfuit du côté de sa maîtresse, au milieu des rires de la cour et du peuple, ravis de voir cet animal sauvé par son intrépidité. »
Au moyen âge, avouons-le, chez les nations chrétiennes, la gent féline n’était pas à beaucoup près aussi estimée que chez les peuples infidèles. On croyait que les chats assistaient au sabbat, qu’ils y dansaient avec les sorcières, et que celles-ci, de même que le diable leur maître, prenait volontiers la forme et la figure de cet animal. On lit à ce sujet, dans la Démonomanie de Bodin, que des sorciers de Vernon s’assemblaient ordinairement en très-grand nombre dans un vieux château, sous la forme de chats : quatre hommes qui avaient résolu d’y coucher se trouvèrent assaillis par cette multitude de chats ; l’un d’eux y fut tué, les autres blessés. Les prétendus sorciers furent poursuivis, et, par conséquent, condamnés.
Aujourd’hui encore, une horrible coutume que la Révolution n’a pas abolie, c’est la manie qu’ont certaines personnes de faire mutiler leurs chats. Nous savons que jadis le prêtre de Cybèle, après cette opération, n’en était que plus considéré ; mais le chat qui a subi cet outrage est en butte aux mauvais traitements des autres chats et au mépris des chattes ; car les chattes ne sont pas du même sentiment que l’amante d’Abailard, qui avait assez de philosophie pour écrire : « Le cœur fait tout, disait-elle ; le reste est inutile ! » Les chattes sont plutôt de l’avis de Psyché :
Encor si j’ignorais la moitié de tes charmes !
Mais je les ai tous vus ! j’ai vu toutes les armes
Qui te rendent vainqueur.
Au xviie et au xviiie siècle, les chaudronniers avaient la spécialité de ces sortes de mutilations. Après 1793, ce furent les frotteurs d’appartements, les écrivains publics, les cardeurs de matelas et les tondeurs de chiens, qui héritèrent de ce triste privilège. La mutilation ne s’opérait que sur les mâles ; mais la deuxième moitié du xixe siècle a vu apparaître la castration des chattes. À propos des chattes, Aristote, qui a dit tant de bonnes choses, a commis cette sottise : « Les chattes ayant beaucoup plus de tempérament que les chats, bien loin d’avoir la force de leur tenir rigueur, leur font d’éternelles agaceries, sans ménagement, sans pudeur, au point même qu’elles en viennent quelquefois à la violence. » C’est une affreuse calomnie. L’anecdote suivante est de beaucoup plus probable : Une chatte avait un rendez-vous avec un chat qu’elle aimait d’amour tendre. Chatte ne parlait pas, chat ne répondait rien, mais leurs cœurs battaient à l’unisson, et tous deux se comprenaient. Tout à coup une souris paraît d’aventure ; le chat court après elle, la saisit, la happe, et, tout en la croquant, oublie sa Dulcinée. Chatte, piquée dans son amour-propre, se promit bien que pareil affront ne lui arriverait plus. Voici ce qu elle imagina : chaque fois qu’elle était en tête-à-tête avec son amant, elle poussait de temps en temps de grands cris, histoire d’effrayer les souris et de les empêcher de venir troubler ses amours.
Voici une légende indienne sur la véritable origine du chat : « Les premiers jours que les animaux furent renfermés dans l’arche, étonnés du mouvement de la barque et de la nouvelle demeure qu’ils habitaient, ils restèrent chacun dans leur ménage sans trop s’informer de ce qui se passait chez leurs voisins. Le singe fut le premier qui s’ennuya de cette vie sédentaire : il alla faire quelques agaceries à une jeune lionne du voisinage. Cet exemple, immédiatement suivi, répandit dans l’arche un esprit de coquetterie qui dura pendant tout le séjour qu’on y fit, et que quelques animaux ont encore gardé sur la terre. Il se fit dans différentes espèces un nombre étonnant d’infidélités, qui donnèrent naissance à des animaux inconnus jusqu’alors. Ce fut des amours du singe et de la lionne que naquirent un chat et une chatte, qui, par une différence bien marquée avec les autres animaux, nés comme eux des galanteries qui se passèrent dans l’arche, acquirent en naissant la faculté de multiplier leur espèce. » Quoi qu’il en soit de cette origine, il est certain que si le chat a quelques-unes des qualités du singe, il a beaucoup de celles du lion, le chat d’Europe surtout. Les chats persans (angoras) sont les plus beaux de tous les chats. Ils furent importés en Italie, en 1551, par Pietro del Lavale. Un siècle plus tard, Ménard enleva de Rome et passa en contrebande une chatte angora qu’il apporta en France.
Du Bellay prétend qu’il y a des chats qui ont les yeux couleur de l’arc-en-ciel ; évidemment il a dû rencontrer un phénomène ou avoir une hallucination. Les yeux pers suffisent à la gloire des chats ; pers, c’est-à-dire verts et changeants : « la déesse aux yeux pers, » a dit La Fontaine pour désigner Minerve. Les yeux verts humains ne changent pas de nuance, tandis que les yeux félins ont des augmentations et des dégradations de couleur qui constituent les yeux pers. Les yeux pers passent pour inspirer de grandes passions : la dame de Fayel, à qui, sous Philippe-Auguste, un mari jaloux fit manger le cœur de son amant, avait les yeux pers.
Les biographes du chat, depuis le grand naturaliste jusqu’au très-spirituel M. Toussenel, se sont montrés sévères pour le héros dont ils ont raconté la vie, et c’est une sorte de réhabilitation que nous entreprenons ici. Que l’on accueille donc à titre de fantaisie les deux portraits suivants que nous tirons de notre journal l’École normale, et qui ont dû être imités, en majeure partie, de deux auteurs dont nous ne nous rappelons plus les noms.*
Les chats.
« On a généralement mauvaise opinion de leur caractère, et leurs griffes leur ont fait beaucoup d’ennemis ; mais il faudrait aussi nous rendre justice : s’ils sont méchants, nous ne sommes pas très-bons. On les accuse d’égoïsme, et c’est nous, hommes, qui leur faisons ce reproche ! Ils sont fripons, mais pourrions-nous affirmer que ce ne sont pas nos mauvais exemples qui les ont gâtés ? Ils flattent par intérêt, et nous disons, avec un de nos plus spirituels écrivains, que le chat ne nous caresse pas, qu’il se caresse à nous ; mais y a-t-il beaucoup de flatteurs désintéressés ? Nous-mêmes, à chaque instant, nous aimons, nous provoquons l’adulation. Pourquoi donc leur ferions-nous un crime, à eux, de ce qui, à nos yeux, est le plus grand des mérites ? Je ne parlerai point ici de leur grâce ni de leur gentillesse ; je ne dépeindrai point ces minauderies enfantines, à l’aide desquelles ils savent si bien nous intéresser et nous plaire ; des motifs plus puissants ‘militent en leur faveur. Si nous détruisions les chats, qui mangerait les souris qui grugent nos greniers ? Nous comptons sur nos souricières ; mais il y a longtemps que les souris, plus malignes que nous, savent se garantir des pièges que nous leur tendons. Il faudrait donc nous attendre à voir au premier jour la cent trotte-menu ronger impunément tous les livres de nos bibliothèques ? D’où nous concluons que, détruire les chats, ce serait rétablir le vandalisme en France. Mais nous consentons même à fermer les yeux sur les souris. Songeons au moins qu’un ennemi cent fois plus terrible nous menace : les rats, à qui les chats imposent encore une certaine contrainte, les rats sont aux aguets : ils n’attendent que le moment où nous aurons détruit les chats pour entrer en campagne et venir s’établir dans nos habitations, que nous serons forcés, oui, que nous serons forcés de leur abandonner. Catilina est à nos portes, et nous délibérons ! »
À mon chat.
« Mon joli petit minet, il est temps que je te paye le tribut d’éloges que tu mérites. On vante si souvent des gens qui ne te valent pas ; pourquoi rougirais-je de donner de la publicité à toutes tes perfections ? Tu es fait à peindre : les nuances les plus délicates colorent ta robe de tigre, tes yeux sont vifs et doux, ton regard est velouté, ta queue est d’une beauté qui fait envie ; ton agilité, tes grâces et ta souplesse sont admirables ! Tes qualités morales ne sont pas moindres ; tâchons de les récapituler. D’abord tu m’aimes beaucoup, ou, du moins, tu me caresses beaucoup, ce qui, pour bien des gens, revient au même. Je sais bien que tu m’aimes moins qu’une tranche de gigot ou une cuisse de poulet ; mais cela est tout simple : je suis ton maître, et un gigot vaut une fois mieux qu’un maître, deux fois mieux que deux maîtres, etc. Tu as beaucoup d’esprit, et le meilleur esprit, car tu as précisément celui qui t’est utile ; tout autre genre d’esprit te paraîtrait une sottise. La nature t’a donné des ongles que nous nommons impoliment des griffes, et ils sont d’une structure admirable, bien emboîtés dans une membrane qui rentre ou sort comme les doigts d’un gant ; tu fais à volonté griffe menaçante ou patte de velours.
Tu sais bien que tu n’as pas de griffes pour t’en servir, mais que tu t’en sers parce que tu en as. Tu ne crois point aux causes finales : mon chat, tu es un grand philosophe.
Tu ne connais que le bien et le mal physique. Un chat qui en étranglerait un autre ne te paraîtrait pas plus coupable qu’un homme qui tue des hommes : mon chat, le grand Hobbes ne pensait pas mieux que toi.
Tu flattes le maître qui te caresse, tu caresses la bonne qui fait ta pâtée, tu fuis à l’aspect d’un gros animal, tu te jettes audacieusement sur les petites bêtes : mon chat, tu es un profond politique.
Tu vis fraternellement avec le chien ton commensal ; par reconnaissance pour moi, tu fais accueil a toutes les personnes pour qui j’ai de la bienveillance ; tu présentes la griffe à ceux à qui tu supposes de mauvaises intentions, et tu dresses la queue pour mes amis : mon chat, tu es un grand moraliste.
Quand tu promènes tes grâces sur un toit, tu portes adroitement la masse de ton corps à l’opposé du danger, tes muscles se tendent ou se relâchent avec discernement, et tu trouves la sécurité là où tant d’autres bêtes seraient transies de frayeur : mon chat, tu connais parfaitement la statique des corps.
Si, par inadvertance, étourderie ou précipitation, tu manques de point d’appui, c’est alors que tu es admirable : tu te courbes en enflant ton dos, tu portes le centre de gravité vers la région de l’ombilic, et, par ce moyen, tu retombes toujours sur tes pattes : mon chat, tu es un excellent physicien.
Voyages-tu dans l’obscurité ; tu épanouis la prunelle de ton œil, tu en fais un cercle parfait pour présenter une plus large surface et recueillir la plus grande somme de rayons lumineux épars dans l’atmosphère. Parais-tu au grand jour ; ta prunelle prend une forme elliptique, se rétrécit et ne reçoit qu’une partie des rayons, dont la trop grande abondance blesserait ta rétine : mon chat, tu es un parfait opticien.
Quand tu veux franchir un précipice, tu calcules la distance avec une justesse inexprimable. D’abord tu piétines, comme pour mesurer l’espace que tu divises dans ton raisonnement par les mouvements de tes pattes, puis tu t’élances juste sur le lieu désigné, dont tu as comparé l’éloignement à l’effort de tes muscles : mon chat, tu es un savant géomètre.
T’égares-tu dans la campagne ; tu examines les plantes avec un soin minutieux, tu distingues la cataire qui te plaît, tu te roules sur elle, et tu témoignes ta joie par mille gambades ; tu connais aussi toute la famille des graminées, qui sont pour toi la panacée universelle et qui te purgent merveilleusement : mon chat, tu es un bon botaniste.
Enfin , mon cher minet, qu’on me montre un homme qui en sache autant que toi dans tous les genres, je le proclame une encyclopédie vivante, un compendium des connaissances humaines. Mais, que vois-je ! je te loue, et tu t’endors…. Mon chat, c’est encore de la philosophie. »
Puisque nous voilà en pleine fantaisie, restons-y le plus longtemps possible. Cela fera trêve un moment à ces longues excursions que l’ordre alphabétique nous contraint d’entreprendre dans le domaine de l’économie politique et sociale, politique surtout, chemin difficile et raboteux, semé de casse-cou et de chausse-trapes, par ce temps béni de liberté de la presse, où, si l’on en croit Beaumarchais, il est permis de tout dire, à la condition expresse de ne parler de rien ni de personne. Ici, notre fantaisie va consister à donner la parole à Mlle Cosette, gracieuse petite chatte dont notre ami Alfred Deberle a fait dernièrement cadeau à notre bébé, portant au cou, à titre d’introduction et attachée à un ruban rose, la missive suivante, qu’elle avait sans doute griffonnée sous la dictée de notre spirituel collaborateur.
« Paris, ce 12 février 1868.
Mademoiselle Antonine,
C’est toute confiante en votre bon petit cœur que je mets la patte à la plume et que viens, en faisant le gros dos, comme il convient à une chatte honnêtement élevée, vous supplier de prendre ma tendre jeunesse en considération.
Je m’appelle Cosette et suis âgée d’un an, j’ai d’assez beaux yeux, une oreille passable, le museau rose, les dents blanches, une taille avantageuse. J’aime le jeu passionnément, et je ne quitte jamais la partie que si l’on triche. Mes mœurs sont douces, mon caractère porté à la bienveillance, et l’on me vit plus d’une fois revenir la première après une fâcherie.
Inutile d’ajouter que je suis de bonne maison, ayant des parents au Grand Dictionnaire universel du xixe siècle.
Je ne vous cacherai point qu’on me prête quelques défauts, et, puisque entre fillettes on se dit tout, c’est ici le cas de vous miauler, mademoiselle, un petit bout de confession.
Et d’abord je ressemble au chien fameux de Jean de Nivelle, je m’enfuis… vous devinez le reste. Mais si, d’aventure, une souris mal avisée se permet une promenade sur mes domaines ou vient faire sa toilette à mon nez, à ma barbe, crac ! en un tour de griffes j’envoie son âme au diable. C’est ainsi que , toute fausse modestie à part, je puis, quoique fort jeune, revendiquer d’assez jolis états de service en ce genre. Permettez-moi d’ajouter que cette même griffe, qui sait être terrible en temps de guerre, devient douce, mignonne et caressante en temps de paix : je n’ai pas ma pareille pour faire patte de velours, et je veux mourir à l’instant si j’ai jamais causé le moindre dommage au visage de mes amis.
Mais revenons à mes défauts. Aussi bien, j’ai hâte d’en finir avec eux, craignant de vous inspirer, en vous les contant, de l’éloignement pour moi. Ah ! mademoiselle, ne me condamnez pas à me repentir toute ma vie d’avoir été franche avec vous. On m’a dit tant de bien de votre personne que j’ai juré, foi de Cosette ! de passer mes jours à vous aimer et à vous servir. Certes, ce n’est pas moi qui glisserai sournoisement sur mes péchés comme pour avoir l’air de dire : « Bah ! c’est peu de chose ! » Je souhaite pourtant que celui de tous qui me coûte le plus à avouer vous trouve compatissante. J’ai assez vécu, made moiselle, pour savoir que les chats aussi bien que les hommes aiment à retrouver chez leurs amis les défauts qui leur sont familiers. J’aimerais donc, moi aussi… Mais vous ne le connaissez pas, j’en suis certaine, cet affreux péché qui me jette toute confuse, oreilles basses, à vos genoux… — Donc, je suis gourmande. — Le mot est lâché !… Oui, mon petit museau qui n’a pas l’air d’y toucher est friand de bonnes choses. Est-ce à dire que je suis voleuse ? Non. Je fais ronron devant le buffet mais ne m’y introduis jamais… pourvu que les portes en soient hermétiquement fermées.
Vous dirai-je aussi que je suis curieuse ? toutes les personnes de mon sexe le sont. Mon père n’est que paresseux, moi, je suis fainéante, le commerce des philosophes dont j’ai grignoté les livres — au moment où les dents me poussaient — m’ayant enseigné qu’il faut tendre en toutes choses à surpasser son père. Or, je surpasse de beaucoup le mien, moi ! Vous verrez donc comme je m’allonge bien sur les tapis, tantôt couchée sur le ventre, tantôt sur le côté, le nez entre les pattes, parfois même étendue sur le dos, regardant voler les mouches, dont je raffole.
Ajouterai-je, maintenant que mes défauts sont étalés sous vos jolis yeux, que j’ai au moins une qualité qui les efface tous, si bien que mon départ a fait verser des larmes ? Pourquoi pas ? Eh bien ! donc, mademoiselle, sans entrer dans des détails de propreté qui seraient d’ailleurs tout à mon avantage, soyez-en persuadée, sachez que je sais aimer qui me caresse, et que j’ai au fond de mon cœur de chatte des trésors de reconnaissance avec lesquels j’ai l’honneur d’être,
Mademoiselle,
Votre très-dévouée et très-respectueuse servante
Cosette.
Pour copie conforme
Alfred Deberle.
P. S. — J’oubliais. Mon plus grand bonheur, après celui de vous aimer, est de tremper légèrement l’extrémité de ma patte dans un encrier et de la poser ensuite sur une belle page blanche. J’obtiens ainsi d’admirables résultats. Un savant de mes amis, lunettes sur le nez, s’y est trompé tout dernièrement, et a pris un morceau de ma façon pour la page détachée d’un manuscrit arabe du xe siècle. Cela m’amène à vous dire que j’écris comme un chat, mais que j’aime comme un chien. »
Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle. Extrait de l’article « Chat ». Paris, 1867.
_________
* On retrouve ce texte, écrit une fois à la troisième, et une fois à la première personne, dans Le livre des permutations, petits exercices d’orthographe en texte suivi sans le secours de la méthode cacographique, du même Pierre Larousse, et publié quelque vingt ans plus tard, en 1885, à Paris.