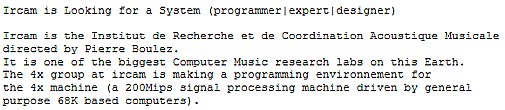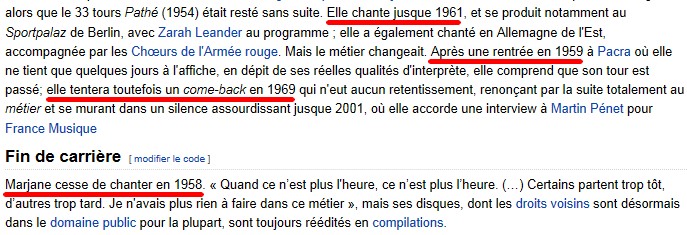Gaudriole

Le pantalon de Casimir, gaudriole populaire.
Paroles de Baumaine et Blondelet, musique de Ed. Deransart (détail). 1879. Source : Gallica.
Le mot de gaudriole (propos ou acte licencieux) serait apparu dans la première moitié du XVIIIe siècle par dérivation de gaudir (se réjouir, cf. la célèbre chanson Gaudeamus igitur) – qui a des connotations plus coquines dans les substantifs gaudisserie (caractère licencieux, paillard) et gaudisseur (jouisseur) –, et de la terminaison -iole que l’on trouve dans cabriole, qui dénote les « bonds légers et folâtres » qui peuvent se pratiquer lors de certaines gaudrioles.
Ainsi, les Mémoires pour servir à l’histoire des spectacles de la foire de Claude Parfait, publiées en 1743, mentionnent un « opéra comique d’un acte » intitulé Les Trois prologues, « dont le premier était effectivement le Prologue, la Gaudriole, ou le repas allégorique était le second, et l’Amphigourie, le dernier, le 30 juin 1739 ». On n’a pas trouvé trace (en ligne) de ce curieux repas.
Par contre, le mot apparaît dans deux textes – Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en médecine, de Julien Offray de la Mettrie et publié vers 1748, et La Faculté vengée, comédie en trois actes, attribuée au même La Mettrie et publiée en 1747. Cet auteur est un personnage particulièrement intéressant : philosophe matérialiste, le terme « âme » désigne pour lui seulement l’organe qui nous permet de penser, c’est-à-dire le cerveau. Il la conçoit donc comme étendue et matérielle. La Mettrie propose aussi une théorie morale fondée sur le matérialisme. À la morale sociale, il oppose une morale naturelle, la seule véritable, dans laquelle le bonheur est identifié à un ensemble de sensations agréables (ce qui, soit dit en passant, est à la base de l’utilitarisme de Jeremy Bentham« Par principe d’utilité, il faut entendre le principe qui approuve ou désapprouve quelque action que ce soit en fonction de sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie dont l’intérêt est en jeu. » (Bentham, 1789, cité par John Kenneth Galbraith in L’Art d’ignorer les pauvres.)). Les rechercher est conforme à la nature et à la raison. L’influence de La Mettrie a été considérable pour tout le courant matérialiste en philosophie, pour les idéologues, et notamment Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), dont les mémoires sur les Rapports du physique et du moral (1802) tentent d’approfondir la voie de La Mettrie. Les questions ouvertes par La Mettrie demeurent celles de la neurophysiologie contemporaine. (Source : Microsoft Encarta 99).
Le conte libertin que l’on trouvera ici, publié à la même période, s’intitulé tout simplement Gaudriole : c’est non seulement le nom d’une de ses protagonistes mais c’est surtout le propos du récit. Cette facétieuse nouvelle de la recherche – initiatique pour les uns, obsessionnelle pour les autres – de « cet » obscur objet du désir à tout âge met en scène les affres de l’âme et la jouissance des corps, les conflits entre raison et passion, le frustrant distinguo entre vouloir et pouvoir. Gaudriole, oui, mais pas grivoise, tout y est suggéré, et l’auteur semble parfois faire avec un malin plaisir du second degré avec cette littérature de genre. Ainsi, en y réfléchissant quelque peu, vous comprendrez rapidement l’étymologie du nom du fameux fruit chinois que convoitent les deux rivales.
Le récit oppose deux couples : l’un en voie de formation, si l’on peux dire, Arthénie, princesse jeune et (très) innocente et Zamor (on remarquera l’étendue de l’alphabet…), prince fidèle et généreux, à un couple de vieillards lubriques et roués, le mauvais génie Moragrandy qui convoite la princesse tout en étant impuissant, et Gaudriole son épouse, une laide fée qui règne sur une île à l’autre bout du monde, sur laquelle son mari va disperser les membres de son rival, dont l’un d’eux… mais comme le précise le titre du deuxième chapitre, vous en saurez plus quand vous l’aurez lu.
Quant à l’auteur de cette gaudriole, on ne le connaît pas : l’ouvrage a été publié anonymement à La Haye, une source l’attribuant à Claude Godard d’Aucourt (1716-1795) et une autre à François Antoine Chevrier (1721-1762).