Les murs ont des oreilles, ou, une ingénieuse invention
« Ni la crainte du despotisme, ni celle de l’enfer, ne peuvent étouffer les mille voix du passé qui s’élèvent de toutes parts. Non, non, elles parlent trop haut, ces voix terribles, pour que celle d’un prêtre leur impose silence ! Elles parlent à nos âmes dans le sommeil, par la bouche des spectres qui se lèvent pour nous avertir ; elles parlent à nos oreilles par tous les bruits de la nature ; elles sortent même du tronc des arbres, comme autrefois celle des dieux, dans les bois sacrés, pour nous raconter les crimes, les malheurs et les exploits de nos pères. »
— George Sand, Consuelo, 1845.
Rudolph Clausius (1822-1888) était un célèbre mathématicien et physicien allemand, et l’un des pères de la thermodynamique. Dans un de ses cours, il explique ainsi la nature du son : « [Un corps sonore produit musique, voix ou bruit en mettant] en mouvement l’air qui l’entoure, et en y produisant des vibrations qui se propagent à l’état d’ondes que nous percevons ensuite comme son. Inversement, les ondes qui se propagent dans l’air peuvent mettre en vibration un corps qu’elles viennent heurter. (…) Lorsque, dans l’air qu’on joue, se présentent des sons qui sont en rapport harmonique avec les sons que peut rendre un certain corps, celui-ci, entraîné par une espèce de sympathie, semble éprouver l’envie de mêler sa voix à la symphonie générale. (…) Lorsque le son principal aura cessé de résonner, on entendra encore distinctement le corps répéter le même son. »
Parmi ces « corps qu’elles viennent heurter », il y a, bien entendu, nos oreilles ; mais si l’on se trouve dans une pièce ou une salle, il y a aussi les murs de ces lieux. Or ces derniers ne font pas que réfracter les sons qui les frappent : de récents instruments de micromesure ont pu mettre en évidence les déformations occasionnées dans leur matière par ce choc et par l’absorption partielle des ondes sonores. Pour simplifier, on peut dire que ces parois, pour peu qu’elles ne soient pas indéformables (auquel cas elles renverraient parfaitement le son qui les frappe sans en être affectées) prennent alors la forme des sillons d’un disque vynile ; la matière conserve cette déformation (ce qui est tout de même plus facile à constater que la mémoire de cette déformation, cf. la théorie de la mémoire de l’eau de Benveniste, récemment ravivée par Montagnier).
Il suffit alors de pouvoir la lire pour restaurer, à nos oreilles, les musiques, les voix, les cris et les chuchotements dont ces murs ont été les témoins, finalement pas si muets que ça. Et même en stéréo (en relevant les tracés sur les murs à deux endroits différents de l’église). Imaginez pouvoir enfin écouter le concert d’inauguration que Bach avait donné à l’orgue de l’église d’Armstradt, ou l’apostrophe de Bonaparte à ses soldats du haut d’une pyramide (dont la pierre garde encore la trace) !
La réalisation est simple : elle se base sur un principe similaire à celui des techniques visuelles d’extraction du son des disques en vinyl, développées indépendamment par la Phonothèque nationale suisse, et par le laboratoire de physique américain Lawrence Berkeley, et qui permet de reproduire le son enregistré sur ces disques en en photographiant la surface. Dans les détails, il y a évidemment des différences : un disque n’est « fait » que pour enregistrer une seule œuvre, tandis que les murs d’une église, d’une salle de concert ou d’une pièce ont entendu, au fil du temps, un nombre important d’œuvres, de voix, de bruits qui s’y superposent. C’est là que se rajoutent des techniques d’archéologie sonore et de séparation des sources que l’on utilise surtout en astrophysique pour distinguer les bruits en provenance de la Galaxie.
C’est ainsi que la science met, de nouveau, à mal une idée reçue : verba volant, scripta manent. Tout en en confirmant une autre : les murs ont des oreilles. Caveat locutor !
L’art précède souvent la science, et les artistes, de Vinci à Verne, imaginent ce que les ingénieurs inventeront plus tard. C’est ainsi que la scénographie que Peter Greenaway a réalisée pour l’une des salles de la – splendide – Venaria Reale à Turin illustre de façon magique ce principe que nous venons de décrire : sur ses murs, on y voit des personnages du XVIIIe siècle évoluer en chuchotant, on entend le bruissement de leurs voix, les mots et les noms qu’ils se glissent insidieusement les uns aux autres : c’est la rumeur, ce bruit qui se perpétue bien après que ses sujets aient disparus et qui ne s’éteint pas, inscrit à jamais sur les parois de ce salon…


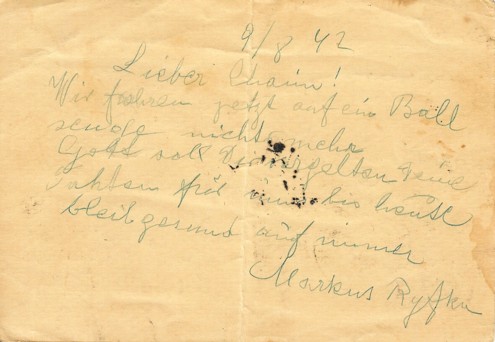
 Madeleine Brohan, « fille de cette Suzanne Brohan tant aimée, tant applaudie, et la sœur d’Augustine, la comédienne par excellence, un écrivain sans le vouloir, une grande dame dans son salon, une femme unique »1 est une actrice précoce : « Dans un feuilleton dramatique de cette époque, nous lisons qu’elle avait alors dix-sept ans [à ses débuts remarqués dans Les Contes de la Reine de Navarre, pièce écrite pour elle par Eugène Scribe]… Est-ce possible ? puisqu’elle n’en a que vingt-cinq aujourd’hui, seize ans plus tard. »1
Madeleine Brohan, « fille de cette Suzanne Brohan tant aimée, tant applaudie, et la sœur d’Augustine, la comédienne par excellence, un écrivain sans le vouloir, une grande dame dans son salon, une femme unique »1 est une actrice précoce : « Dans un feuilleton dramatique de cette époque, nous lisons qu’elle avait alors dix-sept ans [à ses débuts remarqués dans Les Contes de la Reine de Navarre, pièce écrite pour elle par Eugène Scribe]… Est-ce possible ? puisqu’elle n’en a que vingt-cinq aujourd’hui, seize ans plus tard. »1 À lire les critiques de l’époque, elle était aussi connue pour son esprit, non seulement sur scène mais à la ville. La citation en exergue est intemporelle et résonne avec le propos d’une belle nouvelle d’Oscar Wilde. Elle s’applique de façon lapidaire – et quasi littérale – aux habitués de la salle de sport du quartier. Ces armoires à glace, qu’elles soient trapues ou hautes, sont pour la plupart d’un mutisme (de glace, même dans le sauna) à l’égard de tout inconnu qui les saluerait (ce qu’elles ne font jamais d’elles-mêmes) lorsqu’il les croise à l’entrée ou les côtoie dans le petit espace vital du vestiaire. Rarement, un grognement en guise de réponse, sans même se retourner vers l’interlocuteur. Mais entre elles, ces armoires se mettent à babiller d’une voix de tête toute aussi surprenante que leur silence. Rien à voir avec la diction élégante et la sobriété du geste de Madeleine Brohan…
À lire les critiques de l’époque, elle était aussi connue pour son esprit, non seulement sur scène mais à la ville. La citation en exergue est intemporelle et résonne avec le propos d’une belle nouvelle d’Oscar Wilde. Elle s’applique de façon lapidaire – et quasi littérale – aux habitués de la salle de sport du quartier. Ces armoires à glace, qu’elles soient trapues ou hautes, sont pour la plupart d’un mutisme (de glace, même dans le sauna) à l’égard de tout inconnu qui les saluerait (ce qu’elles ne font jamais d’elles-mêmes) lorsqu’il les croise à l’entrée ou les côtoie dans le petit espace vital du vestiaire. Rarement, un grognement en guise de réponse, sans même se retourner vers l’interlocuteur. Mais entre elles, ces armoires se mettent à babiller d’une voix de tête toute aussi surprenante que leur silence. Rien à voir avec la diction élégante et la sobriété du geste de Madeleine Brohan… Albert Bataille relate l’affaire dans ses Causes criminelles et mondaines de 1882. Le président de la cour d’Assises devant lequel ils ont comparu, Anatole Bérard des Glajeux, en parle dans ses souvenirs. Elle est reprise après guerre dans la série de bandes dessinées à épisodes Le Crime ne paie pas publiées dans France-Soir dans les années cinquante, et c’est un des quatre épisodes du
Albert Bataille relate l’affaire dans ses Causes criminelles et mondaines de 1882. Le président de la cour d’Assises devant lequel ils ont comparu, Anatole Bérard des Glajeux, en parle dans ses souvenirs. Elle est reprise après guerre dans la série de bandes dessinées à épisodes Le Crime ne paie pas publiées dans France-Soir dans les années cinquante, et c’est un des quatre épisodes du 