Labyrinthes : l’Irlande
 e Book of Kells est une floraison de formes animales entremêlées et stylisées, de petites figures simiesques au milieu d’un feuillage inextricable qui recouvre des pages et des pages, comme pour suivre les motifs toujours identiques d’une tapisserie ; là où — en réalité — chaque ligne, chaque corymbe représente une invention différence. C’est une complexité tout en spirales qui vagabonde, ignorant intentionnellement toute règle de symétrie disciplinée, une symphonie de couleurs délicates, du rose au jaune orange, du jaune citron au rouge violacé. Des quadrupèdes, des oiseaux, des lévriers qui jouent avec le bec d’un cygne, d’inimaginables figures humanoïdes en vrille comme un athlète équestre qui, la tête entre les genoux, se contorsionne jusqu’à former une lettre initiale, des êtres malléables et flexibles comme des élastiques qui s’introduisent dans un enchevêtrement d’entrelacs, qui poussent leurs têtes à travers des décorations abstraites, qui s’enroulent autour des lettres initiales en s’insinuant entre les lignes. La page ne s’arrête jamais sous notre regard, mais elle semble prendre vie d’elle-même, il n’y a point de point de repère, toute chose est mêlée à toute autre chose. Le Book of Kells est le royaume de Protée. C’est le produit d’une hallucination froide qui n’a pas besoin de mescaline ou d’acide lysergique pour créer ses abysses, parce qu’aussi il ne représente pas le délire d’un individu isolé mais plutôt le délire d’une culture tout entière engagée dans un dialogue avec elle-même, citant d’autres Évangiles, d’autres lettres enluminées, d’autres récits.
e Book of Kells est une floraison de formes animales entremêlées et stylisées, de petites figures simiesques au milieu d’un feuillage inextricable qui recouvre des pages et des pages, comme pour suivre les motifs toujours identiques d’une tapisserie ; là où — en réalité — chaque ligne, chaque corymbe représente une invention différence. C’est une complexité tout en spirales qui vagabonde, ignorant intentionnellement toute règle de symétrie disciplinée, une symphonie de couleurs délicates, du rose au jaune orange, du jaune citron au rouge violacé. Des quadrupèdes, des oiseaux, des lévriers qui jouent avec le bec d’un cygne, d’inimaginables figures humanoïdes en vrille comme un athlète équestre qui, la tête entre les genoux, se contorsionne jusqu’à former une lettre initiale, des êtres malléables et flexibles comme des élastiques qui s’introduisent dans un enchevêtrement d’entrelacs, qui poussent leurs têtes à travers des décorations abstraites, qui s’enroulent autour des lettres initiales en s’insinuant entre les lignes. La page ne s’arrête jamais sous notre regard, mais elle semble prendre vie d’elle-même, il n’y a point de point de repère, toute chose est mêlée à toute autre chose. Le Book of Kells est le royaume de Protée. C’est le produit d’une hallucination froide qui n’a pas besoin de mescaline ou d’acide lysergique pour créer ses abysses, parce qu’aussi il ne représente pas le délire d’un individu isolé mais plutôt le délire d’une culture tout entière engagée dans un dialogue avec elle-même, citant d’autres Évangiles, d’autres lettres enluminées, d’autres récits.
 l est le vertige lucide d’une langue qui essaie de redéfinir le monde tandis qu’elle se redéfinit elle-même avec la pleine conscience que, dans un âge encore incertain, la clé de la révélation du monde ne peut être trouvée dans la ligne droite mais bien dans le labyrinthe.
l est le vertige lucide d’une langue qui essaie de redéfinir le monde tandis qu’elle se redéfinit elle-même avec la pleine conscience que, dans un âge encore incertain, la clé de la révélation du monde ne peut être trouvée dans la ligne droite mais bien dans le labyrinthe.
 e n’est donc pas par un hasard si tout cela a inspiré Finnegans Wake au moment où Joyce tentait de réaliser un livre qui représenterait à la fois une image de l’univers et une œuvre pour un « lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale ». (…)
e n’est donc pas par un hasard si tout cela a inspiré Finnegans Wake au moment où Joyce tentait de réaliser un livre qui représenterait à la fois une image de l’univers et une œuvre pour un « lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale ». (…)
 ue représente donc le Book of Kells ? L’antique manuscrit nous parle d’un monde fait de sentiers qui bifurquent en des directions opposées, d’aventures de l’esprit et de l’imagination qui ne peuvent être décrites. Il s’agit d’une structure où chaque point peut être relié à n’importe quel autre point, où il n’y a pas de points ou de positions mais seulement des lignes de raccord, chacune d’entre elles pouvant être interrompue à n’importe quel moment puisqu’elle reprendra aussitôt et suivra le même parcours. Cette structure n’a ni centre ni périphérie. Le Book of Kells est un labyrinthe. C’est la raison pour laquelle il a pu devenir, dans l’esprit excité de Joyce, le modèle de ce livre infini encore à écrire, lisible uniquement par un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale.
ue représente donc le Book of Kells ? L’antique manuscrit nous parle d’un monde fait de sentiers qui bifurquent en des directions opposées, d’aventures de l’esprit et de l’imagination qui ne peuvent être décrites. Il s’agit d’une structure où chaque point peut être relié à n’importe quel autre point, où il n’y a pas de points ou de positions mais seulement des lignes de raccord, chacune d’entre elles pouvant être interrompue à n’importe quel moment puisqu’elle reprendra aussitôt et suivra le même parcours. Cette structure n’a ni centre ni périphérie. Le Book of Kells est un labyrinthe. C’est la raison pour laquelle il a pu devenir, dans l’esprit excité de Joyce, le modèle de ce livre infini encore à écrire, lisible uniquement par un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale.
 ais en même temps, le Books of Kells (avec Finnegans Wake, son descendant) représente le modèle de la langue humaine et, peut-être, celle du monde où nous vivons. Peut-être vivons-nous à l’intérieur d’un Livre de Kells en croyant vivre dans l’Encyclopédie de Diderot. Le Book of Kells ainsi que Finnegans Wake sont la meilleure image de l’univers tel qu’il est présenté par la science contemporaine. Ils sont le modèle d’un univers en expansion, peut-être fini et pourtant illimité, le point de départ d’interrogations infinies. Ce sont des livres qui nous permettent de nous sentir des hommes et des femmes de notre temps même si nous naviguons sur la même mer dangereuse à la recherche de cette île Perdue que le Book of Kells chante à chaque page, tandis qu’il nous invite et nous pousse à continuer notre recherche pour arriver à exprimer de manière parfaite le monde imparfait où nous vivons.
ais en même temps, le Books of Kells (avec Finnegans Wake, son descendant) représente le modèle de la langue humaine et, peut-être, celle du monde où nous vivons. Peut-être vivons-nous à l’intérieur d’un Livre de Kells en croyant vivre dans l’Encyclopédie de Diderot. Le Book of Kells ainsi que Finnegans Wake sont la meilleure image de l’univers tel qu’il est présenté par la science contemporaine. Ils sont le modèle d’un univers en expansion, peut-être fini et pourtant illimité, le point de départ d’interrogations infinies. Ce sont des livres qui nous permettent de nous sentir des hommes et des femmes de notre temps même si nous naviguons sur la même mer dangereuse à la recherche de cette île Perdue que le Book of Kells chante à chaque page, tandis qu’il nous invite et nous pousse à continuer notre recherche pour arriver à exprimer de manière parfaite le monde imparfait où nous vivons.

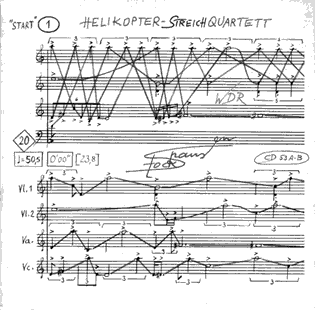
 Vendredi, c’était un enregistrement du quatuor Arditti en plein vol qui était diffusé dans l’Espace de projection de l’Ircam, la salle à acoustique variable située sous la fontaine de Nikki de Saint Phalle, lieu idéal pour cette diffusion — le son était partout, on semblait percevoir les hélicoptères s’élever dans le ciel. Cette musique accompagnait une chorégraphie d’
Vendredi, c’était un enregistrement du quatuor Arditti en plein vol qui était diffusé dans l’Espace de projection de l’Ircam, la salle à acoustique variable située sous la fontaine de Nikki de Saint Phalle, lieu idéal pour cette diffusion — le son était partout, on semblait percevoir les hélicoptères s’élever dans le ciel. Cette musique accompagnait une chorégraphie d’ Cette œuvre était précédée de Centaures (créée en 1998), un duo masculin torse nu, collants et lanières de cuir, sur une musique (très belle) de György Ligeti, qui, si elle était esthétiquement très léchée (voire tendre et sensuelle à certains moments), était encore plus froide que l’autre, et n’“allait” nulle part, c’étaient des scénettes qui m’ont fait penser à certains passages de Fantasia et non pas à l’après-midi d’un Faune inimitable (même en le doublant on n’y pensait vraiment pas)… Ça volait moins haut que les hélicoptères, pour sûr.
Cette œuvre était précédée de Centaures (créée en 1998), un duo masculin torse nu, collants et lanières de cuir, sur une musique (très belle) de György Ligeti, qui, si elle était esthétiquement très léchée (voire tendre et sensuelle à certains moments), était encore plus froide que l’autre, et n’“allait” nulle part, c’étaient des scénettes qui m’ont fait penser à certains passages de Fantasia et non pas à l’après-midi d’un Faune inimitable (même en le doublant on n’y pensait vraiment pas)… Ça volait moins haut que les hélicoptères, pour sûr. Afrique du sud, Belarus, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suisse sont les pays d’origine ou de nationalité des
Afrique du sud, Belarus, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suisse sont les pays d’origine ou de nationalité des 
 J’aime la danse contemporaine. Enfin, je l’ai cru pendant longtemps. Depuis le jour où j’ai vu, au ciné-club de la fac américaine où je faisais mes études le film documentaire Making Dances : Seven Post-Modern Choreographers de Michael Blackwood. J’y avais découvert avec émerveillement le travail de
J’aime la danse contemporaine. Enfin, je l’ai cru pendant longtemps. Depuis le jour où j’ai vu, au ciné-club de la fac américaine où je faisais mes études le film documentaire Making Dances : Seven Post-Modern Choreographers de Michael Blackwood. J’y avais découvert avec émerveillement le travail de  C’est à mon arrivée à Paris que j’ai pu voir les spectacles de ces chorégraphes, principalement durant le
C’est à mon arrivée à Paris que j’ai pu voir les spectacles de ces chorégraphes, principalement durant le 