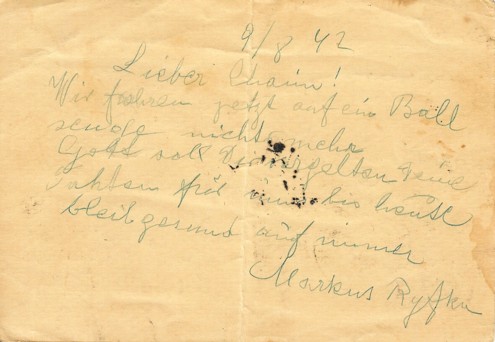1555
Premièrement, Dieu créa le ciel et la terre. Et comme la terre était néante et lourde, et ténèbres par-dessus l’abîme, et que l’esprit de Dieu se balançait par-dessus les eaux, Dieu dit : Lumière soit. Et lumière fut. Et Dieu, voyant que la lumière était bonne, sépara la lumière des ténèbres, et appela Dieu la lumière jour et les ténèbres, nuit. Si fut fait de soir et matin le premier jour.
Sébastien Castellion, La Bible nouvellement translatée avec la suite de l’histoire depuis le temps d’Esdras jusqu’aux Maccabées : et depuis les Maccabées jusqu’à Christ. Item avec des annotations sur les passages difficiles. Bayard, 2005.
1815
Premièrement-en-principe, il-créa, Ælohîm (il détermina en existence potentielle, lui-les-Dieux, l’Être-des-êtres), l’ipséité-des-cieux et-l’ipséité-de-la-terre. Et-la-terre existait puissance-contingente-d’être dans-une-puissance-d’être : et-l’obscurité (force compressive et durcissante) -était sur-la-face de-l’abîme (puissance universelle et contingente d’être) ; et-le-souffle de-lui-les-Dieux (force expansive et dilatante) était-générativement-mouvant sur-la-face des-eaux (passivité universelle). Et-il-dit (déclarant sa volonté), lui-l’Être-des-êtres : sera-faite-lumière ; et-(sera)-fut-faite lumière (élémentisation intelligible). Et-il-considéra, lui-les-Dieux, cette lumière comme bonne ; et-il-fit-une-solution (il détermina un moyen de séparation) lui-les-Dieux, entre la-lumière (élémentisation intelligible) et entre l’obscurité (force compressive et durcissante). Et-il-assigna-nom, lui-les-Dieux, à-la-lumière, Jour (manifestation universelle) ; et-à-l’obscurité, il-assigna-nom Nuit (négation manifestée, nutation des choses) : et-fut-occident, et-fut-orient (libération et itération) ; Jour premier (première manifestation phénoménique).
Fabre-d’Olivet, « Cosmogonie », La Langue hébraïque restituée, et le véritable sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse radicale. Éd. l’Âge d’homme, 1991.
1899
Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face de l’abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière Jour, et les ténèbres, il les appela Nuit. Il fut soir, il fut matin, — un jour.
La Bible traduite du texte original par les membres du rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn, grand rabbin. Librairie Durlacher, 1952.
Au galaffe, Dieu avait créé l’freumion et l’carette. Or, l’mine ed’ charbon n’était que cholitude et chaos ; ed’ ténèbres couvraient l’quenoule ed’ l’abîme, et l’glou-bec ed’ Dieu planait chur l’quenoule ed’ eaux. Dieu dit : « Que l’carabistoulle choit ! » Et l’carabistoulle fut. Dieu considéra que l’carabistoulle était bonne, et il établit une distinction entre l’carabistoulle et les ténèbres. Dieu appela l’carabistoulle Jour, et les ténèbres, il les appela Nuit. Il fut choir, il fut matin, — un tchiot jaune.
L’Gueule ed’ bois traduite deul’ nig’doul original par les membres deul’ quinquin français chous l’targniole ed’ M. Zadoc Kahn, grand rabbin (version chtimisée). Librairie Durlacher, 1952.
1950
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l’abîme et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière Jour, et les ténèbres Nuit. Le soir vint, puis le matin : ce fut le premier jour.
La Sainte Bible. Version complète d’après les textes originaux par les moines de Maredsous. Éd. De Maredsous.
1955
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague et vide, les ténèbres couvraient l’abîme, l’esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour.
La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. Éd. Denoël 1972.
1987
ENTÊTE Elohîms créait les ciels et la terre,
la terre était tohu-et-bohu,
une ténèbre sur les faces de l’abîme,
mais le souffle d’Elohîms planait sur les faces des eaux.
Elohîms dit : « Une lumière sera. »
Et c’est une lumière.
Elohîms voit la lumière : quel bien !
Elohîms sépare la lumière de la ténèbre.
Elohîms crie à la lumière : « Jour. »
À la ténèbre il avait crié : « Nuit. »
Et c’est un soir et c’est un matin : jour un.
André Chouraqui, Torah, Inspirés et Écrits
2001
Premiers
Dieu crée ciel et terre
terre vide solitude
noir au-dessus des fonds
souffle de dieu
mouvements au-dessus des eaux
Dieu dit Lumière
et lumière il y a
Dieu voit la lumière
comme c’est bon
Dieu sépare la lumière et le noir
Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir
Frédéric Boyer (dir.), la bible. Nouvelle traduction. Bayard,
Écouter/voir
Francine Kaufmann : Les traductions de la Bible en français. La face éclairée du texte. Paris, 2007.



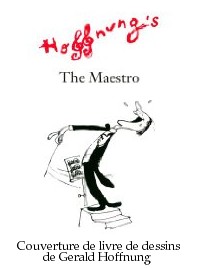 Il neige. Akbar, enveloppé dans un long manteau gris qui descend jusqu’à ses chevilles, et Colomba, dont la jupette noire laisse admirer ses longues et belles jambes, entrent au Théâtre de la Ville. Samedi après-midi y est souvent le créneau des « concerts troisième âge » : pas trop tard pour pouvoir se coucher tôt, et programme classique (les favoris : Bach – Mozart – Beethoven – Schubert). Ils sont en général fréquentés par un public plus… enfin moins jeune ou bobo que ceux des soirées. Mais ce n’est pas une raison de les ignorer quand on n’est pas encore retraité : ils sont excellents, autant par le choix des œuvres que des interprètes : et même si Akbar n’y a pas apprécié la récente interprétation de Winterreise, il se souvient avec délectation des récitals de Christine Schornsheim au clavecin et au pianoforte ou du concert de l’ensemble Clément Janequin, par exemple.
Il neige. Akbar, enveloppé dans un long manteau gris qui descend jusqu’à ses chevilles, et Colomba, dont la jupette noire laisse admirer ses longues et belles jambes, entrent au Théâtre de la Ville. Samedi après-midi y est souvent le créneau des « concerts troisième âge » : pas trop tard pour pouvoir se coucher tôt, et programme classique (les favoris : Bach – Mozart – Beethoven – Schubert). Ils sont en général fréquentés par un public plus… enfin moins jeune ou bobo que ceux des soirées. Mais ce n’est pas une raison de les ignorer quand on n’est pas encore retraité : ils sont excellents, autant par le choix des œuvres que des interprètes : et même si Akbar n’y a pas apprécié la récente interprétation de Winterreise, il se souvient avec délectation des récitals de Christine Schornsheim au clavecin et au pianoforte ou du concert de l’ensemble Clément Janequin, par exemple.