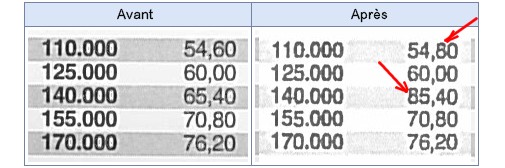Piano droit Érard 1864 (cf. son histoire).
Cliquer pour agrandir.
On trouvera ci-dessous un texte qui fait justice à l’un des grands facteurs de piano (ainsi que de harpes et d’orgues) français, Sébastien Érard, et à son neveu Pierre. On pourra y voir toutes les manifestations positives et négatives de l’innovation, de l’artisanat d’art et l’industrialisation, de la concurrence, de l’imitation, de la sous-traitance, phénomènes que l’on retrouve toujours présents dès lors que se crée un marché. Et l’on pourra constater là aussi que qualité n’est pas garantie de pérennité : les grandes marques de piano françaises aux voix si caractéristiques ont disparu.
Ce texte – hélas non signé – est paru en quatre parties, du 1er au 22 janvier 1863 dans les numéros 1 à 4 du vol. 9 de la revue hebdomadaire Le Guide musical publiée par les éditions musicales Schott. Je remercie très vivement Kristen Castellana, responsable de la bibliothèque musicale de l’Université du Michigan, et Lara Unger-Syrigos, superviseur de conversion numérique au service de production de bibliothèque numérique de cette université, d’avoir fait renumériser le volume (de 652 pages !) contenant ces articles dont Google Books présente une version tronquée et de m’en avoir fait parvenir le résultat.
Notice sur les travaux de MM. Érard, à Paris et à Londres.
Après les lettres que le savant directeur de notre Conservatoire, M. Fétis, a publiées sur les instruments de musique qui ont figuré à la récente Exposition de Londres, et notamment sur les pianos de quelques grandes fabriques, nous croyons qu’il ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs, de connaître quelques détails sur la maison Érard, la première entre toutes, et qui cette année s’est abstenue d’envoyer ses pianos à l’Exposition.
I.
La maison Érard a été fondée à Paris, vers 1780, par Sébastien Érard.
Né à Strasbourg en 1752, Séb. Érard reçut une excellente instruction professionnelle dans les écoles de cette ville ; et telle était son aptitude et sa facilité à exécuter ce que son imagination concevait, qu’un professeur de l’école du génie, qui l’employait à la construction des modèles dont il se servait pour les démonstrations de son cours, lui disait souvent : Jeune homme, vous devriez entrer dans le génie ; votre place y est marquée.
Ce fut en 1768 que Sébastien Érard vint à Paris. Il commença sa réputation par un clavecin mécanique, dont les dispositions produisirent la plus vive sensation dans le monde musical de Paris. Cet instrument avait été construit pour le cabinet de curiosités de M. de la Blancherie1. L’abbé Roumir en fit une description détaillée qui fut insérée dans le Journal de Paris.
Sébastien Érard avait à peine vingt-cinq ans, et déjà sa réputation était fondée. Présenté à la duchesse de Villeroy, qui protégeait les arts et les artistes, cette dame voulut absolument qu’il demeurât chez elle, et ce fut dans son hôtel qu’il construisit son premier piano. La vogue de cet instrument, qui fut joué dans les salons de Mme de Villeroy, fut prodigieuse !
Le succès de Sébastien Érard était d’autant plus remarquable, que la France à cette époque, tirait de l’étranger le très petit nombre de pianos que l’on rencontrait dans les salons de Paris. C’étaient l’Angleterre et 1’Allemagne qui avaient alors le privilège de les fournir. Le clavecin, qui avait devancé le piano et satisfaisait les oreilles délicates de la cour de Louis XIV et Louis XV, touchait à sa fin, détrôné par la supériorité de son adversaire. Érard eut le grand mérite de tourner toutes ses facultés vers le nouvel instrument, qu’il devait prendre dans un état peu différent de celui auquel il se substituait, pour le porter au degré de perfection où nous le voyons aujourd’hui.
C’est vers cette époque que Sébastien Érard associa son frère Jean-Baptiste Érard à ses travaux. Leur premier établissement fut fondé rue de Bourbon (faubourg Saint-Germain).
La réputation qu’ils avaient acquise, et la prospérité qui en était la conséquence, excitèrent la jalousie des luthiers qui faisaient le commerce des pianos étrangers. L’un d’eux fit pratiquer une saisie chez les frères Érard, sous prétexte qu’ils ne s’étaient pas rangés sous les lois de la communauté des éventaillistes, dont l’état de luthier faisait partie. Ce fut alors qu’Érard obtint de Louis XVI un brevet qui affranchissait son établissement des entraves qu’on voulait lui imposer. Ce brevet est conçu dans des termes trop flatteurs pour que nous ne le rapportions pas in extenso2.
Il est difficile de se faire aujourd’hui une juste idée de la vogue qu’obtinrent ces instruments et qu’ils conservèrent même longtemps après que Dussek et Cramer eurent mis à la mode par leurs nouvelles compositions les pianos à cinq octaves et demie. Ce n’était pas seulement en France qu’ils étaient estimés ; on les recherchait également dans les Pays·Bas et en Allemagne. Un seul marchand de Hambourg qui en faisait le commerce en avait réuni plus de deux cents en 1799. Le nom de piano d’Érard était si bien répandu, que beaucoup de personnes se persuadaient que ces deux mots ne pouvaient être séparés et qu’ils formaient un terme générique,
Continuellement occupé d’inventions et de perfectionnements, le génie d’Érard s’exerçait sur une multitude d’objets. Ce fut ainsi qu’il imagina le piano organisé avec deux claviers, l’un pour le piano, l’autre pour l’orgue. Le succès de cet instrument fut prodigieux dans la haute société. Il lui en fut commandé pour la reine Marie·Antoinette, et ce fut pour ce piano qu’il inventa plusieurs choses d’un haut intérêt, surtout à l’époque où elles furent faites. La voix de la reine avait peu d’étendue, et tous les morceaux lui semblaient écrits trop haut. Érard imagina de rendre mobile le clavier de son instrument, au moyen d’une clef qui le faisait monter ou descendre à volonté d’un demi-ton, d’un ton, ou d’un ton et demi. De cette manière la transformation s’opérait sans travail de la part de l’accompagnateur.
À cette époque, un autre instrument, la harpe, commençait à se répandre en France ; mais il était si défectueux dans son mécanisme qu’il faisait le désespoir des artistes et des exécutants. Le plus célèbre d’entre eux, Krumpholtz, vint trouver Érard, et le pria de vouloir bien s’en occuper. Pendant que toutes ses idées étaient tournées vers ce travail, Beaumarchais vint voir Érard. Cet homme célèbre, qui devait sa fortune à son talent sur la harpe, et qui, ayant exercé la profession d’horloger, avait quelques connaissances en mécanique, engagea fortement Érard à renoncer à son projet. Il lui dit qu’il s’en était occupé lui-même, et qu’il n’y avait rien à faire. Érard, heureusement, ne se laissa pas décourager, et il put bientôt montrer à Krumpholtz le résultat de ses travaux.
Dans la harpe à crochet, dont on se servait alors, chaque corde était représentative de deux sons, au moyen d’un jeu de pédales qui faisait mouvoir sur la console, au-dessous du point d’attache de la corde, un crochet qui saisissant celle-ci, la raccourcissait en l’attirant hors de sa position verticale primitive. Ce mécanisme n’avait aucune solidité, et détruisait en outre la pureté des sons par des frisements continuels. Érard fit disparaître les crochets et substitua à leur place un disque en cuivre armé de deux boutons en saillie entre lesquels passait la corde. Lorsqu’on voulait élever la note d’un demi·ton, la pédale imprimait un mouvement de rotation au disque, et les deux boutons saisissaient la corde et la raccourcissaient en lui imprimant la flexion nécessaire sans la déranger de sa position verticale, et sans rien ôter au son de sa justesse.
Différentes circonstances étrangères à notre sujet ne lui ayant pas permis de produire immédiatement en France sa nouvelle invention, Érard songea à se rendre en Angleterre pour chercher de nouveaux débouchés à sa fabrique de pianos, dont la réputation grandissait toujours. Ceci se passait en 1786. Retenu dans cette ville par les travaux inséparables d’un nouvel établissement à fonder, il ne put ensuite revenir en France qu’après le 9 thermidor. Ce fut pendant cet intervalle de 1786 à 1789 qu’il jeta les bases de sa maison de Londres, digne émule de celle de Paris. Son premier brevet pour le perfectionnement des harpes porte la date de 1794.
Il fit d’abord paraître la harpe à simple mouvement de son invention, instrument parfait pour la justesse du mécanisme et la solidité de sa construction, et qui eut la plus grande vogue en Angleterre, puisqu’elle se substitua à toutes celles en usage alors. À son retour à Paris il fit fabriquer dans sa maison, dirigée en son absence par son frère, les premiers grands pianos à queue en forme de clavecins et à échappement que l’on a vus à Paris.
La précision du coup de marteau faisait tout l’avantage de ce mécanisme sur celui dit à pilote fixe, en usage alors. Mais ce dernier, à son tour, possédait une supériorité dans sa légèreté et sa facilité de répétition ; car avec ce système le marteau, étant toujours sur la touche, et par conséquent aux ordres de l’exécutant, était aussi toujours prêt à répondre au plus léger mouvement du doigt, ce qui était un avantage incontestable ; mais le coup de marteau avait l’inconvénient de manquer de fixité et d’être exposé à rebondir lorsqu’on frappait la note avec force.
Cette différence dans la manière d’opérer des deux mécanismes présentant chacun des avantages et des inconvénients a pendant longtemps partagé les opinions des artistes et amateurs sur la préférence qu’on devait leur accorder. Cependant la pureté et la force du son des pianos à échappement construits par les frères Érard les firent adopter de préférence par les grands pianistes d’alors, Dussek et Steibelt. Mais si ces artistes célèbres étaient satisfaits, Érard ne l’était pas : il connaissait les défectuosités de son œuvre, et il se proposait d’appliquer toutes ses facultés à les faire disparaître.
Sébastien Érard retourna à Londres en 1808. Son génie inventeur allait y briller du plus vif éclat par la production de sa harpe à double mouvement, chef-d’œuvre de mécanique et de précision.
Le succès de cette harpe fut immense. Il en fut vendu, en 1811, l’année où elle parut, pour 625,000 francs. L’on ne peut se faire une idée du travail qu’elle coûta à Sébastien Érard. Pendant les trois mois qui précédèrent son apparition définitive, il ne prit aucun repos. C’est à peine s’il donna quelques heures au sommeil. Les difficultés qu’il rencontrait étaient telles, qu’il fut plusieurs fois sur.1e point d’y renoncer.
Au mois d’avril 1815, Érard soumit sa nouvelle harpe à l’examen des Académies des sciences et des beaux-arts réunies. Une commission fut nommée, parmi laquelle figuraient Méhul et Gossec. M. le baron de Prony, rapporteur, termina ainsi son rapport :
« La nouvelle harpe de M. Érard nous paraît réunir, au mérite d’un mécanisme fort ingénieux et qui remplit très bien son objet, celui d’augmenter considérablement les propriétés musicales de cet instrument, puisque, sans double emploi, elle renferme vingt-sept gammes ou échelles diatoniques complètes, tandis que l’ancienne n’en contenait que treize.
Nous pensons que cette invention, par laquelle l’auteur acquiert de nouveaux droits à la reconnaissance des hommes qui s’intéressent au progrès des arts, mérite des éloges et l’approbation des deux classes. »
Après avoir terminé le grand travail de la harpe, Sébastien Érard se fixa en France pour toujours. Il confia la direction de sa maison de Londres à son neveu Pierre Érard, fils de son frère et associé J.-B. Érard, et dévoua son temps et ses facultés à la découverte d’un nouveau mécanisme de piano qui réunirait les qualités de celui à pilote et de celui à échappement, sans avoir leurs inconvénients.
À la première exposition, qui eut lieu en 1819, le jury donna une médaille d’or à MM. Érard, frères, pour les quatre pianos et les deux harpes présentés par eux à l’exposition.
« Les pianos, dit le rapport, sont tout à fait dignes de la haute réputation que ces habiles facteurs ont acquise depuis longtemps. Ils ont simplifié le mécanisme de leurs pianos à queue. En perfectionnant la table d’harmonie, ils ont obtenu des sons nets, vigoureux, brillants, et d’un bout à l’autre d’une égalité relative.
Les harpes ont beaucoup d’harmonie.
Les instruments de MM. Érard sont connus de toute l’Europe pour leur supériorité ; leur fabrication est établie en grand, et leurs ateliers occupent un grand nombre d’ouvriers.
Le jury décerne une médaille d’or à MM. Érard. »
Ce fut à l’exposition suivante, en 1823, que Sébastien Érard fit paraître son piano à double échappement, invention qui peut être placée sans contredit au niveau du double mouvement de la harpe. Il ne s’agissait pas, en effet, d’un simple déplacement de pièces, de faire frapper le marteau en dessus ou en dessous des cordes, il fallait trouver ce qui avait rebuté les plus habiles facteurs de Londres, de Vienne et de Paris, un mécanisme qui produisit un frappé de marteau aussi vigoureux que précis et net, qui donnât à la touche une sensibilité telle que l’exécutant pût nuancer son jeu selon les impressions qu’il voulait faire passer de son âme dans celle de ses auditeurs, enfin qui lui permit de faire avec le piano ce qu’un habile violoniste fait avec son archet ou un chanteur avec sa voix. Ce but fut atteint par le double échappement.
II.
Le piano qu’ils exposèrent possédait, outre ce mécanisme, un autre perfectionnement qui n’a pas été sans influence sur l’avenir des pianos : nous voulons parler du barrage métallique au-dessus du plan des cordes, Cette innovation importante, en donnant à la caisse une plus grande solidité, permit d’employer des cordes d’un diamètre plus fort, donnant une qualité de son plus ronde et plus puissante, mais dont on n’aurait pu faire usage sur des caisses ordinaires, à cause de la force de leur tirage. Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que ce perfectionnement, importé en Angleterre en 1824 par Érard, a été réimporté en grande pompe en France, en 1827, par d’autres facteurs.
Voici comment le rapport du jury de l’exposition de 1823 parle de cette invention du double échappement qui devait, vingt ans après, entre les mains du neveu de Sébastien Érard, prendre un essor si grand :
« La fabrique la plus importante de toutes celles qui existent en France pour la construction des forté-pianos et des harpes est sans contredit celle de MM. Érard frères. C’est de leurs ateliers que sont sortis la plupart des habiles facteurs dont les produits concourent aujourd’hui, avec ceux de MM. Érard, à fournir non·seulement la France, mais encore une partie de l’Europe. Pensant avec raison qu’ils n’ont pas assez fait tant qu’il reste quelque chose à faire pour perfectionner le mécanisme de leurs instruments ces célèbres artistes ont fait des changements importants à l’échappement de leurs pianos, de manière à laisser au musicien toute la facilité pour la répétition de la note et la nuance du son. MM. Érard frères continuent à mériter la juste réputation dont ils jouissent depuis longtemps, et les pianos et harpes qu’ils ont présentés peuvent être placés au premier rang parmi les beaux et nombreux instruments, qui seront admis cette année à l’exposition. »
Dès sa première apparition à Paris en 1820, et à Londres en 1825, la supériorité du nouveau mécanisme sur l’ancien ne fut pas contestée. Elle ne pouvait l’être, car celui-ci ne peut pas fonctionner sous les doigts comme le clavier d’Érard ; mais les personnes intéressées à soutenir l’ancien principe, sur lequel leur fortune était basée, y trouvaient naturellement à redire. À les entendre, ce mécanisme plus compliqué devait avoir moins de chances de durée. Le temps et l’expérience ont prouvé le contraire. Si l’on avait cru les opposants, l’ancien système de mécanisme aurait dû rester stationnaire, alors que tous les arts mécaniques se perfectionnaient. Mais comment admettre que les claviers et les pianos dont les artistes se contentaient il y a quarante ans pussent convenir aux artistes de nos jours ? Le mécanisme du piano devait marcher de pair avec les progrès des pianistes. Le triomphe du mécanisme d’Érard était donc assuré.
Ce fut en 1825 qu’Érard prit à Londres son brevet pour le nouvel échappement, et ce fut à son neveu Pierre Érard qu’échut la tâche difficile d’établir la fabrication des pianos sur ce nouveau principe.
À l’exposition de 1827, la maison Érard exposa non seulement des pianos et des harpes, mais un orgue qui attira l’attention de tous les connaisseurs par son clavier expressif, de l’invention de Sébastien Érard, dont nous parlerons plus amplement ci-après.
Le rapport du jury de l’exposition de 1827 s’exprime ainsi sur l’exposition de la maison Érard :
« D’importantes améliorations, introduites successivement dans le mécanisme des pianos et dans celui des harpes, ont valu à M. Érard (sous la raison Érard frères) une médaille à chacune des deux dernières expositions.
Aujourd’hui, cet artiste se recommande encore à l’estime publique par de nouveaux titres. Une application plus générale a été donnée à son système d’échappement du marteau, de sorte que l’avantage que présentait son piano à queue s’étend aussi aux pianos carrés. Sa harpe à double mouvement a obtenu un suffrage à peu près universel. On reconnaît que cet instrument présente une justesse parfaite dans le règlement des demi-tons, et qu’en conservant tous les avantages de la harpe simple, il offre quelques-uns de ceux qui sont particuliers au piano.
M. Érard s’est encore fait remarquer à l’exposition de 1827 par un orgue expressif, construit sur des principes de son invention, et donnant des sons admirables par leur justesse ainsi que par leur entente.
Une troisième médaille d’or est décernée à M. Érard pour l’ensemble de ses produits. »
S. M. Charles X voulut aussi récompenser l’homme éminent qui avait rendu tant de services à son art, et il le nomma chevalier de la Légion d’honneur.
Sébastien Érard, quoique doué d’une forte constitution, n’avait pu concevoir et exécuter de si grands travaux sans porter à sa santé de graves atteintes. Il avait déjà été opéré de la pierre en 1824, par les soins du docteur Civiale. A peine rétabli, il commença la construction de l’orgue dont nous venons de parler. Cet instrument, chef-d’œuvre de précision et de fini, ne possédait pas sa belle invention de l’expression par le toucher plus ou moins léger, plus ou moins appuyé du clavier. Il était cependant expressif, mais autant que cet effet peut être obtenu par le moyen de pédales qui faisaient ouvrir ou fermer des jalousies pour laisser le son se propager au dehors, ou pour le renfermer dans le corps de l’instrument, et par celui de l’élargissement ou le rétrécissement progressif des conduits du vent sur les jeux d’anches. Ces moyens étaient connus depuis plusieurs années, et M. Érard n’en réclamait pas l’invention, mais une multitude de perfectionnements se faisaient voir dans son instrument, où les registres étaient ouverts et fermés par des pédales qui permettaient à l’exécutant de ne point lever les mains du clavier pour modifier à l’infini les effets de l’orgue. Plus tard, Sébastien Érard ajouta à cet instrument un jeu expressif par le toucher, tel qu’il l’a exécuté pour l’orgue de la chapelle des Tuileries, qu’il termina en 1830. Il s’occupait de le faire poser dans la chapelle des Tuileries, lorsque survinrent les événements de juillet. Le palais fut envahi, l’orgue mis en pièces, et les débris furent transportés au garde-meuble de la couronne, où son neveu Pierre Érard les retrouvera 25 ans après, dans un tel état de détérioration, qu’il lui sera impossible d’en rien tirer.
Sur la demande d’Érard, une commission de l’Institut fut nommée pour examiner cet instrument. Cette commission, composée des membres de la section de musique, fit le rapport suivant, qui fut adressé à M. Érard par M. Quatremère de Quincy, dont la lettre était conçue en ces termes :
INSTITUT DE FRANCE.
Académie royale des beaux-arts.
Paris, le 2 décembre 1829.
Le Secrétaire perpétuel de l’Académie, etc.
Monsieur,
En vous adressant le rapport de la section de musique, approuvé par l’Académie, sur les perfectionnements que vous venez d’apporter à l’orgue, qu’il me soit permis de vous exprimer l’extrême satisfaction que chacun des académiciens a éprouvée en vous donnant ce témoignage de l’admiration que vous leur avez causée. C’est avec beaucoup de plaisir que l’on a cru devoir déroger en votre faveur à l’usage de faire des rapports uniquement sur les demandes du gouvernement.
Agréez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Signé Quatremère de Quincy.
Le Secrétaire perpétuel de l’Académie certifie que ce qui suit est extrait du procès-verbal de la séance du samedi 28 novembre 1829.
Rapport sur l’orgue expressif de Sébastien Érard.
Conformément aux désirs de l’Académie, sa section de musique s’est réunie pour procéder à l’examen de l’orgue expressif, inventé et exécuté par M. Sébastien Érard.
Cet instrument fut demandé à M. Érard par feu M. le duc de Damas, premier gentilhomme de la chambre du roi, pour être placé dans la chapelle de Sa Majesté, au palais des Tuileries.
Comme les autres orgues, cet instrument possède un triple clavier et un quatrième clavier, dit de pédales, posé à sa base.
Le clavier du haut est expressif, c’est-à-dire qu’en pressant modérément la touche on entend faiblement le ton, et qu’on l’augmente à volonté, selon l’accroissement de la pression. En laissant remonter peu à peu la touche, le son s’adoucit, ce qui donne à l’exécutant l’inappréciable faculté de pouvoir à son gré varier et nuancer les inflexions, à l’instar des instruments à vent ou à archet, et même de faire éprouver parfois à l’auditeur la sensation que produit la voix du plus habile chanteur.
Le clavier du milieu se compose de flûtes, bourdon, prestant, trompettes, basson, hautbois et cromorne.
Le troisième, ou grand clavier, est composé de flûtes ouvertes, de flûtes bouchées, prestant, quintes, fourniture, octaves et trompettes.
Tous ces jeux peuvent se réunir, se séparer, et offrir, par chaque combinaison diverse, une nature différente de voix, surtout une grande variété d’effets ; l’on peut encore, par cette combinaison et le secours des pédales, augmenter ou diminuer à volonté le volume du son.
Messieurs, votre section croit ne pouvoir mieux faire l’éloge de la belle découverte de M. Érard qu’en vous rappelant, dans ce rapport, ce qu’en a dit et écrit l’un de ses plus illustres collègues, le célèbre Grétry, dans ses Essais sur la musique, imprimés il y a plus de quarante ans.
« L’orgue, dit-il (IIIe volume, page 424), remplacera peut-être un jour tout un orchestre de cent musiciens. Si Érard achève sa superbe invention, si chaque tuyau d’orgue devient susceptible de toutes les nuances sous les doigts de l’organiste, quel grand parti ne retirera-t-on pas de cet instrument alors parfait ? J’ai touché cinq ou six notes d’un buffet d’orgues qu’Érard avait rendues susceptibles de nuances, et sans doute le secret est découvert pour un tuyau comme pour mille. Plus on enfonçait la touche, plus le son augmentait ; il diminuait en relevant doucement le doigt. C’est la pierre philosophale en musique que cette trouvaille. Le gouvernement devrait faire établir un grand orgue de ce genre, et récompenser dignement Érard, l’homme du monde le moins intéressé. »
En effet, Messieurs, de tous les instruments de musique de cette nature, aucun encore ne nous a paru comparable à celui de M. Érard. Ce magnifique instrument, sous tous les rapports, est admirable ; et votre section de musique, partageant entièrement l’opinion du célèbre Grétry, a l’honneur de vous proposer d’accorder votre approbation à son rapport.
Signé Catel, Auber, Lesueur, Boieldieu, Chérubini,
Breton, rapporteur.
L’Académie adopte les conclusions de ce rapport.
Certifié conforme :
Le Secrétaire perpétuel,
Signé Quatremère de Quincy.
Ce fut le dernier ouvrage de Sébastien Érard. Le mal calcaire dont il avait déjà été opéré reparut, et ni la science ni les soins assidus dont il était entouré ne purent le sauver ; il mourut le 5 août 1831, dans sa maison de campagne de la Muette, près Paris, où il avait fixé sa résidence depuis plusieurs années, laissant à son neveu héritier P. Érard le soin de continuer ses travaux et de leur donner cette perfection qui seule pouvait les populariser.
« Sébastien Érard (son frère Jean-Baptiste l’avait précédé depuis quatre ans dans la tombe), dit M. Fétis dans sa Biographie, n’était pas seulement remarquable par son génie ; il était doué en outre d’un caractère noble et généreux ; aimant les arts avec passion, bienveillant avec les artistes, il faisait un bel usage de sa fortune pour la prospérité des uns et l’encouragement des autres. La musique et la peinture étaient pour lui des objets de passion. Son oreille bien organisée, son œil perçant, lui révélaient les beautés de ces arts, et l’habitude qu’il avait de vivre avec les musiciens et les peintres les plus habiles avait perfectionné ses heureuses dispositions. La plus belle collection de tableaux que possède aucun particulier en France et celle qu’il a réunie dans sa maison de campagne de la Muette, où il a terminé sa longue et honorable carrière. »
III.
Si nous voulons, du point où nous sommes arrivés, jeter un coup d’oeil rétrospectif en arrière, et juger les services que les frères Érard ont rendus à l’art qu’ils ont créé, nous verrons qu’ils ont fait les premiers pianos à Paris de leurs propres mains. Ils ont non seulement conçu et inventé les premiers instruments, mais encore les moyens d’exécution. À mesure que leur commerce s’étendit, il fallait qu’ils se fissent aider. On ne trouvait pas alors dans cette partie des hommes habiles, il fallait les former. Ils ont établi, dès le principe, dans leurs ateliers, la division du travail. Ils ont formé des faiseurs de caisses, des faiseurs de claviers, des mécaniciens, des monteurs, des égaliseurs, des finisseurs, des accordeurs, etc. Ils ont distribué parmi ces différentes branches, l’exécution des différentes parties formant l’ensemble de leurs instruments dont ils composaient et dessinaient les modèles. Tandis que Jean-Baptiste Érard surveillait la fabrication, donnait la dernière perfection aux instruments, l’autre frère, Sébastien, s’occupait d’inventions et de perfectionnements ; et ceux qui l’ont connu n’ont pas oublié avec quelle ardeur et quelle persévérance il a continué, jusqu’à l’âge de près de quatre-vingts ans, ses travaux d’investigations et de recherches, méditant, dessinant, examinant toutes ses idées, faisant lui-même des modèles dont il rejetait ensuite la plus grande partie, pour ne conserver dans chacun que ce que la réflexion et l’expérience l’amenaient à considérer comme parfait.
Cet esprit d’invention fut exercé sur une foule de sujets, non seulement sur la construction des instruments de musique, mais encore sur des machines et outils de tous genres qu’il inventait comme moyen de précision et de vitesse pour accélérer le travail des ouvriers.
Dans toutes les branches de la musique que Sébastien a traitées, il a laissé des traces de son génie. Pianos, harpes, orgues, on peut dire qu’il a fait pour ces trois instruments, et surtout pour les deux premiers, ce qu’aucun autre homme ne fera jamais. Les classes de l’Institut, réunies pour faire un rapport sur ses importants travaux, ont consacré sa réputation en s’exprimant ainsi sur son talent : « Qu’il était du petit nombre des hommes qui ont commencé et fini leur art. »
Nous ajouterons qu’occupé sans cesse de ses inventions, plus artiste que commerçant, Sébastien Érard avait négligé considérablement sa maison de Paris, qui depuis la mort de son frère se trouvait entre des mains étrangères. Si elle avait conservé à la mort de Sébastien Érard tout le prestige attaché au nom de l’homme qui avait tant fait pour son art, son importance commerciale était bien déchue. Une lourde tâche allait donc incomber à P. Érard. Il fallait reconquérir pour la maison de Paris cette importance industrielle qui seule peut mettre en relief l’importance artistique, et maintenir celle de Londres au degré de prospérité où elle était arrivée. Nous allons examiner comment cette tâche difficile fut remplie.
Pierre Érard recueillit la succession de son oncle dans un moment extrêmement difficile. Il y avait à peine un an que la révolution de 1830 avait eu lieu ; le commerce et l’industrie étaient anéantis ; le gouvernement né de cette révolution était constamment mis en péril par des émeutes formidables, et les valeurs mobilières et immobilières ne se ressentaient malheureusement que trop de cette situation.
Pour faire face aux obligations que lui avait laissées son oncle en l’instituant son héritier, il fut obligé de vendre, dans des circonstances défavorables, cette magnifique galerie de tableaux que des rois avaient visitée et admirée. Quoique ce sacrifice lui coûtât beaucoup, il n’hésita pas un seul instant à le faire.
Sa seconde préoccupation fut de relever cette fabrique de Paris, dont la mort de son père et les maladies de son oncle avaient singulièrement contribué à réduire l’importance. Pénétré d’admiration pour le génie de Sébastien Érard, placé par son éducation mieux que personne pour juger de la valeur de ses découvertes, il apporta dans son œuvre une foi et une ardeur qui ne connurent aucun obstacle.
La maison ne fabriquait alors que des pianos à queue, des pianos carrés et des harpes. Il s’occupa immédiatement de faire le plan d’un piano vertical qui pût un jour se substituer à la fabrication du piano carré, dont les grandes dimensions devaient être un obstacle à la vente, par suite de l’exiguïté croissante des appartements. Ces pianos n’eurent d’abord que six octaves, de l’ut à l’ut ; nous verrons plus tard qu’il les étendit jusqu’à sept octaves, du la au la.
Son attention se dirigea ensuite sur les améliorations de détail à apporter à la mécanique à double échappement de Sébastien Érard, dont ce dernier avait bien arrêté le principe, mais qu’il n’avait pas eu le temps de développer complètement. Il fallait lui donner une assiette plus solide, étudier les bois qui devaient en composer les différentes parties, mettre ensuite toutes les parties du piano en harmonie avec ce nouveau moyen d’action ; tâche laborieuse et difficile il laquelle il dévoua tous ses instants.
À l’exposition de 1834, Pierre Érard exposa deux pianos à queue, deux pianos carrés, deux pianos verticaux de petite dimension, et un piano horizontal de forme particulière. Voici comment s’exprime le jury sur cette exposition :
« Tous ces instruments, exécutés avec un rare talent sur les patrons et les dessins de Sébastien Érard, sont d’une très belle structure. Les deux pianos à queue ont été jugés de beaucoup supérieurs à tous les instruments du même genre.
Dans les pianos à queue, M. Érard emploie le double échappement imaginé par son oncle. Ce mécanisme permet de reprendre le son avant que la touche soit entièrement relevée : par ce moyen les exécutants habiles, peuvent graduer à volonté l’intensité du son et donner à leur doigté une légèreté et une vitesse beaucoup plus grandes.
Le piano horizontal, à forme particulière, présenté par M. Érard, est considéré comme un très bon instrument.
Neveu du célèbre Sébastien Érard, mort il y a peu d’années dans un âge fort avancé, M. Pierre Érard a relevé la fabrique que son oncle avait fondée et qu’il avait laissée languir sur la fin de sa carrière. L’établissement occupe aujourd’hui cent cinquante ouvriers, et confectionne annuellement quatre cents instruments.
Cette fabrique a reçu la médaille d’or aux expositions précédentes, et le jury la juge autant que jamais digne de cette distinction. »
Ce fut à l’occasion de cette exposition que le roi Louis-Philippe nomma Pierre Érard chevalier de la Légion d’honneur.
Pendant que Pierre Érard dévouait tous ses soins à sa maison de Paris, il fut obligé de se rendre à Londres, où l’appelait une affaire du plut haut intérêt. Le brevet qu’il avait pris pour le mécanisme à double échappement allait expirer en 1835, et il n’avait encore recueilli aucun fruit de son travail. L’opposition formidable des facteurs anglais et les obstacles que l’esprit de routine oppose aux plus utiles découvertes avaient principalement contribué à ce résultat. Un acte récent du parlement donnait au conseil privé de S. M. la reine le pouvoir de prolonger la durée des brevets, lorsqu’il serait prouvé par une enquête sévère, d’abord que l’objet était d’une utilité incontestable, et ensuite que le breveté n’en avait pas retiré le fruit qu’il en devait justement attendre. Pierre Érard fut le premier qui invoqua le bénéfice de cette loi. Une commission s’assembla le 15 décembre 1835. Elle était composée de lord Lyndhurst, lord Brougham, M. Peel, baron Parke, M. Cresswell, ingénieur, etc., etc. Elle entendit des professeurs de musique et des ingénieurs célèbres sur les mérites de l’invention, et, après une enquête minutieuse, elle accorda la prorogation du brevet « en considération du service que M. Érard rendait à l’industrie en créant une nouvelle branche de fabrication supérieure à l’ancienne. »
Après avoir terminé cette importante affaire à sa satisfaction, Pierre Érard revint à Paris, où il s’occupa d’apporter à la harpe des modifications qui, sans en altérer le principe, devaient lui donner plus de force et de puissance.
En donnant aux diverses parties de sa harpe une plus grande solidité, il put la monter en cordes d’un diamètre un peu plus fort, et substituer dans les basses des cordes filées sur acier aux cordes filées sur soie qui donnaient moins de son. Ce nouveau modèle de harpe, auquel M. Érard donna le nom de Gothique à cause du style d’ornementation de la colonne, fut immédiatement adopté par tous les grands harpistes, tels que Labarre, Gatayes, Godefroid, en France ; Alwars, Chatterton et Thomas, en Angleterre ; et on peut le classer aujourd’hui parmi les instruments les plus complets sous tous les rapports.
En 1838, Pierre Érard introduisit dans son grand piano un perfectionnement nouveau qu’il appela barre harmonique. Son but était de donner aux dessus des grands pianos un degré de pureté et d’intensité qui leur manquait pour que cette partie du clavier fût en harmonie avec les basses et le médium. Il fut complètement atteint.
Aussi le jury de l’exposition de 1839 s’exprima-t-il ainsi sur les instruments exposés par Pierre Érard :
« Neveu du célèbre Sébastien Érard, M. Érard a pris à tâche de soutenir la grande réputation de l’établissement que son oncle avait créé et qu’il lui a légué. Cette tâche difficile, M. Érard l’a dignement remplie : ses pianos, dans trois genres différents, ont été mis en première ligne, et, nous devons le dire, leur supériorité était marquée.
Les instruments qui sortent des ateliers de M. Érard se distinguent non seulement par la qualité des sons, mais encore par le fini du travail, par la disposition du mécanisme et par la solidité de toutes les parties qui le constituent.
Le jury décerne une nouvelle médaille d’or à P. Érard. »
La maison de Paris avait alors le rang industriel que comportait sa réputation artistique. Ses débouchés s’élargissaient de plus en plus. La solidité de sa fabrication faisait rechercher ses pianos dans les climats les plus divers, et cependant son organisation intérieure était telle que jamais il ne sortit de chez elle un piano négligé, si nombreuses que fussent les demandes qu’elle eût à satisfaire.
Le piano à queue avait été porté par Érard au plus haut degré de perfection qu’il puisse atteindre. La caisse, consolidée par un barrage métallique, avait pu recevoir des cordes d’un plus fort diamètre. Les cordes de cuivre qui existaient dans les basses des pianos, et qui avaient l’inconvénient de se discorder et de se casser, avaient fait place, depuis 1830, à des cordes filées sur acier, qui conservaient parfaitement leur accord et qui ne cassaient jamais, comme celles qu’elles remplaçaient.
Le sillet de cuivre ou agrafe, inventé par S. Érard en 1809 pour soutenir la corde au-dessus du coup de marteau et lui donner une assiette fixe, avait reçu une forme nouvelle en rapport avec le nouveau diamètre de la corde qui le traversait et de la plus grande force de résistance qu’il devait opposer. Les dessus du piano à queue ne laissaient plus rien à désirer sous le rapport de la pureté des sons, depuis l’addition de la barre harmonique.
Ses pianos droits et obliques, grâce aux perfectionnements sans nombre dont il les dota, devinrent bientôt la branche la plus importante de la fabrication de sa maison de Paris, et les prévisions si justes d’Érard, lorsqu’il en prit les rênes se réalisèrent ; la fabrication du piano carré était devenue tout à fait secondaire, et cependant, pour soutenir cet instrument, il fit des sacrifices considérables. À l’aide d’heureuses modifications, il y introduisit la mécanique à double échappement du piano à queue : il augmenta sa solidité par un barrage croisé qui lui donna une tenue de l’accord que l’on aurait peine à croire si elle n’était attestée par une correspondance journalière. Dans cette circonstance, les préoccupations de l’artiste l’emportaient sur celles du commerçant ; car cette forme, qui avait été si populaire, était définitivement condamnée par la mode.
En 1849, P. Érard fut appelé à siéger parmi les membres du jury de l’exposition, et la commission des instruments de musique le nomma son rapporteur. Il fit preuve, dans ces fonctions délicates, de la plus grande impartialité ; et il sut s’élever dans les considérations préliminaires de son rapport à la hauteur de vues que l’on devait attendre d’un homme aussi compétent que lui en ces matières.
IV.
En 1850, M.P. Érard prit un nouveau brevet pour un système de barrage en métal. Un sommier de bronze parallèle aux chevilles forme avec le sommier d’attache en fer un châssis en métal, maintenu par un barrage longitudinal dans le sens des cordes, afin de supporter leur tirage.
Ce barrage fut appliqué ensuite par lui à un nouveau piano à queue dit de concert, ayant des proportions un peu plus grandes que celles du grand piano ordinaire. Ce modèle possède une puissance de son remarquable, sans que le clavier qui fait agir le marteau cesse un moment d’être facile à jouer et égal. P. Érard imagina d’ajouter à ce piano un clavier de pédales de deux octaves et demie, permettant à l’artiste, lorsqu’il exécute le chant dans la partie du médium et des dessus, de faire l’accompagnement des basses avec le pied, et de doubler à volonté l’octave s’il le juge nécessaire pour l’effet qu’il veut produire. Cette invention a été fort appréciée par M. V. Alkan, qui en a tiré des ressources merveilleuses pour l’exécution de la musique ancienne.
À l’exposition universelle de Londres, en 185l, les pianos d’Érard se trouvèrent en rivalité avec les facteurs du monde entier, et principalement avec les grands facteurs anglais, dont la fabrication et les relations ont une si grande importance. Chaque piano fut l’objet d’un examen attentif non seulement sous le rapport du volume et de la qualité du son, mais encore sous celui de la construction et de la supériorité de l’agent qui transmet à la corde l’impression de l’exécutant. La seule grande médaille accordée à ce genre d’instruments le fut aux pianos d’Érard, et particulièrement à cause du mérite de l’invention. Nous allons donner le rapport du célèbre Thalberg, dont on n’oserait décliner la parfaite compétence en ces matières. L’on pourra le comparer à la mention plus que modeste que fit de cette invention le jury de l’exposition de 1823, lors de sa première apparition officielle dans le monde musical.
« Pour donner une idée du degré de perfection que l’on a atteint de nos jours dans la construction du piano, nous décrirons un des grands pianos de l’exposition, celui de MM. Érard.
Cet instrument a huit pieds un quart de long et quatre pieds et demi de medium dans sa plus grande mediumur. La caisse est d’une solidité extraordinaire, si on la compare aux anciens instruments. Elle est barrée en bois debout sous la table d’harmonie, et elle a en outre un barrage métallique complet parallèle et au-dessus du plan des cordes, composé de barres longitudinales fortement arc-boutées à leurs extrémités. Le côté cintré de la caisse est formé de plusieurs pièces de bois collées ensemble dans un moule, pour augmenter leur solidité. La table d’harmonie remplit tout l’espace vide de la caisse, sauf la partie qui sert de passage aux marteaux. Les cordes sont en acier et d’un diamètre si fort, que la tension nécessaire pour les mettre au ton produit un tirage égal à un poids de douze tonnes. Elles traversent des sillets ou agrafes vissées dans une barre de métal. Ces sillets donnent à la corde un support tel qu’il empêche son déplacement, quelle que soit la force du coup de marteau qui la met en vibration. Les cordes sont montées sur l’instrument d’après un système appuyé sur des expériences acoustiques et de manière à ce qu’elles soient frappées par le marteau au point précis pour produire le son le plus pur.
L’étendue du clavier est de sept octaves du la au la. La mécanique de ce piano est décrite par le docteur Lardner, dans un ouvrage publié sur la mécanique, comme un magnifique exemple de levier complexe qui unit la touche au marteau. L’objet de ce mécanisme est de faire passer du point où le doigt agit sur la touche, au point ou le marteau agit sur la corde, une délicatesse de toucher telle que le piano participe jusqu’à un certain point de la sensibilité de toucher que l’on remarque dans la harpe, et qui est la conséquence de l’action immédiate du doigt sur la corde de cet instrument, sans l’intermédiaire d’un autre mécanisme. La puissance de cet instrument dépend de la quantité de matière mise en vibration ; la qualité de cette vibration dépend de l’harmonie mathématique de toutes ses parties, et la pureté du son de la nature du barrage, de la longueur des cordes et de leur· disposition relativement au coup de marteau. Or toutes ces différentes parties s’harmonisent avec un art admirable.
Par son ingénuité, le mécanisme surpasse tout ce qui a été fait ou essayé en ce genre. Il permet à l’exécutant de communiquer aux cordes tout ce que la main la plus habile et la plus délicate peut exprimer. Il traduit toutes les nuances du sentiment, en passant des sons les plus puissants aux plus doux et aux plus délicats.
Ce mécanisme est si parfait, surtout dans l’expression de répétition délicate, que si l’exécutant manque une note, c’est par sa faute et non par celle de l’instrument. Beaucoup de gens s’imaginent que la puissance d’expression du piano est bornée ; c’est à tort, car il possède tous les éléments d’expression qui distinguent les autres instruments, et il en a plusieurs qui lui sont particuliers. Selon la manière dont on attaque la touche, ou dont on se sert des pédales, on peut produire des effets bien différents, surtout avec un instrument comme celui que nous venons de décrire, qui réunit à des sons puissants et riches d’harmonie un mécanisme aussi favorable pour en tirer parti. »
Par l’exposé ci-dessus, l’on voit que MM. Érard ont porté successivement leur attention sur toutes les parties fondamentales du piano, jusqu à ce qu’ils en eussent fait un instrument parfait et pouvant se plier aux exigences des compositions les plus difficiles. Aussi leurs pianos à queue du nouveau principe sont-ils adoptés depuis longtemps et dans tous les pays par les pianistes les plus éminents.
Il a fallu aux facteurs une expérience de vingt années pour se convaincre du mérite de l’échappement Érard et de sa supériorité sur l’ancien. Déjà, aux expositions de 1819 à Paris, il s’était produit des essais de double échappement : il ne pouvait donc manquer de s’en produire de nouveaux en 1851 à Londres et en 1855 à Paris. C’est en effet, ce qui est arrivé. Que l’on ouvre les pianos qui se rapprochent du piano d’Érard, soit pour la puissance du son, soit pour la facilité du toucher, et l’on remarquera que ces qualités proviennent de l’adoption plus ou moins exacte des inventions de Sébastien Érard, perfectionnées par P. Érard.
Il était, en effet, facile de prévoir qu’une fabrication si renommée par la supériorité de ses produits engendrerait des imitateurs. Ce principe de mécanisme à double échappement, qui fait passer du doigt à la touche, et par celle-ci au point où le marteau agit sur la corde, avec une délicatesse de toucher telle que le piano peut exprimer toutes les sensations qui animent l’exécutant ; ce principe, avons-nous dit, ne rencontra dans l’origine que des détracteurs, qui contestaient, tantôt sa solidité, tantôt sa supériorité sur l’ancien principe : mais, lorsqu’on le vit dans tous les concerts en possession incontestée du suffrage des juges les plus compétents, ses détracteurs devinrent ses imitateurs.
Ce fut à l’étranger que des fabriques de pianos sur le principe d’Érard s’établirent d’abord. MM. Eck et Lefebvre, à Cologne, pour les pianos à queue3, d’autres maisons à Zurich, à Cassel, à Brême, à Hambourg, à Genève, firent des pianos d’Érard d’une ressemblance extérieure et intérieure si parfaite qu’il fallait les jouer pour être détrompé sur leur origine.
Si ces tentatives de contrefaçon n’ont pas réussi jusqu’à présent, c’est que la fabrication de ce nouveau principe, donnant des résultats plus complets que l’ancien, est nécessairement plus difficile et plus coûteuse. Cette raison n’a pas été sans influence sur les résultats des premières tentatives d’imitation ; et peut-être eussent-elles été abandonnées si l’extension prodigieuse de l’industrie des pianos n’avait amené la création de différentes fabriques spéciales qui facilitent sous certains rapports le travail de MM. les facteurs. Il s’est établi à Paris depuis plusieurs années des faiseurs de caisses, de claviers, de mécaniques, d’étouffoirs, de marteaux, etc., etc., de pianos, sur les modèles de tel ou tel facteur en renom. Il en résulte que des individus non facteurs à Paris, en province ou à l’étranger, peuvent acheter chez chacun de ces fabricants les différentes parties d’un piano, les faire monter ensemble et les vendre ensuite sous leur nom. Mais des instruments fabriqués ainsi ne possèderont jamais cette homogénéité de toutes les parties entre elles qui seule donne aux pianos d’Érard, la perfection qu’on leur connaît.
S. M. l’empereur daigna récompenser le triomphe obtenu par M. Érard à Londres en le nommant officier de la Légion d’honneur. C’est alors que la pensée lui vint de reconstruire l’orgue de S. Érard et de lui rendre la place qu’il occupait en 1830. Il s’adressa en 1853 à S. M. l’empereur pour obtenir l’autorisation d’entreprendre ce travail. Elle lui fut gracieusement accordée. Il fit prendre au garde-meuble les débris de l’ancien orgue pour voir quel parti on en pouvait tirer4. Le 28 juin 1855, P. Érard adressa la lettre suivante à S. Ex. M. le ministre d’État :
« Monsieur le Ministre,
Après six mois d’études et de travail, je me suis rendu maître de toutes les combinaisons mécaniques et harmoniques qui distinguaient l’orgue de la chapelle des Tuileries, inventé et exécuté par Sébastien Érard, mon oncle, expressément pour la tribune de la chapelle.
Je suis prêt à reposer à la place qu’il occupait au palais des Tuileries ce magnifique instrument, et je m’estime bienheureux de pouvoir satisfaire ainsi le désir de S. M. l’empereur, qui, en m’accordant la bienveillante permission d’entreprendre cette restauration, a bien voulu donner à la mémoire de Sébastien Érard, 1’inventeur, un souvenir honorable, et à moi, son facteur, une preuve de l’intérêt protecteur dont il honore mon établissement de Paris. »
Etc., etc.
Le 14 juin 1854, ce travail immense était terminé, et M. Érard en donnait avis par lettre à Son Excellence M. le ministre d’État, en lui demandant la permission de faire porter l’orgue aux Tuileries pour sa mise en harmonie et la pose de la soufflerie, deux opérations qui ne peuvent être faites que sur l’emplacement définitif de l’orgue.
En s’occupant de la reconstruction de 1’orgue de son oncle, P. Érard préparait les instruments qu’il se proposait de présenter à l’exposition universelle française qui allait s’ouvrir. Il avait adopté la forme et les dessins d’un piano à queue Pompadour, dont la richesse devait frapper tous les yeux5. Il avait également deux magnifiques pianos obliques, l’un orné dans le style sévère de Louis XIII, et l’autre dans le genre plus coquet de Louis XV. Ayant mérité et obtenu toutes les distinctions et récompenses qui peuvent honorer l’artiste habile et le manufacturier heureux, son seul but, en préparant une aussi riche et aussi coûteuse exposition, était de témoigner à S. M., de la seule manière qui fût en son pouvoir (c’est-à-dire en contribuant dans la mesure de ses forces et de son zèle à l’éclat d’une solennité dont elle était le promoteur), toute la reconnaissance qu’il lui devait pour les distinctions dont il avait été comblé. Mais, hélas ! la Providence ne lui permit pas de jouir de l’effet que cette brillante exposition devait produire. — Cette activité incessante, cet esprit constamment tendu vers de nouveaux objets, devaient finir par triompher de sa bonne constitution. Il mourut après une longue maladie, le 16 août 1855, dans sa maison de la Muette. Plus heureux que son oncle, il laissa ses établissements de Paris et de Londres au plus haut point de prospérité.
Au milieu de tous ses succès, Pierre Érard ne montra jamais le moindre orgueil. Plein de reconnaissance pour le parent dont le génie inventeur les avait préparés, c’était à lui qu’il en reportait tout le mérite. Il ne se réservait que la part modeste d’avoir su faire apprécier les découvertes de ce génie si fécond.
Il était extrêmement obligeant. Aimant les arts et les artistes, il saisissait toutes les occasions de leur être utile. En cela, il obéissait autant à ses instincts généreux qu’aux traditions de sa famille. Il avait un caractère loyal et sûr que l’on appréciait d’autant mieux que l’on pénétrait davantage dans son intimité. La bonté de son caractère peut être constatée par ce seul fait, que, parmi le nombreux personnel de ses établissements de Londres et de Paris, un grand nombre d’ouvriers y sont depuis leur enfance, après avoir succédé à leurs parents.
C’est à sa veuve, dépositaire de ses pensées d’avenir, que P. Érard a laissé ses établissements de Paris et de Londres. Aidée du concours d’un personnel intelligent et dévoué, madame Érard saura remplir religieusement les intentions de son mari, et elle espère que ses efforts, couronnés de succès, lui permettront de remettre intact à son successeur le précieux dépôt qui lui a été confié.
__________________
1. Ce clavecin était remarquable par plusieurs inventions dont on n’avait pas d’idée auparavant. On y trouvai trois registres de plume et un de buffle ; une pédale y faisait jouer un chevalet mobile qui, s’interposant sur les cordes à la moitié de leur longueur, les faisait monter tout à coup d’une octave, invention qu’un facteur de Paris, nommé Schmidt, a renouvelée dans le piano à l’exposition des produits de l’industrie de 1806, c’est·à· dire trente ans après qu’Érard l’eut trouvée. En appuyant par degrés le pied sur une pédale attachée au pied gauche du clavecin, on retirait le registre de l’octave aiguë, celui du petit clavier, celui du grand clavier, et l’on faisait avancer le registre de buffle. En diminuant la pression du pied sur la pédale, on avançait le registre de l’octave aiguë, celui du petit clavier, celui du grand clavier, et l’on retirait le jeu de buffle. Enfin, lorsqu’on voulait faire parler à la fois tous les jeux, on se servait d’une pédalé attachée au pied droit du clavecin, sans être obligé d’attirer le petit clavier au dessus du grand, et conséquemment sans interrompre l’exécution, comme cela se faisait aux autres clavecins.
2. « Aujourd’hui cinq février mil sept cent quatre-vingt-cinq, le roi étant à Versailles, informé que le sieur Sébastien Érard est parvenu par une méthode nouvelle, de son invention, à perfectionner la construction de l’instrument nommé forté-piano, qu’il a même obtenu la préférence sur ceux fabriqués en Angleterre, dont il se fait un commerce dans la ville de Paris, et voulant Sa Majesté fixer les talents du sieur Érard dans ladite ville et lui donner des témoignages de la protection dont elle honore ceux qui, comme lui, ont, par un travail assidu, contribué aux arts utiles et agréables, lui a permis de fabriquer, faire fabriquer et vendre dans la ville et faubourgs de Paris et partout où bon lui semblera, des forté-pianos, et d’y employer, soit par lui, soit par ses ouvriers, le bois, le fer et toutes les autres matières nécessaires à la perfection ou à l’ornement dudit instrument, sans que pour raison de ce il puisse être troublé ni inquiété par des gardes syndics et adjoints des corps et communautés d’arts et métiers pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sous les conditions néanmoins, par ledit sieur Érard, de se conformer aux règlements et ordonnances concernant la discipline des compagnons et ouvriers, et de n’admettre dans ses ateliers que ceux qui auront satisfait auxdits règlements ; et pour assurance de sa volonté, Sa Majesté m’a commandé d’expédier audit sieur Érard le présent brevet qu’elle a voulu signer de sa main et être contre-signé par moi secrétaire d’État et de ses commandements et finances.
Signé LOUIS.
Le baron de Breteuil.
3. Le célèbre pianiste Liszt, passant à Cologne, visita la fabrique de ces messieurs qui fabriquaient des pianos de l’ancien principe. « Puisque vous voulez copier des pianos, leur dit-il, copiez donc des Érard ! » Conseil qu’ils suivirent immédiatement.
4. Ces débris se composaient de trois châssis de claviers mutilés et incomplets, de deux sommiers carrés, de deux sommiers de droite et de gauche, d’un sommier de récit, de débris de porte-vent, le tout détérioré par l’humidité ; et d’un lot de tuyaux en étain et en plomb aplatis, informes, et ne valant que le poids du métal.
5. Madame Érard a offert cet instrument à S. A. I. le prince Napoléon pour le soulagement de l’armée d’Orient. Sa lettre était conçue en ces termes :
A S. A. I. LE PRINCE NAPOLÉON.
« Monseigneur,
Pour contribuer au soulagement de l’armée d’Orient, je viens vous prier de vouloir bien accepter le piano à queue style Louis XIV, orné de peintures et de bronzes dorés, qui figure à mon exposition dans la nef. Quelque beau que soit cet instrument, la dernière pensée de mon mari, je regrette, Monseigneur, qu’il ne le soit pas davantage pour une si noble destination. »

 «La rue du Cloître Saint-Merry n’a été prolongée jusqu’à la rue du Renard qu’après avoir perdu son propre débouché sur la rue de la Verrerie. À l’endroit où elle faisait coude, s’élevait la maison de la juridiction consulaire, dite les Juges-Consuls, et dont la porte fut décorée d’une statue de Louis XIV, en marbre, par Guillain. C’est en 1844 qu’on a donné au bout de rue, détaché de celle du Cloître-Saint-Merry, le nom de rue des Juges-Consuls. Celle-ci, par conséquent, a hérité d’une belle maison à l’angle des deux rues, qui tient par derrière à l’église, et dont l’architecture virile, due à Richer, était vantée au dernier siècle. Ricard, trésorier de France honoraire, jouissait de cette résidente vers 1750. »
«La rue du Cloître Saint-Merry n’a été prolongée jusqu’à la rue du Renard qu’après avoir perdu son propre débouché sur la rue de la Verrerie. À l’endroit où elle faisait coude, s’élevait la maison de la juridiction consulaire, dite les Juges-Consuls, et dont la porte fut décorée d’une statue de Louis XIV, en marbre, par Guillain. C’est en 1844 qu’on a donné au bout de rue, détaché de celle du Cloître-Saint-Merry, le nom de rue des Juges-Consuls. Celle-ci, par conséquent, a hérité d’une belle maison à l’angle des deux rues, qui tient par derrière à l’église, et dont l’architecture virile, due à Richer, était vantée au dernier siècle. Ricard, trésorier de France honoraire, jouissait de cette résidente vers 1750. » «Je retourne vers Saint-Merri. D’autres rires éclatants de jeunes filles. Je ne veux pas voir les gens, je contourne l’église par la rue du Cloître-Saint-Merri – une porte du transept, vieille, en bois brut. Sur la gauche s’ouvre une place, aux confins de Beaubourg, éclairée a giorno. Une esplanade où les machines de Tinguely et d’autres créations multicolores flottent sur l’eau d’un bassin ou petit lac artificiel, en une sournoise dislocation de roues dentées, et, en arrière-plan, je retrouve les échafaudages de tubes et les grandes bouches béantes de Beaubourg – comme un Titanic abandonné contre un mur mangé de lierre, échoué dans un cratère de la lune. Là où les cathédrales n’ont pas réussi, les grandes écoutilles transocéaniques chuchotent, en contact avec les Vierges Noires. Ne les découvrent que ceux qui savent faire la circumnavigation de Saint-Merri. Et donc il faut continuer, j’ai une piste, je suis en train de mettre à nu une de leurs trames à Eux, au centre même de la Ville Lumière, le complot des Obscurs.
«Je retourne vers Saint-Merri. D’autres rires éclatants de jeunes filles. Je ne veux pas voir les gens, je contourne l’église par la rue du Cloître-Saint-Merri – une porte du transept, vieille, en bois brut. Sur la gauche s’ouvre une place, aux confins de Beaubourg, éclairée a giorno. Une esplanade où les machines de Tinguely et d’autres créations multicolores flottent sur l’eau d’un bassin ou petit lac artificiel, en une sournoise dislocation de roues dentées, et, en arrière-plan, je retrouve les échafaudages de tubes et les grandes bouches béantes de Beaubourg – comme un Titanic abandonné contre un mur mangé de lierre, échoué dans un cratère de la lune. Là où les cathédrales n’ont pas réussi, les grandes écoutilles transocéaniques chuchotent, en contact avec les Vierges Noires. Ne les découvrent que ceux qui savent faire la circumnavigation de Saint-Merri. Et donc il faut continuer, j’ai une piste, je suis en train de mettre à nu une de leurs trames à Eux, au centre même de la Ville Lumière, le complot des Obscurs. Je me replie sur la rue des Juges-Consuls, me retrouve devant la façade de Saint-Merri. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me pousse à allumer ma lampe de poche et à la diriger vers le portail. Gothique fleuri, arcs en accolade.
Je me replie sur la rue des Juges-Consuls, me retrouve devant la façade de Saint-Merri. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me pousse à allumer ma lampe de poche et à la diriger vers le portail. Gothique fleuri, arcs en accolade.
 Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. Il a été aplani, rogné, diminué par tous ses abords. Chaque jour, des maisons montent à l’escalade et l’envahissent. Puis, il a perdu une de ses principales curiosités : les carrières, qui ont été comblées. — Elles ouvraient encore, il y a une quinzaine d’années, leurs perspectives mystérieuses ; la plupart offraient des constructions régulières ; les voûtes étaient soutenues par des piliers. On les traversait en tous sens.
Et cependant, le Montmartre d’aujourd’hui est bien différent du Montmartre d’autrefois. Il a été aplani, rogné, diminué par tous ses abords. Chaque jour, des maisons montent à l’escalade et l’envahissent. Puis, il a perdu une de ses principales curiosités : les carrières, qui ont été comblées. — Elles ouvraient encore, il y a une quinzaine d’années, leurs perspectives mystérieuses ; la plupart offraient des constructions régulières ; les voûtes étaient soutenues par des piliers. On les traversait en tous sens. Et c’étaient chaque soir, pendant deux ou trois semaines, sur cette place relativement étroite, un bacchanal, une foule, une démence, des cirques en toile, des dioramas dans des berlines, des tableaux de toute dimension représentant des géantes, des physiciens, le tremblement de terre de la Guadeloupe, le mont Blanc, des oiseaux savants, des albinos, un serpent faisant six fois le tour du corps d’un voyageur, des estrades garnies d’athlètes en brodequins fourrés et de danseuses de corde en jupons à paillettes, des parades à coups de pied, de grosses têtes en carton s’agitant sur des tréteaux, un ouragan de pistons et de clarinettes, des hurlements dans des porte-voix, des réveils de ménagerie et des illuminations soudaines !
Et c’étaient chaque soir, pendant deux ou trois semaines, sur cette place relativement étroite, un bacchanal, une foule, une démence, des cirques en toile, des dioramas dans des berlines, des tableaux de toute dimension représentant des géantes, des physiciens, le tremblement de terre de la Guadeloupe, le mont Blanc, des oiseaux savants, des albinos, un serpent faisant six fois le tour du corps d’un voyageur, des estrades garnies d’athlètes en brodequins fourrés et de danseuses de corde en jupons à paillettes, des parades à coups de pied, de grosses têtes en carton s’agitant sur des tréteaux, un ouragan de pistons et de clarinettes, des hurlements dans des porte-voix, des réveils de ménagerie et des illuminations soudaines ! Le côté vilain de Montmartre, le côté pelé, déchiré, tourmenté, est celui qui commence au Moulin de la Galette, un des derniers moulins dont la hauteur était jadis couronnée. Deux autres ne sont plus que des squelettes de bois pourri. C’est la région des guinguettes, des bals, le dimanche, dans les arrière-boutiques de marchands de vins. La semaine, on n’y rencontre que des terrassiers, occupés auprès des charrettes remplies de gravois. Ces hangars noirs sont des fabriques de bougies, m’a-t-on assuré. J’ai découvert, près de là, un café orné de cette enseigne passablement ambitieuse : Café des Connaisseurs.
Le côté vilain de Montmartre, le côté pelé, déchiré, tourmenté, est celui qui commence au Moulin de la Galette, un des derniers moulins dont la hauteur était jadis couronnée. Deux autres ne sont plus que des squelettes de bois pourri. C’est la région des guinguettes, des bals, le dimanche, dans les arrière-boutiques de marchands de vins. La semaine, on n’y rencontre que des terrassiers, occupés auprès des charrettes remplies de gravois. Ces hangars noirs sont des fabriques de bougies, m’a-t-on assuré. J’ai découvert, près de là, un café orné de cette enseigne passablement ambitieuse : Café des Connaisseurs.