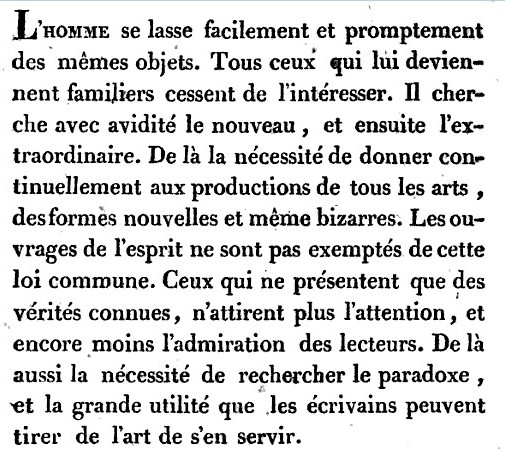« Redonner un visage à l’homme. Repenser la centralité anthropomorphe. »
 Lors du colloque « Permanence du yiddish » qui s’était tenu à l’Unesco il y a un an, l’allocution d’ouverture de Rachel Ertel, grande dame de la langue et de la culture yiddish s’il en est, a placé le propos spécifique de la conférence dans celui, bien plus général, de la place de l’homme – et donc de la langue, de l’histoire, de la culture, de l’identité, de la transmission – dans, ou face à, la modernité. On trouvera ci-dessous le début de son intervention qui donnera, on l’espère, l’envie d’écouter (ici, où l’on peut aller directement à son intervention par le menu de droite) ou de lire (là) l’intégralité de sa communication.
Lors du colloque « Permanence du yiddish » qui s’était tenu à l’Unesco il y a un an, l’allocution d’ouverture de Rachel Ertel, grande dame de la langue et de la culture yiddish s’il en est, a placé le propos spécifique de la conférence dans celui, bien plus général, de la place de l’homme – et donc de la langue, de l’histoire, de la culture, de l’identité, de la transmission – dans, ou face à, la modernité. On trouvera ci-dessous le début de son intervention qui donnera, on l’espère, l’envie d’écouter (ici, où l’on peut aller directement à son intervention par le menu de droite) ou de lire (là) l’intégralité de sa communication.
Rachel Ertel est pessimiste : le yiddish est une « langue assassinée », elle ne redeviendra plus une langue populaire. Mais, dit-elle, « elle peut conserver et transmettre son infinie richesse en son propre idiome ou, comme dans la métaphore de Peretz par “la métamorphose de sa mélodie”, en d’autres langues », ce que sa propre activité de traductrice (vers le français) n’a eu de cesse de démontrer. Mais la tâche du traducteur est aussi celle de « témoin du témoin absent ».
Rachel Ertel a aussi œuvré à enseigner et faire enseigner le yiddish – j’en sais quelque chose personnellement – et pas uniquement à l’intention de ceux dont les parents maintenant disparus et leurs propres parents souvent assassinés parlaient cette langue, mais de jeunes générations parfois étrangères à cette filiation mais qui n’en montrent pas moins d’intérêt à l’étudier, à se l’approprier.
Et donc, en dépit de son pessimisme affiché, elle conclut ainsi : « En faisant jouer ensemble toutes ces strates on peut espérer qu’une sédimentation fertile verra le jour, dont il est impossible de prévoir les avatars et les configurations, mais qui peut, peut-être, redonner une fluidité, une capacité de métamorphose, bref une vitalité au yiddish qui lui donnera une forme de permanence. »
Nota bene : le terme yiddish de « Khurbn » qui revient à plusieurs reprises dans la seconde partie de son allocution provient de l’hébreu où il signifie « destruction », voire « destruction totale, catastrophique ». En hébreu, il est surtout appliqué aux deux destructions du Temple de Jérusalem. En yiddish, il dénote l’extermination des Juifs durant la Seconde guerre mondiale (en français, on tend à utiliser de nos jours dans ce contexte le mot hébreu de « Shoah », qui signifie « catastrophe »).

«La notion de permanence et sa définition, celle du dictionnaire, est la suivante : « Caractère de ce qui est durable, de ce qui dure, demeure, sans discontinuer, ni changer ». J’insiste sur le terme de « changer ».
La question qui se pose alors est d’ordre tout à fait général : est-ce le cas des langues, est-ce le cas des cultures ? Les langues et les cultures qui durent, qui demeurent sans discontinuer ni changer deviennent vite des langues et des cultures mortes. Il faut donc, pour être permanent, ne cesser de changer, de se transformer, et de se muer constamment. La réalité de la permanence est un flux constant, la seule permanence est la fluidité, la transformation, la métamorphose, l’ubiquitaire, le polysémique, la mutation, le polymorphe.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, et pour certains même pendant une partie du XXe, nous vivions dans l’illusion du progrès illimité de l’humanité. La technique avance plus vite que jamais, mais le progrès n’est plus crédible. L’humanité toute entière a perdu la face, et l’histoire continue à nous montrer que, loin de la retrouver, elle ne fait que la bafouer et l’abolir de jour en jour.
Nous vivions dans des dimensions à échelle humaine – des familles, des régions, à la rigueur des États-nations –, nous vivons maintenant à l’échelle planétaire, autant dire nulle part.
Nous vivions dans l’illusion d’un axe du temps unilatéral qui nous menait vers des lendemains qui chantent. Pour certains, la rédemption était accomplie ; mais les faits l’ont démenti. D’autres attendent encore une rédemption qui semble de plus en plus hypothétique si nous nous en tenons aux faits historiques aux guerres, aux massacres, de plus en plu industriels, de plus en plus scientifiques. La science que l’on croyait la panacée universelle a dévoilé sa face d’ombre.
Nous avons perdu notre innocence. Pour ma génération l’univers entier est à repenser. Les mots ont perdu ou changé de sens. Nous vivons dans « le désenchantement du monde. » Et tout est à repenser. À commencer : redonner un visage à l’homme. À repenser la centralité anthropomorphe. À retrouver le sens des mots, les dimensions dans lesquelles l’être humain évolue, les espaces de vie.
Pour pouvoir vivre, le repenser non pas en termes de mondialisation, de globalisation, mais d’une proximité qu’aucun internet, le plus sophistiqué ne peut supplanter. Repenser le temps. Le temps, non plus comme un axe unilatéral, ni comme un cycle toujours recommencé. Le temps avance et recule par bonds, il oscille, il va et vient, il tangue, il bafouille, il bégaie.
Il faut peut-être repenser notre monde non plus par sa centralité, mais comme disait Richard Marienstras, par les marges.
Repenser de fond en comble la notion, nous dire que la permanence est mortifère, que la véritable dimension de la permanence c’est le mouvement, c’est le changement, c’est la transformation.
»Alors nous pourrons repenser la permanence dans ses multiples dimensions : linguistique, historique, culturelle, identitaire, transmissible, c’est-à-dire dans la vie avec tous ses aléas.

 Revenons à « sanguinoler » : ce verbe n’existe dans aucun des dictionnaires qu’on ait consultés, et le Trésor de la langue française
Revenons à « sanguinoler » : ce verbe n’existe dans aucun des dictionnaires qu’on ait consultés, et le Trésor de la langue française 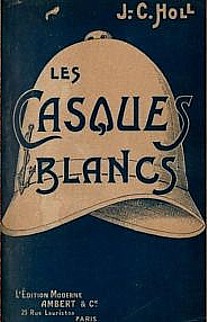 Cette citation est tirée d’un livre, Les casques blancs, d’un certain J.C. Holl, publié chez Ambert en 19??, selon les informations lacunaires de Google Books (où l’on ne peut évidemment pas en consulter le contenu). Cet ouvrage est absent du catalogue de la BnF, tandis qu’on y trouve plus d’une dizaine d’autres ouvrages de « Holl, J.-C. » (avec ou sans précision des dates de naissance et de mort, 1874-19..), dont certains publiés en 1903 chez le même éditeur – ce qui me laisse penser qu’il s’agit de la même personne –, et parvenus à la BnF par le dépôt légal – l’absence des Casques blancs en étant d’autant plus étonnante. Les voici :
Cette citation est tirée d’un livre, Les casques blancs, d’un certain J.C. Holl, publié chez Ambert en 19??, selon les informations lacunaires de Google Books (où l’on ne peut évidemment pas en consulter le contenu). Cet ouvrage est absent du catalogue de la BnF, tandis qu’on y trouve plus d’une dizaine d’autres ouvrages de « Holl, J.-C. » (avec ou sans précision des dates de naissance et de mort, 1874-19..), dont certains publiés en 1903 chez le même éditeur – ce qui me laisse penser qu’il s’agit de la même personne –, et parvenus à la BnF par le dépôt légal – l’absence des Casques blancs en étant d’autant plus étonnante. Les voici :