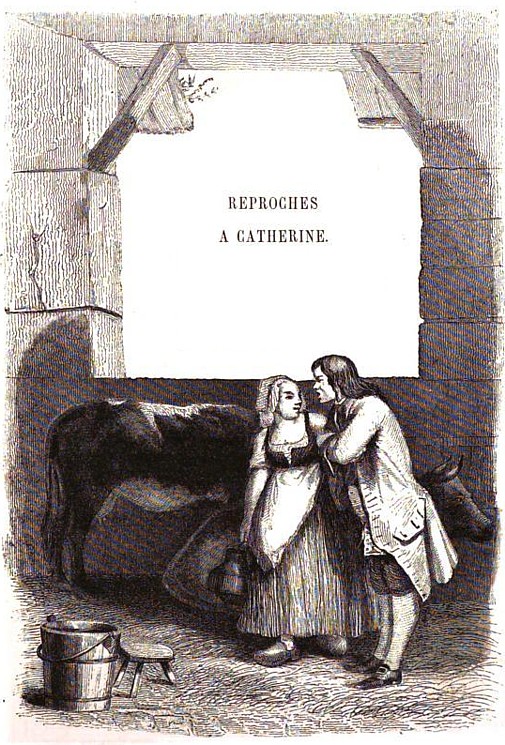Un autre secret
Lors d’une récente table ronde au musée d’art et d’histoire du judaïsme consacrée à l’autobiographie, l’écriture nécessaire, le psychanalyste Philippe Grimbert a évoqué le secret dont il parle dans son livre éponyme. En l’écoutant parler, je me souviens…

Adolescent, j’aime regarder les photos de famille.
Celles du passé de ma mère, ou plutôt de ses passés, se trouvent dans deux ou trois belles boîtes de bois laqué dans lesquelles je farfouille périodiquement. Il n’y règne aucun ordre, une photo du 19e siècle peut avoisiner une autre prise cent ans plus tard dans un autre monde, certaines se font face tandis que d’autres se tournent le dos, tête bêche ou cul par-dessus tête. Les prendre une à une s’apparente à une loterie, la surprise est chaque fois totale. Impossible de retrouver une photo si ce n’est par hasard.
Il y a là ma mère enfant et sa famille, principalement issue de la bourgeoisie juive aisée et émancipée à Odessa d’avant la Révolution (une cousine avait tout de même épousé Trotski) : les femmes, de mère en fille, se ressemblent toutes, belles et ténébreuses, posent souriantes avec leurs maris ou petites avec leur Michka, loin d’imaginer le sort tragique qui frappera leurs descendants en 1917 où ils perdent tous leurs biens, puis en 1939-1945 où ma grand-mère et son fils au regard si profond dont je tiens le prénom perdent la vie. D’autres disparaissent on ne sait quand ni où. De ses onze oncles et tantes il ne reste que de belles photos comme tirées de gravures de modes anciennes et une cousine et son frère.
Je vois dans la boîte une jeune fille timide se tenant à l’ombre d’une religieuse dans le pensionnat où elle est placée : c’est elle, envoyée adolescente, seule, en France. Une chance qui lui permet d’éviter le sort de sa famille restée en Russie, un traumatisme qu’elle ne surmonte pas, celui de la séparation d’avec ses proches, sa langue et sa culture. J’y retrouve le couple chez lequel elle vit jusqu’à son mariage après la guerre (qu’elle passe cachée en zone libre), issu, lui, d’une bourgeoisie française catholique, pratiquante et bonapartiste : ils sont comme des parents pour elle, ils lui évitent d’être raflée pendant la guerre en se mettant en danger, eux dont je dirai plus tard, « mes grands-parents, les pauvres, ils n’ont jamais eu d’enfants ». Quant à mes vrais grands-parents, les pauvres… Les photos de ce troisième grand-père enfant, habillé à la mode du 19e siècle, me surprennent : on dirait une petite fille. Il connaît Apollinaire qui en parle dans un texte que ma mère me montre. Je me souviens de lui dînant en costume, une grande serviette blanche nouée autour du cou et recouverte par sa belle barbe blanche rectangulaire, buvant précautionneusement et avec plaisir du vin chaud dans une tasse cylindrique en porcelaine blanche. Leur appartement, parenthèse temporelle d’un 19e siècle immuable dont ils semblent n’être jamais sortis eux non plus, grand et silencieux, la chambre où elle se réfugie – Julien Gracq lui écrit : « Je vous voyais si seule malgré l’affection de vos parents adoptifs » –, et où je ne me lasse d’explorer et de réexplorer les meubles d’époque, une bibliothèque directoire aux vitrines en biseau dans l’entrée, la salamandre en céramique vert sombre dans le salon non loin d’un magnifique Boulle dans lequel est rangée la belle vaisselle tout contre une vieille TSF que j’écoute l’oreille collée contre le poste, des objets beaux, désuets ou étranges tels un mouchoir à bougie en porcelaine, un pince-nez, une petite statue d’Hégésipe Simon le précurseur posée dans les toilettes ou une boîte en bois qui permet de voir des cartes postales en relief, placée dans le fourre-tout où se trouve l’inépuisable bibliothèque dont je dévore tout le contenu sans distinction, Balzac, Maurice Leblanc, Lectures pour tous, Troyat et Jack London…

Mon père, lui, range ses photos dans des enveloppes. Des mondes disparus eux aussi : celui des Juifs pieux du shtetl de Galicie où il est né peu avant la guerre et donc encore en Autriche-Hongrie, les hommes aux grandes barbes blanches comme celle de mon troisième grand-père mais différentes, moins bourgeoises – mon grand-père, réfugié à Vienne pendant la grande guerre, doit la tailler pour ne pas avoir l’air trop juif –, aux papillotes descendant le long du visage ou rangées derrière les oreilles, un regard bon et intelligent encadré d’une paire de lunettes métalliques ovales, la tête couverte d’un calot noir, les femmes solides et essentielles en perruque, modestement vêtues de noir. Ils sont tous, à leur façon, d’une rare élégance, non pas celle d’une mode, ils n’en ont ni les moyens ni surtout l’intérêt, mais dans leur maintien d’une grande dignité, dans leur générosité discrète pour ceux qui sont encore plus démunis qu’eux. À partir de 1939 il n’y a plus de photos, il n’en reste que quelques cartes postales, la dernière écrite quelques instants avant qu’ils ne soient raflés en 1942. Elles aussi sont bien rangées.
Puis il y a les photos des camps de jeunes qu’il anime, d’abord en Pologne puis en Palestine : toutes posées de façon conventionnelle (ce qui atténue l’émotion à la vue de ce monde lui aussi disparu), à l’exception de celle, étrange, où on le voit assis par terre dans une tente, les jambes croisées et soufflant dans une flûte comme un charmeur de serpent, lui qui ne sait jouer d’aucun instrument. Une photo de sa sœur cueillant des oranges dans un verger un fichu sur la tête, une autre de ses enfants à elle se tenant la main, des photos de son frère beau comme un Rudolph Valentino avec sa magnifique femme colombienne apparentée à Dali (ce qui fait pendant à Trotski, me disé-je), tant d’autres photos aux personnages non identifiés mais dont je ne me résous à me séparer.

Ces deux univers qui n’ont de commun que la fatalité de l’histoire des Juifs se rencontrent. La très belle femme paumée, inconsciente de sa beauté radieuse, courtisée par de jeunes et brillants intellectuels, l’homme modeste, réservé et attentionné, et que les valeurs religieuses et sociales, indissociables, structurent sans le rendre dogmatique. Enfin quelqu’un qui l’aime vraiment et sur lequel elle peut compter.

Un jour que je feuillette pour la ennième fois ces enveloppes, je remarque une vieille photo d’identité : une belle jeune femme au visage avenant, un petit chapeau noir sur la tête, qui ressemble – c’est ce qui me frappe – à la femme d’un cousin, surtout les yeux souriants. Je demande à ma mère qui est-ce, elle me répond « la première femme de ton père ». Comme ça, simplement.
Jusqu’à ce jour, je n’avais jamais su que papa avait été précédemment marié.
J’apprends qu’il l’avait épousée en Pologne juste avant la guerre, les deux familles se connaissaient depuis longtemps. Rentré en Palestine, il y fait toutes les démarches pour obtenir des autorités du mandat britannique le fameux certificat qui lui permettrait de faire venir sa femme auprès de lui. Il l’obtient finalement, la Croix rouge le transmet à l’occupant nazi en Pologne, qui se met à la recherche de la femme pour la faire partir, mais sans succès. Après la guerre, mon père est déclaré veuf. Il fait connaissance avec ma future mère. Dans une lettre que je trouve des années plus tard, il écrit à sa sœur – celle qui cueillait des oranges dans le verger –pour lui raconter être tombé amoureux, lui qui pensait ne plus jamais pouvoir aimer une autre femme.
J’apprends aussi alors que le frère de cette malheureuse femme habite non loin de chez nous, avec femme et enfants : nos deux familles se fréquentent depuis toujours, je ne m’étais jamais demandé comment on se connaissait, c’est comme ça, voilà.

À l’enterrement de ma mère, plus de vingt ans plus tard, une voisine de notre l’immeuble et la veuve de ce frère se retrouvent côte à côte. La voisine demande à cette dernière quel rapport elle a avec moi, c’est la première fois qu’elle la voit. L’autre répond, « je suis sa tante ». Autre découverte : pour moi ce sont des amis de toujours, mais elle a raison, puisqu’elle est la belle-sœur de mon père.
Je vois toujours ses deux filles (dorénavant grands-mères). Ce n’est qu’il y a deux ou trois ans que l’une d’elles me raconte pourquoi les Nazis n’avaient pu trouver sa tante : apprenant, on ne sait comment, que les autorités la recherchaient et craignant d’être raflée, elle s’était cachée. Si elle ne l’avait fait, elle aurait été sauvée.

PS : On trouvera ici une relation plus détaillée et plus à jour de l’histoire de la première femme de mon père.