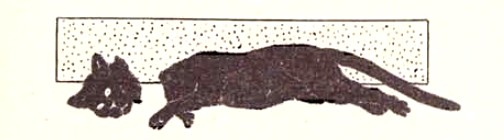pas feutrés, le gros chat noir se glisse dans le jardin où le prince de Hizen Nabeshima et sa favorite O Toyo ont l’habitude de se promener. Il se cache dans un fourré où, seuls, décèlent sa présence ses yeux phosphorescents.
Le prince arrive, grand et de noble allure ; son visage brille de santé ; sa joie éclate en fiers sourires. À ses côtes marche la belle O Toyo, célèbre par son esprit autant que par son charme. La taille élancée, le corps un peu grêle, elle a la face allongée que l’on juge d’une distinction toute aristocratique, le teint clair, les yeux très obliques, la bouche minuscule. Elle porte un luxueux kimono brun, coupé d’un obi de brocard gris.
Le kimono est la robe traditionnelle des Japonais et l’obi est la ceinture.
Tous deux parcourent lentement le beau jardin, où les arbres, les arbustes, les arbres-nains, le sable, les pierres, les rochers, un étang, un ruisseau, des ponts, des lanternes de pierre, des pavillons, de petites chapelles, sont harmonieusement disposés, ordonnés comme un tableau. C’est en ce moment la saison des glycines : des rameaux longs de vingt, de trente mètres, portent d’énormes grappes blanches ou violacées ; on dirait une cascade de fleurs.
Érudite, O Toyo récite un poème du viiie siècle :
Déjà les fleurs de glycine
Se reflètent
Dans l’étang ;
Qu’attends-tu pour chanter,
Coucou ?
Le prince et la favorite se regardent en souriant. Ils se sentent tout particulièrement heureux de vivre.
Ils ne se doutent point qu’un gros chat noir les observe de ses yeux phosphorescents, puis, à quelque distance, les suit de son pas feutré.
« Bonsoir, mon cher seigneur », dit la belle O Toyo. — Elle se retire dans ses appartements, se couche et s’endort.
Son sommeil est troublé par un cauchemar. Elle rêve qu’un assassin guette son seigneur, se jette sur lui. D’émotion, elle s’éveille. Il est minuit.
Ouvrant les yeux, qu’aperçoit-elle dans l’obscurité ? Deux points lumineux, passant par toutes les nuances du grisâtre, du bleuâtre, du jaune, du vert. C’est le chat noir qui s’est glissé dans sa chambre, s’est accroupi près d’elle, fixe sur elle ses yeux d’opale.
Est-ce le rêve d’il y a un instant qui a troublé, énervé O Toyo ? En face de l’élégant animal elle est prise d’une incompréhensible terreur. Elle tremble, elle sent son cœur battre avec violence, son corps se couvrir de sueur. Elle ouvre la bouche pour appeler au secours ; mais sa gorge se serre ; aucun son ne peut sortir de ses lèvres.
Elle n’a, d’ailleurs, pas le temps de faire le moindre geste : le chat noir lui saute à la gorge, et, de sa gueule et de ses pattes, l’étrangle instantanément.
Le chat noir est doué d’une force démoniaque : il traîne dans les couloirs du palais le cadavre bleui de celle qu’il a tuée ; il l’emporte à travers le jardin, sans laisser de ce passage aucune trace ; il l’enterre dans un lieu secret.
Il retourne dans la chambre vide. Et là, par magie, il se transforme en celle qu’il vient d’assassiner.
Nul ne s’apercevra de la métamorphose, tant la nouvelle O Toyo ressemble à l’ancienne. Elle est, seulement, plus souple encore, parée d’une grâce toute féline. Et quelquefois ses yeux sombres ont des éclats phosphorescents.
Le prince se sent de plus en plus épris de sa compagne favorite. Quels doux entretiens ils ont ensemble ! Quelles promenades délicieuses, parmi les fleurs et les lanternes, sur les allées sablées et sur les points gracieux du noble jardin !
Mais voici que le prince tombe malade. Sans qu’aucun de ses organes apparaisse atteint, ses forces déclinent. Son visage devient livide. Son intelligence perd sa lucidité. Il souffre sans raison d’une perpétuelle sensation de fatigue ; et de brusques accès de somnolence s’emparent de lui.
Les médecins sont appelés. Ils étudient le cas avec l’air sérieux qui convient et la gravité d’usage. Ils diagnostiquent une maladie de langueur. Les uns prescrivent des massages, et les autres des tisanes. Mais aucun traitement ne se révèle efficace.
Au contraire, le mal s’aggrave. La nuit surtout est terrible : le prince est victime de rêves affreux que, d’ailleurs, il oublie au réveil, mais qui le laissent épuisé. Une nuit, on l’entend pousser des cris atroces.
La princesse sa femme consulte les conseillers intimes. On décide de faire veiller le prince par cent serviteurs.
Mais, — ô prodige ! — dès le premier soir, tous les gardiens se sentent envahis d’une étrange torpeur : leur tête dodeline, leurs yeux se ferment ; l’un après l’autre, chacun s’endort.
Trois nuits de suite, le même accident se renouvelle.
Les nuits suivantes, on change les gardes ; les nouveaux gardes, eux aussi, en dépit de leur efforts, succombent à un invincible sommeil.
Les conseillers intimes du prince de Hizen décident de veiller eux-mêmes leur seigneur. Ils s’installent auprès de lui. Tout d’un coup, comme si une main puissante passait sur leur visage, leurs paupières se ferment. Au matin, tout honteux, ils s’aperçoivent qu’eux aussi se sont endormis.
Et toujours les forces du prince vont en diminuant. On dirait que chaque nuit, un peu de son sang s’écoule ; et pourtant son corps n’est atteint d’aucune blessure visible.
Les conseillers intimes se demandent si leur seigneur n’est pas victime d’une influence diabolique. Peut-être un mauvais esprit vient-il, la nuit, torturer le prince et lui ravir ses forces ?
Contre ce mal étrange, des prières seraient peut-être plus efficaces que des remèdes. Le conseiller Isahaya Buzen va demander ces prières à Ruiten, le premier bonze du temple Miyô In.
Ruiten promet son aide. Tous les soirs, il supplie les Dieux de guérir le prince.
Une nuit, au moment où il cesse ses prières, il entend quelque bruit venant d’un puits proche du temple. Il entr’ouvre la paroi qui clôt sa demeure. Les chambres japonaises sont entourées par des parois glissantes, consistant en cadres de bois recouverts de papier transparent.
À la lumière de la lune, le moine aperçoit un simple soldat, très jeune, qui, après s’être purifié par des ablutions, au puits du temple, s’incline devant une statue du Bouddha.
Dans le silence nocturne, où les voix portent au loin, il entend l’homme prier pour le salut du prince de Hizen.
Le bonze est ému de voir un humble militaire animé d’un tel esprit de fidélité envers son chef. Il interpelle le soldat quand celui-ci a fini ses prières et le fait venir dans son appartement.
L’homme d’armes, un peu intimidé, s’incline très bas devant le haut dignitaire religieux.
Il répond courtoisement à ses questions :
« Je m’appelle Itô Sôda, et sers dans les troupes du prince. Je suis prêt à donner ma vie pour mon seigneur. Je voudrais pouvoir le soigner ; mais mon humble rang m’interdit d’être admis en son auguste présence. Aussi je me borne à prier pour lui le Bouddha et les autres Dieux.
— Vous êtes bien jeune, — dit Ruiten, — mais votre âme est loyale comme celle d’un vieux chevalier… Je vous admire… Savez-vous de quel mal mystérieux souffre le prince ? Savez-vous que, chaque nuit, il est victime de rêves atroces, épuisants, tandis que ses gardiens cèdent à un étrange besoin de dormir ?
— Peut-être y a-t-il là quelque maléfice. Peut-être résisterais-je au sommeil et découvrirais-je la cause du mal…
— Je parlerai de vous au premier conseiller, — dit le moine. — Je lui demanderai de faire appel à votre dévouement, comme vous le désirez.
— Oh ! merci ! merci ! Que vous êtes bon ! et que je vous suis reconnaissant ! Dites-lui bien, surtout, que je ne demande ni avancement ni récompense. La guérison de mon seigneur est le seul objet de mes vœux.
— Revenez me voir demain soir. Je vous conduirai chez le premier conseiller du prince. »
Le lendemain Ruiten se rend avec Itô Sôda chez Isahaya Buzen.
Laissant le militaire à la porte, il va exposer au premier conseiller le désir du jeune homme.
« C’est impossible, — dit Isahaya Buzen. — Comment autoriser un homme aussi humble à s’approcher du prince ?
— Consentez au moins à le voir et à lui parler », — demande Ruiten.
Isahaya Buzen fait venir le jeune homme. Il ne résiste pas à son expression de candeur, de fidélité et de vaillance. Il promet de faire, dès le lendemain, appel à lui.
La nuit suivante, Itô Sôda figure parmi les gardes chargés de veiller le prince, et qui entourent sa couche. Vers dix heures, il voit ses camarades s’endormir l’un après l’autre. Il sent aussi ses paupières lourdes de sommeil.
Alors il exécute un projet antérieurement conçu et minutieusement préparé. Il pose sur les nattes une feuille de papier huilé (même pour rendre service au prince, il ne faut pas souiller de sang son auguste chambre). De son petit couteau, il fait dans son genou une profonde taillade. La douleur le tient éveillé.
Cependant, la main magique passe encore sur ses paupières, comme pour les fermer. Alors il retourne le couteau dans sa blessure, pour que la vive souffrance chasse le sommeil. Il recommence chaque fois qu’il risque de s’endormir.
Il réussit, lui seul, à garder les yeux ouverts.
Minuit. Les portes glissent sur leurs rainures, sans bruit, comme magiquement. Une femme d’une merveilleuse beauté pénètre dans la pièce.
Avec la souplesse fluide d’un félin, elle glisse parmi les corps des gardes endormis. Elle est toute proche du prince ; elle se penche vers lui ; elle va, de ses lèvres tendues, baiser le corps du seigneur, ou bien, — qui sait ? — peut-être sucer son sang, et avec son sang, sa vie…
Tout d’un coup, ses yeux phosphorescents voient, dans l’ombre, luire les prunelles d’Itô Sôda.
Elle se redresse, se tourne vers le jeune homme, et lui dit à voix basse :
« Qui êtes-vous ? Je n’ai pas l’habitude de vous voir ici.
— On me nomme Itô Sôda. Je suis pour la première fois de garde ici.
— Tous dorment, et vous seul avez les yeux ouverts ! J’admire votre vigilance !
— Oh ! ne me louez pas ! J’ai grand sommeil.
— Mais comment pouvez-vous être éveillé ?… Qu’est-ce donc ? Le sang coule de votre genou ?
— Je me suis blessé volontairement afin que la douleur m’empêche de dormir.
— Je vous admire de plus en plus. Vous méritez tous les louanges.
— Oh ! ce n’est qu’une égratignure ! Il ne vaut pas la peine d’en parler ! Je ferais bien plus pour mon chef si je pouvais.
— Vous êtes un soldat modèle et un parfait serviteur. »
L’adorable jeune femme adresse à Itô Sôda le plus exquis des sourires.
Jamais l’humble militaire n’a vu une femme aussi belle lui témoigner une telle sympathie. Il se sent profondément troublé, se demande s’il ne va pas être ensorcelé. Il y a dans certains sourires un charme (au double sens de ce mot).
Espérant avoir séduit, et vaincu le garde, la mystérieuse créature se tourne vers le prince :
« Comment va, cette nuit, notre cher seigneur ? »
Elle se penche à nouveau sur le corps du prince Nabeshima.
Mais Itô Sôda a résisté au charme du sourire comme à la magie du sommeil. Lui aussi s’est dressé, silencieusement, s’est approché du prince. Et il se montre tout prêt à écarter l’ensorceleuse.
À pas feutrés, la belle dame tourne autour de la couche du prince. Mais chaque fois qu’elle veut s’en approcher trop près, elle en est empêchée par le regard menaçant du jeune soldat.
Enfin, elle renonce, et se retire. Les cloisons servant de porte, glissant dans leurs rainures sans bruit, s’ouvrent devant elle et se referment sur elle comme magiquement.
Au matin les gardes s’éveillent. Ils admirent la vaillance de leur jeune camarade, qui seul a fait son devoir, au prix d’une vive douleur ; ils rougissent de n’avoir pas eux-mêmes conçus cette idée ou manifesté ce courage.
Itô Sôda se rend chez Isahaya Buzen et lui conte comment s’est passée la nuit. Il est chaleureusement félicité. Il juge qu’il reçoit la plus précieuse récompense, lorsqu’il entend dire que, pour la première fois depuis longtemps, le prince de Hizen a eu la satisfaction de se sentir reposé après une calme nuit.
Le lendemain, Itô Sôda est encore de garde. À minuit, les portes recommencent à s’ouvrir. La belle jeune femme (on a expliqué au soldat que c’est O Toyo) s’avance comme la veille ; elle parcourt la chambre du regard ; mais, quand elle voit ouverts les yeux du veilleur fidèle, elle n’insiste pas, et se retire à pas feutrés.
Les nuits suivantes, elle ne revient pas. D’ailleurs, les gardes ne s’endorment plus. Le prince reprend force et vie. Tout le palais est en fête.
On impose à Itô Sôda un grade d’officier et le don d’une belle propriété.
Cependant le vaillant jeune homme estime qu’il n’a pas fini sa tâche. Il va trouver Isahaya Buzen.
« Les amis et les fidèles serviteurs du prince ne pourront être, — dit-il au conseiller, — tout à fait rassurés que quand tout danger aura pour lui disparu. »
Isahaya Buzen approuve. Itô Sôda continue :
« Notre prince était certainement victime de maléfice. Si tous ses gardes toujours s’endormaient, n’est-ce point parce qu’on leur avait jeté un sort ?
— C’est certain.
— Or, pendant ma garde, une seule personne est venue dans la chambre de notre seigneur : c’est O Toyo. Dès qu’elle a cessé d’y venir, le prince a cessé d’être malade… Je suis désolé de porter une si grave accusation contre une personne pour qui notre maître paraît avoir le plus vif attachement. Mais, pour moi, je n’ai aucun doute. La créature démoniaque responsable de la maladie du prince, c’est O Toyo.
— Je commence à le croire, à le craindre, — répond à voix basse Isahaya Buzen. — Je demanderai l’avis des autres conseillers. Revenez me voir demain. »
Le lendemain, Isahaya Buzen apprend à Itô Sôda que, discrètement interrogés, tous les conseillers du prince ont été d’accord pour accuser O Toyo.
« Eh bien ! pour sauver le prince, il faut faire disparaître cette créature démoniaque, — s’exclame Itô Sôda. — Donnez-moi l’autorisation de la détruire, et je la tuerai, aujourd’hui même. Je vous demanderai seulement de placer huit gardes devant la porte de sa chambre, pour l’empêcher de fuir. »
Le même soir, Itô Sôda fait annoncer à O Toyo qu’il lui apporte, dans une petite boîte laquée, un message du prince.
On l’introduit auprès de la favorite.
« Donnez, donnez vite. Pourvu que mon cher seigneur ne soit pas de nouveau malade !
— Non, il n’est pas malade… Mais condescendez à lire cette lettre et à me confier la réponse. »
Pendant que O Toyo ouvre la boîte contenant le message, le guerrier tire son épée. La belle dame se méfie : elle bondit en arrière ; elle saisit une petite hallebarde à hampe de laque noire rehaussée d’or, et engage la lutte. Tout en se battant, elle s’écrie :
« Comment osez-vous attaquer une dame de la cour, et la plus aimée du seigneur ? Je vous ferai chasser du palais… »
Mais, d’un coup de sa bonne lame, Itô Sôda fait tomber la hallebarde ; d’un autre coup, il tranche la tête d’O Toyo.
Et voici : sur le sol gît, non le cadavre d’une jeune femme, mais, tête coupée…, un gros chat noir ; — le chat-vampire qui, pendant tant de nuits, était venu boire le sang du prince Nabeshia, et dont, seule, avait triomphé la vaillante fidélité d’Itô Sôda.
Félicien Challaye, « Le chat-vampire », in Contes et légendes du Japon. Illustrateur : Joseph Kuhn-Régnier. Fernand Nathan, 1933.
Reproduit avec l’autorisation des Éditions Bordas.