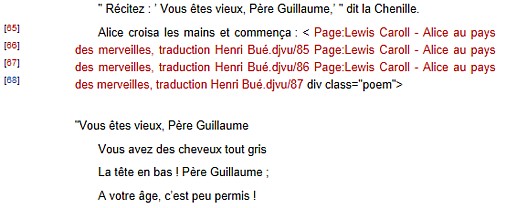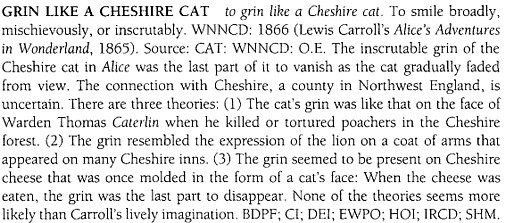La deuxième chute
 Pieter Bruegel : Dulle Griet (Margot la folle). ca. 1562.
Pieter Bruegel : Dulle Griet (Margot la folle). ca. 1562.
Ce début d’été pourri n’est pas, nous dit-on, si exceptionnel que cela : 2007, 2008, 2000 et surtout 1980 se seraient distinguées comme particulièrement fraîches. Toutefois, la tendance générale est clairement à la hausse, et notamment depuis 19801. Et un prévisionniste de Météo France nous rassure : « Nous avions effectivement annoncé un été chaud. Et cet épisode pluvieux d’une dizaine de jours ne remet pas en cause cette prévision. La probabilité de connaître un été plus chaud que la normale reste importante. »
Si donc la sécheresse que notre pays a connu ce printemps est – temporairement du moins – atténuée de ce fait, ce n’est pas le cas aux Etats-Unis, où quatorze États sont dans la fournaise ardente – températures extrêmement élevées (plus de 40° pendant plusieurs jours d’affilée), mais aussi incendies. Ainsi, l’Arizona tente de combattre le pire incendie de son histoire, et quelque 40.000 feux ont dévoré plus de 2,3 millions d’hectares de terres dans l’ensemble du pays. Et on n’est pas encore en août, où la situation va s’aggraver. Pire, la sécheresse semble y devenir endémique et les climatologues y président une désertification, dont l’effet se combinera avec la demande accrue d’eau potable du fait de l’accroissement et de la concentration de la population. En Russie et notamment dans son Extrême Orient, qui avait subi l’année dernière une canicule record, les incendies naturels se propagent. Quant à la sécheresse exceptionnelle en Somalie, on en a vu les ravages tragiques lorsqu’elle se combine à la malnutrition et à la famine – et, souvent, aux conflits internes – qui concernent plus généralement la Corne de l’Afrique. Est-ce ce qui attend, à terme, les pays actuellement plus riches ? On est en droit de le croire : c’est ce que disait James Lovelock en 2006.
Dans l’une de ses célèbres dystopies, l’écrivain J.G. Ballard décrivait il y a une cinquantaine d’années la sécheresse recouvrant graduellement la planète, monde aride et violent où l’eau est devenue la monnaie d’échange :
The world-wide drought now in its fifth month was the culmination of a series of extended droughts that had taken place with increasing frequency all over the globe during the previous decade. Ten years earlier a critical shortage of world food-stuffs had occurred when the seasonal rainfall expected in a number of important agricultural areas had failed to materialize. One by one, areas as far apart as Saskatchewan and the Loire valley, Kazakhstan and the Madras tea country were turned into arid dust-basins. The following months brought little more than a few inches of rain, and after two years these farmlands were totally devastated. Once their populations had resettled themselves elsewhere, these new deserts were abandoned for good.
J. G. Ballard, The Drought. 1965.
On le sait, c’est l’homme qui est l’artisan de son propre malheur, mais surtout de celui de toutes les générations à venir, bien au-delà des trois ou quatre générations suivantes sur lesquels le Dieu de la Bible fait porter les fautes des pères (Nombres XX:5) : déforestation sauvage de splendides forêts qu’on appelait autrefois vierges, utilisation accrue d’hydrocarbures, gabegie de ressources non renouvelables, production inutile de déchets difficilement recyclables, et, plus généralement, hyperconsommation inscrite dans l’économie libérale et dans la course aux toujours plus nouvelles technologies2. L’homme sera-t-il chassé par lui-même de ce paradis terrestre comme il l’a été autrefois de cet autre paradis ? Et si oui, vers où ?
Ô esclandre effroyable ! ô catastrophe déplorable ! ô changement infortuné ! ô sortie fatale ! ô bannissement misérable ! aussi était-ce une pitié mais plus grande qu’aucune autre fût jamais, de voir la désolation de ces pauvres infortunés Adam & Ève, d’entendre leurs soupirs, ouïr leurs sanglots, leurs regrets, leurs plaintes, leurs pleurs, leurs cris, l’air retentissant de tous côtes, les forêts où ils passaient ne résonnaient que les échos de leurs désolées plaintes ; les bêtes qui se rencontraient par là, s’enfuyaient au bruit de leurs voix lamentables, ils ne faisaient que pleurer, ils ne faisaient que crier ; mais avec telle douleur de cœur, qu’ils n’eussent pu former une seule parole. Ah ! cela leur était impossible, la fâcherie en était trop véhémente, la perte trop grande, la douleur trop cuisante, la plaie trop fraîche ; de sorte que s’en allant à travers des campagnes coup à coup leur cœur leur manquait, pas à pas il fallait que l’un relevât l’autre, ils se pâmaient de rien à rien, le cœur leur manquait à tout coup. Et pour surcroît de leur malheur, ils n’eussent fait demie lieue pour chercher où ils se pourraient retirer, que voila le soleil, ce bel œil de la nature s’aller cacher du côté des antipodes, qui leur augmenta infiniment leur douleur, croyant qu’ils ne le verraient plus, & qu’il s’était allé caché à l’occasion de leur péché : car aussi ils n’avaient ni l’un ni l’autre vu encore aucune nuit, ayant tous deux été créés ce même jour.
François Arnoulx, La Poste royale du Paradis, p. 251-3. Lyon, 1635.
1 Comme l’indiquent les nombreux graphiques de l’étude Le changement climatique récent et futur sur l’arc péri-méditerranéen.
2 Que J. G. Ballard, encore lui, avait décrit dans L’Homme subliminal (on en avait déjà parlé ici).
 Albrecht Dürer : L’expulsion du Paradis. 1510.
Albrecht Dürer : L’expulsion du Paradis. 1510.